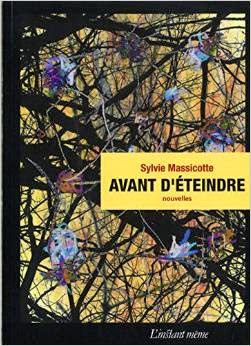Silencieux, vous vous réfugiez dans nos livres d'art pendant qu'on écrit. Vous ébauchez un sourire timide en nous interrogeant sur le centre du monde que pour vous on représente. On vous répond qu'autour de cet axe spatio-temporel, tant de questions se posent, insolubles, que le centre n'existe plus. Satisfait, le néant et ses artefacts vous rassurent sur notre présence auprès de vous. On parle du premier recueil de nouvelles, L'Horloger, signé Félix Villeneuve.
Quel est le sens de la vie, l'enjeu du Temps, semblent s'informer les individus qui animent ces huit histoires, dissimulés qu'ils sont dans une part d'eux-mêmes, la plus souffrante. Celle qui n'est plus qu'un souvenir terrifiant. Des voies empruntées, tels des chemins encombrés de pierres coupantes ou de tessons, suffisent-elles à nous armer de forces insoupçonnées pour repousser le Mal, personnifié ici par Le Sombre, qui, de son épieu grossier, essaie de nous atteindre et de nous tuer ? La misère est grande dans la vie d'Esperanza, adolescente d'une quinzaine d'années. Partagée entre la haine et l'amour qu'elle ressent pour sa mère, elle tente de la venger d'un homme qui l'a sauvagement brutalisée, a dévasté leur appartement. Une apparition constante inquiète et réconforte Esperanza, un être enraciné au même endroit, parfois seul, parfois flanqué d'un cheval gris, immobile. Ainsi, la première nouvelle, La princesse de béton, apportant un ton visionnaire à l'ensemble du livre, nous entraîne dans un univers où, sous des formes différentes, à des époques parfois révolues, un chevalier errant, banni de son trône, interrompt son périple durant quelques jours, allégeant l'existence d'hommes solitaires, de femmes âgées ou veuves, qui n'aspirent plus à rien, sinon à mourir. Cet être immatériel ou visible, recouvert de métal scintillant, accomplit des miracles ; il secourt Madèle, vieille femme misérable, qui rêve d'avoir un enfant. Une fille. La nuit de la pleine lune se fera complice. Le Chevalier Millénaire, récit qui nous a enchantée tant est profond son symbolisme, présent et passé se tressant autour de la bonté d'un être désintéressé, la fortifiant de son étrange et rassurante présence. Mais il faut partir, toujours s'en aller vers un monde énigmatique que nous, humains, nous ne savons imaginer. La sorcière inspire elle aussi une touchante nouvelle. Maria danse dans un cabaret pour oublier qu'elle ne doit s'attacher à aucun homme, elle ne lui donnerait qu'une fille. Pourtant, elle ne pourra empêcher Martin de l'aimer au point de vouloir braver l'interdit, ce que refusera Maria. Un être qui porte une armure à l'ancienne, et une épée, la surveille. Le héros s'aventure de plain-pied dans le conte fantastique. Un jeune homme n'a aucune conscience de ce qui lui arrive, il est désigné pour sauver le fils d'un prince « vêtu de pièces d'armure brillantes. »
D'un récit à un autre, le lecteur oscille entre l'esprit et l'âme de personnages éphémères, qui se font justiciers de leurs propres avatars. Ils doivent déceler en eux la part de réalité qui les assaille ou le morceau de rêve qui parfois s'effile douloureusement. Le fantasme n'est pas loin, nous savons qu'il se mesure à l'intensité de nos scènes oniriques. L'Horloger, nouvelle éponyme, s'avère le texte le mieux élaboré, décrivant densément la démarche de cet horloger fasciné par le Temps, par ses soubresauts, ses ondes. Une Veuve, à qui il s'est attaché, lui a prédit, adolescent, qu'il accomplirait des merveilles. Les années s'envolent, rien n'arrive de prodigieux. Une guerre, point incendiaire et final, lui apportera-t-elle la réponse qu'il souhaite depuis que ses cheveux ont blanchi ? On ose espérer qu'un enfant orphelin aura le courage et la ténacité d'acheminer le monde terrestre vers un cycle réparateur. Détruire pour mieux reconstruire, non pour conquérir, propos que soulignent les non-dits transcendant ces récits, les hommes nuisibles étant munis d'un épieu, les hommes magnanimes d'une épée flamboyante.
Un symbolisme édifiant n'en finit pas d'éclabousser nos dires, figuration qui se propage hors de nous, emportés que nous sommes dans un éternel combat universel. La lutte entre le Bien et le Mal, celle de toutes les joutes, physiques et morales. C'est aussi l'histoire du Temps, provisoire ou éternel, selon le rôle que nous lui décernons. Le Temps n'est-il pas d'une flexibilité déconcertante chaque fois qu'il s'attribue nos pires ou meilleures intentions ?
Un premier recueil étonnant à lire. Le lecteur y découvrira une musicalité sereine de l'écriture, un clin d'œil philosophique, d'heureuses trouvailles poétiques. Et pourquoi pas, un ancien charme se référant à quelques textes moyenâgeux. Ce qui, de notre part, est un compliment.
L'Horloger, Félix Villeneuve
Éditions XYZ, Montréal, 2014, 150 pages
Critique de livres, romans, nouvelles, récits.
Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Jean Cocteau
lundi 15 décembre 2014
lundi 8 décembre 2014
Éternelles histoires *** 1/2
Ces dernières semaines, on s'est appesantie sur les dérives du cœur et sur leurs conséquences. On revient à l'ordinaire de la vie, le cœur se révélant un viscère musculaire, qui bat pour que nous survivions, mission honorable. Laissons-le à son rôle de métronome, la tendance surfaite étant de le malmener, de le responsabiliser de nos misères humaines. On a lu le roman de Charlotte Gingras, No man's land.
Jeunes ou moins jeunes, à un moment de leur vie, moult femmes ont été outragées par les agissements d'hommes sans scrupules. Désir d'indépendance loin d'une compagne vieillissante, désir irrépressible de violenter une jeune fille. Lésées, rejetées, les deux femmes que met en scène Charlotte Gingras — exemples parmi tant d'autres —, se prénomment Éden et Jeanne. Un numéro ferait aussi bien l'affaire quand, piétonnières égarées à travers la ville inhospitalière, elles essaient de camoufler leur misère derrière un sourire ravagé de larmes ou derrière un visage hermétique comme une route fermée à ses extrémités. Éden, adolescente de quatorze ans, vit avec sa mère monoparentale alcoolique, ses deux sœurs et un frère, dans un quartier défavorisé de la ville. Avec sa petite sœur Fleur, elle fréquente à longueur de journée la bibliothèque pour y trouver un peu de chaleur, toutes les chaleurs, la bibliothécaire ayant saisi la misère des jeunes filles. Éden lit des romans d'amour, Fleur feuillette des livres traitant d'animaux. Fleur possède une innocence déjà flétrie, Éden rêve d'un prince charmant qui l'enlèverait à son univers sordide. Dans le parc où le soir elle se réfugie, son seul ami est un vieil arbre qu'elle appelle Grand-Père, cherchant en son écorce rugueuse, un semblant de tendresse. Elle y rencontrera un prince charmant qui abusera de sa crédulité, qui disparaîtra aussi promptement qu'il est apparu, laissant Éden désemparée. En parallèle, Jeanne, femme d'un certain âge, vieillit paisiblement dans sa maison du Nord. Après plusieurs années de vie commune, son compagnon lui fait savoir qu'il ne l'aime plus. Bouleversée, elle le quitte, se retrouve en ville avec deux valises et un sac à dos. Jeanne s'abritera quelque temps dans un appartement que des amis absents ont mis à sa disposition.
L'histoire se déroule en hiver, accentuant la condition précaire des deux protagonistes. Ce jour-là, veille du Jour de l'an, Éden quête dans le métro, Jeanne descend d'un wagon, se dirige vers la sortie. Embarrassée de ses bagages, elle bloque le passage. Éden lui offre son aide, elle reçoit un refus poli, stigmatisé d'un sourire triste. Un peu plus tard, intriguée, Éden sortira du métro, apercevra la vieille femme qui patauge péniblement dans la neige, les roulettes de l'une de ses valises s'embourbant dans la « sloche ». Éden courra la secourir. Lui offrira de boire un café dans un bistrot tout proche. Quelques minutes partagées ensemble, Éden et Jeanne ignorent qu'elles se reverront bientôt, pour essayer de colmater leur souffrance réciproque. Un périple douloureux les attend, surtout celui qu'elles affronteront sur l'île où Jeanne possède une cabane. Au temps du bonheur, elle aimait y flâner, observer le lent déploiement de la nature, l'agitation bruyante des oiseaux, la visite inopinée d'animaux sauvages. Cette fois, Jeanne n'y séjournera pas seule, elle deviendra « une famille d'accueil pendant l'été. »
Temps mort pour Éden qui, à la suite d'un incident citadin, refuse de parler, silence que Jeanne devra courageusement endurer. Les pierres transportées jusqu'au rivage, dessineront un cercle où les deux femmes, l'âme transie, s'enfermeront, Éden incapable de formuler un sentiment quelconque, Jeanne, constamment en révolte contre l'homme qui l'a pour toujours repoussée. On a l'impression que le silence têtu d'Éden stimule la réflexion amère de Jeanne, lui laisse entrevoir quelques rais lumineux qu'Éden, étouffant dans sa nuit infernale, ne sait encore déceler. Morte, elle l'était avant de rencontrer Jeanne, comment pourrait-elle revenir à la vie ? Comment Jeanne saurait-elle confier sa propre histoire à plus désespérée qu'elle-même ? La fiction ne contient aucun apaisement lorsque Jeanne lit à voix haute, il s'agit d'êtres humains qu'Éden, croit-elle, a abandonnés à leur sort tragique, et qu'elle aime encore. Pourquoi les avoir trahis, tués ? À quoi sert la parole quand nous ne pouvons rien pour nous-même ? Que dire de l'impuissance coupable éprouvée en face des autres ?
Récit découpé en trois parties. Le drame d'Éden occupe la première, celui de Jeanne trame la deuxième, la troisième réunit Éden et Jeanne, amalgamant deux histoires de solitude extrême. Une chaloupe, représentée par des pierres amassées par Jeanne et Éden, symbolise une probable noyade, l'esquif risquant de couler à la moindre imprudence verbale ou gestuelle de l'une ou de l'autre. La violence, du commencement à la fin du livre, est constamment sous-jacente, provoquée par des objets, des comportements, à l'affût de paroles maladroites, de regards poignants, tel un appel au secours qui n'atteindrait pas son but. Les autres, les insulaires, apportent leur part de générosité quand il s'agit de faciliter, d'embellir utilement le quotidien. Roman de la tendresse rédigé par une écrivaine aguerrie à l'écriture de romans jeunesse depuis une vingtaine d'années. On ne sait pour quelle raison, Charlotte Gingras a désiré écrire, destinée à un plus large public, une histoire aussi triste et vertigineuse, modulée d'espérance, se rattachant au désarroi implacable de deux femmes écorchées, abîmées par des partenaires de longue date ou de simple passage. Mais le pari, s'il y en a un, est amplement réussi. La lecture s'avère émouvante, on osera avancer, captivante.
No man's land, Charlotte Gingras
Éditions Druide, Montréal, 2014, 160 pages.
Jeunes ou moins jeunes, à un moment de leur vie, moult femmes ont été outragées par les agissements d'hommes sans scrupules. Désir d'indépendance loin d'une compagne vieillissante, désir irrépressible de violenter une jeune fille. Lésées, rejetées, les deux femmes que met en scène Charlotte Gingras — exemples parmi tant d'autres —, se prénomment Éden et Jeanne. Un numéro ferait aussi bien l'affaire quand, piétonnières égarées à travers la ville inhospitalière, elles essaient de camoufler leur misère derrière un sourire ravagé de larmes ou derrière un visage hermétique comme une route fermée à ses extrémités. Éden, adolescente de quatorze ans, vit avec sa mère monoparentale alcoolique, ses deux sœurs et un frère, dans un quartier défavorisé de la ville. Avec sa petite sœur Fleur, elle fréquente à longueur de journée la bibliothèque pour y trouver un peu de chaleur, toutes les chaleurs, la bibliothécaire ayant saisi la misère des jeunes filles. Éden lit des romans d'amour, Fleur feuillette des livres traitant d'animaux. Fleur possède une innocence déjà flétrie, Éden rêve d'un prince charmant qui l'enlèverait à son univers sordide. Dans le parc où le soir elle se réfugie, son seul ami est un vieil arbre qu'elle appelle Grand-Père, cherchant en son écorce rugueuse, un semblant de tendresse. Elle y rencontrera un prince charmant qui abusera de sa crédulité, qui disparaîtra aussi promptement qu'il est apparu, laissant Éden désemparée. En parallèle, Jeanne, femme d'un certain âge, vieillit paisiblement dans sa maison du Nord. Après plusieurs années de vie commune, son compagnon lui fait savoir qu'il ne l'aime plus. Bouleversée, elle le quitte, se retrouve en ville avec deux valises et un sac à dos. Jeanne s'abritera quelque temps dans un appartement que des amis absents ont mis à sa disposition.
L'histoire se déroule en hiver, accentuant la condition précaire des deux protagonistes. Ce jour-là, veille du Jour de l'an, Éden quête dans le métro, Jeanne descend d'un wagon, se dirige vers la sortie. Embarrassée de ses bagages, elle bloque le passage. Éden lui offre son aide, elle reçoit un refus poli, stigmatisé d'un sourire triste. Un peu plus tard, intriguée, Éden sortira du métro, apercevra la vieille femme qui patauge péniblement dans la neige, les roulettes de l'une de ses valises s'embourbant dans la « sloche ». Éden courra la secourir. Lui offrira de boire un café dans un bistrot tout proche. Quelques minutes partagées ensemble, Éden et Jeanne ignorent qu'elles se reverront bientôt, pour essayer de colmater leur souffrance réciproque. Un périple douloureux les attend, surtout celui qu'elles affronteront sur l'île où Jeanne possède une cabane. Au temps du bonheur, elle aimait y flâner, observer le lent déploiement de la nature, l'agitation bruyante des oiseaux, la visite inopinée d'animaux sauvages. Cette fois, Jeanne n'y séjournera pas seule, elle deviendra « une famille d'accueil pendant l'été. »
Temps mort pour Éden qui, à la suite d'un incident citadin, refuse de parler, silence que Jeanne devra courageusement endurer. Les pierres transportées jusqu'au rivage, dessineront un cercle où les deux femmes, l'âme transie, s'enfermeront, Éden incapable de formuler un sentiment quelconque, Jeanne, constamment en révolte contre l'homme qui l'a pour toujours repoussée. On a l'impression que le silence têtu d'Éden stimule la réflexion amère de Jeanne, lui laisse entrevoir quelques rais lumineux qu'Éden, étouffant dans sa nuit infernale, ne sait encore déceler. Morte, elle l'était avant de rencontrer Jeanne, comment pourrait-elle revenir à la vie ? Comment Jeanne saurait-elle confier sa propre histoire à plus désespérée qu'elle-même ? La fiction ne contient aucun apaisement lorsque Jeanne lit à voix haute, il s'agit d'êtres humains qu'Éden, croit-elle, a abandonnés à leur sort tragique, et qu'elle aime encore. Pourquoi les avoir trahis, tués ? À quoi sert la parole quand nous ne pouvons rien pour nous-même ? Que dire de l'impuissance coupable éprouvée en face des autres ?
Récit découpé en trois parties. Le drame d'Éden occupe la première, celui de Jeanne trame la deuxième, la troisième réunit Éden et Jeanne, amalgamant deux histoires de solitude extrême. Une chaloupe, représentée par des pierres amassées par Jeanne et Éden, symbolise une probable noyade, l'esquif risquant de couler à la moindre imprudence verbale ou gestuelle de l'une ou de l'autre. La violence, du commencement à la fin du livre, est constamment sous-jacente, provoquée par des objets, des comportements, à l'affût de paroles maladroites, de regards poignants, tel un appel au secours qui n'atteindrait pas son but. Les autres, les insulaires, apportent leur part de générosité quand il s'agit de faciliter, d'embellir utilement le quotidien. Roman de la tendresse rédigé par une écrivaine aguerrie à l'écriture de romans jeunesse depuis une vingtaine d'années. On ne sait pour quelle raison, Charlotte Gingras a désiré écrire, destinée à un plus large public, une histoire aussi triste et vertigineuse, modulée d'espérance, se rattachant au désarroi implacable de deux femmes écorchées, abîmées par des partenaires de longue date ou de simple passage. Mais le pari, s'il y en a un, est amplement réussi. La lecture s'avère émouvante, on osera avancer, captivante.
No man's land, Charlotte Gingras
Éditions Druide, Montréal, 2014, 160 pages.
lundi 1 décembre 2014
Funambule des mots ****
Elle avait fait un rêve éveillé, une cure de jouvence auprès d'un être jeune. Comme tous les rêves, le sien s'est dissipé, la délaissant à l'amertume du temps présent. Il lui reste à vieillir en espérant que les friperies du visage et du corps ne se confondent pas aux cellules mortes de la feuille, rapportée du parc, qui nous a fait cette confidence mélancolique. On parle du récent roman d'Aki Shimazaki, Azami.
Un homme, fin de la trentaine, marié depuis huit ans, père de deux jeunes enfants, trompe sa femme avec une amie d'école, retrouvée grâce à l'intermédiaire d'un camarade. Cette jeune fille, autrefois brillante étudiante, est aujourd'hui entraîneuse, alors qu'elle envisageait de devenir vétérinaire ou zoologue. Sur ce thème convenu, l'écrivaine nous offre un court roman, émouvant, jamais emphatique. Aki Shimazaki nous fait penser à une funambule qui risquerait de se blesser, tombant sur un tapis jonché de mots. On revient à son livre, on le lit, l'esprit vide de nos préjugés, les yeux neufs, dévorant l'histoire minimaliste comme si rien de plus important n'existait. Et le charme opère une fois encore. On a terminé de lire, on se demande ce qui s'est passé autour de soi pendant quelques heures. Rien, semble-t-il. On évoque ce qui nous a enchantée, au fil des pages, on se souvient.
Mitsuo Kawano, rédacteur dans une revue culturelle, se fait interpeller un soir par un ancien compagnon de classe, Gorô Kida, président apprécié d'une compagnie importatrice d'alcools. Tous les deux sont surpris de se revoir, tous les deux fréquentent des établissements de services sexuels. Gorô est célibataire, il entretient trois maîtresses. Mitsuo aime toujours son épouse Atsuko, il n'empêche qu'ils forment un couple sexless. Pendant qu'Atsuko s'occupe de jardinage professionnel dans leur maison de campagne, son mari travaille intensément, comble ses besoins dans des salons érotiques. Mitsuo et Gorô, se rappelant une année de classe, essaient de mettre des noms sur quelques visages, dont celui de Mitsuko, étudiante belle et secrète, qui n'apparaît sur aucune photo de l'album de l'école. Au fur et à mesure que Gorô interviendra dans la vie de Mitsuo, ce dernier se rendra compte qu'il n'est pas aussi « gentil » que leur adolescence le laissait entrevoir. Mitsuko, enfin conquise, éperdument désirée par Mitsuo, lui confiera quelques désagréments dont elle a été la victime et, plus grave, à quelle personne revient la notoriété de la compagnie que Gorô Kida dirige.
Le dénouement de l'histoire s'avérant sans réelle surprise, cependant renouvelée lorsque Aki Shimazaki la dépeint avec son talent de dentellière. On l'imagine, assise, courbée sous une lampe, brodant des mots les uns devant les autres, dessinant l'étrange petite fleur violette, l'azami, qui donne son nom au titre du livre. Écrivaine tellement affiliée à la poésie qu'on regrette de ne pas en lire de son cru, de ne pas en savourer la teneur discrète, l'auteure si peu démesurée dans ses propos romanesques. Pouvons-nous avancer que Aki Shimazaki nous offre une certaine image du Japon moderne ? On y voit plutôt une intention adroite de démontrer au lecteur attentionné, que le monde a changé, qu'il nous parvienne de l'époque d'Edo ou d'un Japon occidentalisé, pour ne pas dire américanisé. Atsuko, qui gère sa propre entreprise agricole, élève ses deux enfants, n'est-elle pas représentative d'une catégorie de femmes dont l'époux travaille en ville, celles-ci fermant les yeux sur leurs frasques, ce que n'acceptera pas Atsuko. Mitsuo, qui la rejoint chaque fin de semaine, n'est-il pas l'image typique de l'homme satisfait de lui-même, se leurrant sur une hypothétique liberté qu'il pense avoir acquise, persuadé qu'il est un citadin honnête, sa mauvaise conscience l'effleurant de temps à autre.
Aki Shimazaki possède l'art de camoufler les apparences trop lisses pour que nous en percevions davantage les failles derrière une écriture murmurée, rarement exclamée, derrière un style presque elliptique, une observation minutieuse et lucide. Regard amer qu'elle jette sur une société où un homme et une femme, devenus un couple, ne se suffisent plus à eux-mêmes ; il leur faut vivre des sensations trompeuses avant de se reconnaître tels qu'ils étaient dans un monde réaliste, si peu fait pour rêver.
Étant publié en France, aux éditions Actes Sud, ce roman est accessible aux lecteurs et lectrices francophones.
Azami, Aki Shimazaki
Éditions Leméac / Actes Sud, 2014, Montréal / Arles, 136 pages
Un homme, fin de la trentaine, marié depuis huit ans, père de deux jeunes enfants, trompe sa femme avec une amie d'école, retrouvée grâce à l'intermédiaire d'un camarade. Cette jeune fille, autrefois brillante étudiante, est aujourd'hui entraîneuse, alors qu'elle envisageait de devenir vétérinaire ou zoologue. Sur ce thème convenu, l'écrivaine nous offre un court roman, émouvant, jamais emphatique. Aki Shimazaki nous fait penser à une funambule qui risquerait de se blesser, tombant sur un tapis jonché de mots. On revient à son livre, on le lit, l'esprit vide de nos préjugés, les yeux neufs, dévorant l'histoire minimaliste comme si rien de plus important n'existait. Et le charme opère une fois encore. On a terminé de lire, on se demande ce qui s'est passé autour de soi pendant quelques heures. Rien, semble-t-il. On évoque ce qui nous a enchantée, au fil des pages, on se souvient.
Mitsuo Kawano, rédacteur dans une revue culturelle, se fait interpeller un soir par un ancien compagnon de classe, Gorô Kida, président apprécié d'une compagnie importatrice d'alcools. Tous les deux sont surpris de se revoir, tous les deux fréquentent des établissements de services sexuels. Gorô est célibataire, il entretient trois maîtresses. Mitsuo aime toujours son épouse Atsuko, il n'empêche qu'ils forment un couple sexless. Pendant qu'Atsuko s'occupe de jardinage professionnel dans leur maison de campagne, son mari travaille intensément, comble ses besoins dans des salons érotiques. Mitsuo et Gorô, se rappelant une année de classe, essaient de mettre des noms sur quelques visages, dont celui de Mitsuko, étudiante belle et secrète, qui n'apparaît sur aucune photo de l'album de l'école. Au fur et à mesure que Gorô interviendra dans la vie de Mitsuo, ce dernier se rendra compte qu'il n'est pas aussi « gentil » que leur adolescence le laissait entrevoir. Mitsuko, enfin conquise, éperdument désirée par Mitsuo, lui confiera quelques désagréments dont elle a été la victime et, plus grave, à quelle personne revient la notoriété de la compagnie que Gorô Kida dirige.
Le dénouement de l'histoire s'avérant sans réelle surprise, cependant renouvelée lorsque Aki Shimazaki la dépeint avec son talent de dentellière. On l'imagine, assise, courbée sous une lampe, brodant des mots les uns devant les autres, dessinant l'étrange petite fleur violette, l'azami, qui donne son nom au titre du livre. Écrivaine tellement affiliée à la poésie qu'on regrette de ne pas en lire de son cru, de ne pas en savourer la teneur discrète, l'auteure si peu démesurée dans ses propos romanesques. Pouvons-nous avancer que Aki Shimazaki nous offre une certaine image du Japon moderne ? On y voit plutôt une intention adroite de démontrer au lecteur attentionné, que le monde a changé, qu'il nous parvienne de l'époque d'Edo ou d'un Japon occidentalisé, pour ne pas dire américanisé. Atsuko, qui gère sa propre entreprise agricole, élève ses deux enfants, n'est-elle pas représentative d'une catégorie de femmes dont l'époux travaille en ville, celles-ci fermant les yeux sur leurs frasques, ce que n'acceptera pas Atsuko. Mitsuo, qui la rejoint chaque fin de semaine, n'est-il pas l'image typique de l'homme satisfait de lui-même, se leurrant sur une hypothétique liberté qu'il pense avoir acquise, persuadé qu'il est un citadin honnête, sa mauvaise conscience l'effleurant de temps à autre.
Aki Shimazaki possède l'art de camoufler les apparences trop lisses pour que nous en percevions davantage les failles derrière une écriture murmurée, rarement exclamée, derrière un style presque elliptique, une observation minutieuse et lucide. Regard amer qu'elle jette sur une société où un homme et une femme, devenus un couple, ne se suffisent plus à eux-mêmes ; il leur faut vivre des sensations trompeuses avant de se reconnaître tels qu'ils étaient dans un monde réaliste, si peu fait pour rêver.
Étant publié en France, aux éditions Actes Sud, ce roman est accessible aux lecteurs et lectrices francophones.
Azami, Aki Shimazaki
Éditions Leméac / Actes Sud, 2014, Montréal / Arles, 136 pages
lundi 24 novembre 2014
Rêves et tourmentes ***
La semaine dernière, performance-lecture de Lydie Jean-Dit-Pannel, intitulée Born like this, en présence de l'artiste
tatoueur Yann Black. Tatouages et papillons monarques. Fasciné et intrigué, vous nous avez demandé comment on s'y prenait pour se faire inviter à de tels événements originaux. Modeste, on vous a confié qu'on avait révisé le texte poétique de Lydie Jean-Dit-Pannel. Vous nous avez
regardé avec une admiration muette. On parle du roman de Martin Doyon, Les improductifs.
Avant que l'automne meure, on a plongé dans la lecture d'une histoire farfelue, délassante. On n'a pu résister au plaisir de partager avec le lecteur les événements tragi-comiques que subit malgré lui le narrateur, Charles Drouin, trente-cinq ans, veuf et père d'une fillette de huit ans, Jeanne. Il a un défaut, ne pas aimer travailler. Une marotte, n'aimer que dormir. Sa mère vit seule, son frère, Hugo, s'avère un exemple de réussite. Son meilleur ami, Norbert, bédéiste, ne vaut pas mieux que lui, tous les deux s'acharnent à trouver un sujet pour le prochain album de Norbert, l'inspiration leur manque. Charles s'efforce à travailler occasionnellement pour subvenir aux besoins de sa fille, qui élève des chinchillas. Sans illusions sur lui-même, il se considère comme un improductif. Un matin, il réalisera, ahuri, qu'après s'être endormi, ses rêves se conforment à ses désirs ce qui, inévitablement, engendrera d'insolites catastrophes desquelles il parvient mal à se dépêtrer. De ces faveurs oniriques, il en fera profiter sa fille qui a demandé une bourse gouvernementale pour acheter des chinchillas, pour faire élire son frère Hugo maire de sa ville. Homme de ménage nouvellement engagé dans une compagnie de Services d'entretien, Charles devra faire face à la terrifiante Charmaine qui dirige les employés durement, les humiliant sans cesse. Mais que faire de moins indigne pour améliorer son sort ? Bibliothécaire, ce dont il se targue auprès de Jeanne pour ne pas qu'elle soit ridiculisée à l'école. L'intervention de Charmaine dans la vie de Charles déclenchera une suite de situations burlesques, qu'avec habileté, il arrive à contourner. Parmi ses rêves, se manifeste en chair et en os, l'héroïne des bandes dessinées de Norbert, Kyoko Sensei, cosmonaute japonaise du XXIIe siècle. Il s'éprendra d'elle, jeune femme pudique, étrangère à l'image idéalisée par Norbert. Elle-même improductive, elle jouera un rôle déterminant dans les rêves de Charles, celui-ci cherchant son père qu'il croit avoir reconnu sur une photo de groupe chez un client de Charmaine. Ce père, « redoutable dormeur », a fui une vie monotone auprès de son épouse et de ses deux garçons. Le déshonneur l'a poursuivi quand il a été surpris dans son bureau en train de dormir sur un pneumatique. Ayant été la risée de ses collègues, outragés, ses patrons l'ont congédié. Il a préféré disparaître, emportant avec lui ses rêves inaccomplis, se détournant d'une vie familiale pour laquelle il avait peu d'affinités. Tous ces fils tendus, reliés entre eux, se démêlent afin que Charles s'affirme en tant que père et qu'être humain.
Il serait vain de développer les nombreuses péripéties que devra confronter cet anti-héros par excellence, pour parvenir à ses fins contradictoires, combien humaines. Elles ne sont pas toujours cocasses mais l'auteur a su, grâce à un style primesautier, leur donner la sapidité d'une généreuse tendresse filiale et sociale. Ce personnage improductif don quichottesque s'agite dans un monde en mouvement souvent abusif : trop vouloir obtenir et posséder. Monde productif où la bêtise et le pouvoir alternent, comme si ces pharisaïsmes se passaient l'un de l'autre. On a aimé que Martin Doyon aille jusqu'au bout de ses intentions humanitaires, affilie le rose de l'attention paternelle et amicale au noir d'une réalité peu équitable. Aucun pathos ne transforme ce récit improbable en une histoire quelconque, d'où notre regard indulgent sur quelques longueurs et dispersions qui auraient pu être évitées. Une histoire drolatique occupée par des protagonistes insouciants, toujours responsables, n'empêche en rien un excellent travail éditorial, ce qui n'est pas le cas ici. Resserrer ce délayage eût apporté une dimension rigoureuse, émouvante, à une surabondance de dires attendrissants, agaçants parce que trop explétifs.
Cependant, pour qui aime apprendre ce qui engage l'être humain dans ses retranchements de survie, manière d'échapper à la désespérante grisaille de l'existence, on recommande ce roman savoureux qui, sous le couvert d'incidents anecdotiques, nous informe de sujets graves, voire pathétiques.
Les improductifs, Martin Doyon
Éditions Hurtubise, Montréal, 2014, 352 pages
Avant que l'automne meure, on a plongé dans la lecture d'une histoire farfelue, délassante. On n'a pu résister au plaisir de partager avec le lecteur les événements tragi-comiques que subit malgré lui le narrateur, Charles Drouin, trente-cinq ans, veuf et père d'une fillette de huit ans, Jeanne. Il a un défaut, ne pas aimer travailler. Une marotte, n'aimer que dormir. Sa mère vit seule, son frère, Hugo, s'avère un exemple de réussite. Son meilleur ami, Norbert, bédéiste, ne vaut pas mieux que lui, tous les deux s'acharnent à trouver un sujet pour le prochain album de Norbert, l'inspiration leur manque. Charles s'efforce à travailler occasionnellement pour subvenir aux besoins de sa fille, qui élève des chinchillas. Sans illusions sur lui-même, il se considère comme un improductif. Un matin, il réalisera, ahuri, qu'après s'être endormi, ses rêves se conforment à ses désirs ce qui, inévitablement, engendrera d'insolites catastrophes desquelles il parvient mal à se dépêtrer. De ces faveurs oniriques, il en fera profiter sa fille qui a demandé une bourse gouvernementale pour acheter des chinchillas, pour faire élire son frère Hugo maire de sa ville. Homme de ménage nouvellement engagé dans une compagnie de Services d'entretien, Charles devra faire face à la terrifiante Charmaine qui dirige les employés durement, les humiliant sans cesse. Mais que faire de moins indigne pour améliorer son sort ? Bibliothécaire, ce dont il se targue auprès de Jeanne pour ne pas qu'elle soit ridiculisée à l'école. L'intervention de Charmaine dans la vie de Charles déclenchera une suite de situations burlesques, qu'avec habileté, il arrive à contourner. Parmi ses rêves, se manifeste en chair et en os, l'héroïne des bandes dessinées de Norbert, Kyoko Sensei, cosmonaute japonaise du XXIIe siècle. Il s'éprendra d'elle, jeune femme pudique, étrangère à l'image idéalisée par Norbert. Elle-même improductive, elle jouera un rôle déterminant dans les rêves de Charles, celui-ci cherchant son père qu'il croit avoir reconnu sur une photo de groupe chez un client de Charmaine. Ce père, « redoutable dormeur », a fui une vie monotone auprès de son épouse et de ses deux garçons. Le déshonneur l'a poursuivi quand il a été surpris dans son bureau en train de dormir sur un pneumatique. Ayant été la risée de ses collègues, outragés, ses patrons l'ont congédié. Il a préféré disparaître, emportant avec lui ses rêves inaccomplis, se détournant d'une vie familiale pour laquelle il avait peu d'affinités. Tous ces fils tendus, reliés entre eux, se démêlent afin que Charles s'affirme en tant que père et qu'être humain.
Il serait vain de développer les nombreuses péripéties que devra confronter cet anti-héros par excellence, pour parvenir à ses fins contradictoires, combien humaines. Elles ne sont pas toujours cocasses mais l'auteur a su, grâce à un style primesautier, leur donner la sapidité d'une généreuse tendresse filiale et sociale. Ce personnage improductif don quichottesque s'agite dans un monde en mouvement souvent abusif : trop vouloir obtenir et posséder. Monde productif où la bêtise et le pouvoir alternent, comme si ces pharisaïsmes se passaient l'un de l'autre. On a aimé que Martin Doyon aille jusqu'au bout de ses intentions humanitaires, affilie le rose de l'attention paternelle et amicale au noir d'une réalité peu équitable. Aucun pathos ne transforme ce récit improbable en une histoire quelconque, d'où notre regard indulgent sur quelques longueurs et dispersions qui auraient pu être évitées. Une histoire drolatique occupée par des protagonistes insouciants, toujours responsables, n'empêche en rien un excellent travail éditorial, ce qui n'est pas le cas ici. Resserrer ce délayage eût apporté une dimension rigoureuse, émouvante, à une surabondance de dires attendrissants, agaçants parce que trop explétifs.
Cependant, pour qui aime apprendre ce qui engage l'être humain dans ses retranchements de survie, manière d'échapper à la désespérante grisaille de l'existence, on recommande ce roman savoureux qui, sous le couvert d'incidents anecdotiques, nous informe de sujets graves, voire pathétiques.
Les improductifs, Martin Doyon
Éditions Hurtubise, Montréal, 2014, 352 pages
mardi 11 novembre 2014
La poésie comme refuge ****
On ne dénoncera jamais assez la médiocrité d'une certaine poésie qui s'affiche dans quelques blogues. Comment ces personnes ne réalisent-elles pas que leurs mots tracés ne possèdent aucune consistance, aucun rythme, sinon la rumeur du vent emportant l'écho à peine audible d'une coquille vide. On parle du recueil de poésie de Normand de Bellefeuille, Le poème est une maison de long séjour.
Il y a plusieurs années, dans le programme de lecture qu'on s'était fixé, la poésie s'excluait. On en lit beaucoup pour notre plaisir, d'où notre liberté de critiquer ce que vaut la rime et les mots qui la musicalisent. Cette fois, on n'a su résister au charme bouleversant du poème et de l'image qu'inaugure, telle une entrée en matière, l'écrivain et poète, l'essayiste et nouvellier, Normand de Bellefeuille, dont la réputation littéraire n'est plus à confirmer. D'abord, s'ordonne une pensée conciliée entre un univers poétique qui s'érige en mots incantatoires, significatifs, et celui de l'image, univers statique, mais combien éloquent, réservé. Peu à peu, les deux éléments se dissocient, le poème éclate, effervescent. Nous avons l'impression d'un tremblement de tous les instants, suggérant le parcours du poète, qui ne cesse de tendre la main vers un lecteur, confident et spectateur à la fois. Long séjour dans la maison, certes, mais aussi vagabondage douloureux dans la mort du père, toujours filigranée. Sans illusions, le poète ne perçoit pas ses écrits telle une rédemption, mais comme un hommage qu'il rend à la beauté, l'homme n'étant jamais bien loin. S'il nous fallait extraire l'instantanéité révoltée, rebuffade au « presque rien du poème », on ne saurait s'y prendre, chaque mot si dense, imagé sans l'image, illustre la maison-fleuve, celle qui amasse la joie d'aimer, où s'accomplit et se dénoue toute souffrance, où s'interroge l'incertitude sans ne jamais la résoudre.
« Témoignages des jours anciens », ce sont les « inventaires » qui définissent le poème en une savante et intelligente harmonie car écrire/n'est-ce pas/précisément/dénommer/dévisager ? Cette interrogation nous poursuit, révélant l'impuissance du poète qui défie le passage irréversible du temps, affronte quelques-uns de ses désirs inaccomplis. Plus paisible, le poète évoque la maladresse ailée de l'albatros, le sel interdisant de regarder derrière l'épaule. Le mensonge qui nous aide à survivre. Provocateur, le poète invite le lecteur à mentir avant de mourir, « une toute dernière fois ». La présence inévitable de l'humain nous conduit vers la mort, plus précisément vers la tombe que chacun porte en soi. Exaltant la lenteur de l'agonie, le poème devient subversif, envoûtant, il démantèle les paroles et leurs excès, le poète, nous invitant à savoir écouter, à nous taire, ce qui ne s'apprend pas. On cite : je préfère les poèmes/aux mots presque muets/qu'aux bavardages de certains/autres/trop convaincus/de leur propre et indiscutable/rectitude. Ne doutant pas de ses bienfaits, le silence s'avère plus éloquent que tout discours, aussi bref soit-il. Clairvoyant, lancinant, le poème guide le poète, secret et si myope, dans le dédale du long parcours de la maison aimée. Celle-ci symbolisant l'entièreté de la vie, le poème jamais ne s'échappera des murs haussés, commensal éclairé qui se meut, nanti de mots, gratifié d'un tempo respiratoire alangui, nous autorisant à sonder la tristesse du poète s'abandonnant à lui-même. pourquoi donc/est-ce que ce sont mes morts/qui tant me tuent ? On pense aux amis clairsemés de Rutebeuf, aux lais loufoques de Villon, la jeunesse ayant assouvi son œuvre de crispation. Elle est tellement alerte cette pensée émouvante, tellement fervente en notre mémoire, qu'elle intervient comme une fausse prière/pour débusquer l'intrus/et le mauvais danseur. Le corps est autiste, il se balance en la lecture scandée de la rime. Vieil homme, le poète écoute la parole qu'exige le poème. cette fois/la dernière, dit-il/c'est le poème qui te parle/écoute-le donc !/et j'ai écouté.../fini. On rêve d'un retour vers la sérénité de l'image. Celle-là et le poème étant « irraison [ et ] pacte... »
Nous attardant longuement dans la maison accueillante du poème, la vie s'en est allée, digne et noble, la poésie de Normand de Bellefeuille l'ayant paraphée de son talent inimitable, de sa plume inspirée, constamment axée sur le mot juste et fort. Vivant, dynamique. Le style est fluide, limpide, enrubanné de vocables essentiels. Sans discontinuité dans le ton, magnifié par la spiritualité que contient l'esprit, libéré de sa formelle essence, le poème exécrant la banalité du phrasé convenu et amorphe. Le lecteur, peu habitué à l'intensité d'une telle lecture, ne sera dépaysé qu'en lui-même, le poème s'intitulant patience et grâce lorsqu'il est traité avec la conviction humble du poète soumis à l'élaboration de son œuvre.
On salue le talent de « l'homme des images », Pierre P Fortin, accompagnateur avisé et complice vigilant de Normand de Bellefeuille.
Le poème est une maison de long séjour, Normand de Bellefeuille
Œuvres de Pierre P Fortin
Éditions du Noroît, Montréal, 2014, 154 pages
Il y a plusieurs années, dans le programme de lecture qu'on s'était fixé, la poésie s'excluait. On en lit beaucoup pour notre plaisir, d'où notre liberté de critiquer ce que vaut la rime et les mots qui la musicalisent. Cette fois, on n'a su résister au charme bouleversant du poème et de l'image qu'inaugure, telle une entrée en matière, l'écrivain et poète, l'essayiste et nouvellier, Normand de Bellefeuille, dont la réputation littéraire n'est plus à confirmer. D'abord, s'ordonne une pensée conciliée entre un univers poétique qui s'érige en mots incantatoires, significatifs, et celui de l'image, univers statique, mais combien éloquent, réservé. Peu à peu, les deux éléments se dissocient, le poème éclate, effervescent. Nous avons l'impression d'un tremblement de tous les instants, suggérant le parcours du poète, qui ne cesse de tendre la main vers un lecteur, confident et spectateur à la fois. Long séjour dans la maison, certes, mais aussi vagabondage douloureux dans la mort du père, toujours filigranée. Sans illusions, le poète ne perçoit pas ses écrits telle une rédemption, mais comme un hommage qu'il rend à la beauté, l'homme n'étant jamais bien loin. S'il nous fallait extraire l'instantanéité révoltée, rebuffade au « presque rien du poème », on ne saurait s'y prendre, chaque mot si dense, imagé sans l'image, illustre la maison-fleuve, celle qui amasse la joie d'aimer, où s'accomplit et se dénoue toute souffrance, où s'interroge l'incertitude sans ne jamais la résoudre.
« Témoignages des jours anciens », ce sont les « inventaires » qui définissent le poème en une savante et intelligente harmonie car écrire/n'est-ce pas/précisément/dénommer/dévisager ? Cette interrogation nous poursuit, révélant l'impuissance du poète qui défie le passage irréversible du temps, affronte quelques-uns de ses désirs inaccomplis. Plus paisible, le poète évoque la maladresse ailée de l'albatros, le sel interdisant de regarder derrière l'épaule. Le mensonge qui nous aide à survivre. Provocateur, le poète invite le lecteur à mentir avant de mourir, « une toute dernière fois ». La présence inévitable de l'humain nous conduit vers la mort, plus précisément vers la tombe que chacun porte en soi. Exaltant la lenteur de l'agonie, le poème devient subversif, envoûtant, il démantèle les paroles et leurs excès, le poète, nous invitant à savoir écouter, à nous taire, ce qui ne s'apprend pas. On cite : je préfère les poèmes/aux mots presque muets/qu'aux bavardages de certains/autres/trop convaincus/de leur propre et indiscutable/rectitude. Ne doutant pas de ses bienfaits, le silence s'avère plus éloquent que tout discours, aussi bref soit-il. Clairvoyant, lancinant, le poème guide le poète, secret et si myope, dans le dédale du long parcours de la maison aimée. Celle-ci symbolisant l'entièreté de la vie, le poème jamais ne s'échappera des murs haussés, commensal éclairé qui se meut, nanti de mots, gratifié d'un tempo respiratoire alangui, nous autorisant à sonder la tristesse du poète s'abandonnant à lui-même. pourquoi donc/est-ce que ce sont mes morts/qui tant me tuent ? On pense aux amis clairsemés de Rutebeuf, aux lais loufoques de Villon, la jeunesse ayant assouvi son œuvre de crispation. Elle est tellement alerte cette pensée émouvante, tellement fervente en notre mémoire, qu'elle intervient comme une fausse prière/pour débusquer l'intrus/et le mauvais danseur. Le corps est autiste, il se balance en la lecture scandée de la rime. Vieil homme, le poète écoute la parole qu'exige le poème. cette fois/la dernière, dit-il/c'est le poème qui te parle/écoute-le donc !/et j'ai écouté.../fini. On rêve d'un retour vers la sérénité de l'image. Celle-là et le poème étant « irraison [ et ] pacte... »
Nous attardant longuement dans la maison accueillante du poème, la vie s'en est allée, digne et noble, la poésie de Normand de Bellefeuille l'ayant paraphée de son talent inimitable, de sa plume inspirée, constamment axée sur le mot juste et fort. Vivant, dynamique. Le style est fluide, limpide, enrubanné de vocables essentiels. Sans discontinuité dans le ton, magnifié par la spiritualité que contient l'esprit, libéré de sa formelle essence, le poème exécrant la banalité du phrasé convenu et amorphe. Le lecteur, peu habitué à l'intensité d'une telle lecture, ne sera dépaysé qu'en lui-même, le poème s'intitulant patience et grâce lorsqu'il est traité avec la conviction humble du poète soumis à l'élaboration de son œuvre.
On salue le talent de « l'homme des images », Pierre P Fortin, accompagnateur avisé et complice vigilant de Normand de Bellefeuille.
Le poème est une maison de long séjour, Normand de Bellefeuille
Œuvres de Pierre P Fortin
Éditions du Noroît, Montréal, 2014, 154 pages
lundi 3 novembre 2014
La mémoire fragmentée ****
Il est jeune, séduisant, cultivé, nous dit-elle, les yeux pétillants de tendresse. On la regarde, étonnée. De qui parle-t-elle au juste ? Cette femme, qu'on ne connaît qu'à travers sa profession, nous confie une part intime de son âme, ce qu'on n'aurait jamais soupçonné. Radieuse, elle ajoute, il est un long poème impossible à écrire, pour lui, il faudrait réinventer le langage. On a lu le dernier récit de Jean-François Beauchemin, Une enfance mal fermée.
C'est toujours avec une curiosité intellectuelle inégalée, un bonheur profond de lecture qu'on ouvre un livre de cet auteur. On ne résiste pas à la lucidité grave ou joyeuse de son regard s'attardant sur le monde, comme si tout à coup ce monde devenait le centre de ce qui nous entoure. Parcourant les pages fragmentées de son discours intérieur, nous accédons aux choses simples de la vie, mais aussi au refus du narrateur à se laisser duper par ce qui lui semble accessoire. D'emblée, il informe le lecteur que sa vie n'est pas très compliquée. À l'aube, son chat Scooter quitte la chaise où il passe ses nuits, vient frotter la joue de l'écrivain, comme s'il lui ordonnait de se lever pour écrire. Les joies quotidiennes sont empreintes de réflexion et de générosité. Y sont rassemblés des détails infimes concernant Manon, la compagne « venue de l'avenir, et qui n'est jamais repartie. » Ses quatre frères et sa sœur. « Un chien, quelques étoiles, et ma mort. »
Le récit aborde l'enfance crédule, souvent escortée de la mère attentive, l'adolescence turbulente, l'étudiant rebelle qui se cherche, se terre au creux d'un talent qu'il ne parvient pas à définir. Il vole sa nourriture dans les épiceries, ceci avoué avec la distanciation que crée le temps élastique, atténuant la gravité de l'acte. Mais que sera l'avenir ? s'interroge le jeune homme. Conscient de sa valeur artistique, nébuleuse et prometteuse, il se range vers un fatalisme serein qu'il ne bouscule d'aucune inquiétude. Plus tard, l'homme qu'il est devenu accumulera les notes éparpillées dans sa mémoire, l'heure étant venue de rendre des comptes.
Le monde tourne tant bien que mal, la présence de Dieu n'étant pas nécessaire à fortifier le lot de beauté que l'écrivain enferme en son âme et, que dans tous ses livres, Beauchemin décrit, tel un désir de combattre « les idées toujours rétrogrades défendues par la religion. » Comment lui donner tort, même si la certitude des croyants en Dieu semble reposante mais combien naïve. Les étoiles révélées par le père, suffisent à remplir les yeux émerveillés du jeune garçon, à calmer les battements de son cœur affolé. L'image de la mère qui a compris que ce fils était différent, constamment présente auprès de l'enfant, de l'adolescent, nous concerne davantage que l'abstraction d'une foi ayant besoin de s'alimenter d'écrits ennuyeux. Le secret de la poésie, la réalité du corps qui a trahi l'écrivain, le bouillonnement du sang, telle une nécessité à expliquer, sans le dénoncer, le secret de ce qui ne peut être divulgué. Le corps, si souvent évoqué, « comme tout ce qui est mortel, était si tragiquement poétique. » Les idées vertigineuses abondent, sillonnent la pensée angoissée, la désolation, si cet homme mourait, de ne plus pouvoir « discuter » avec Manon ; elle est là, telle la femme biblique, celle qui écoute et partage.
C'est une vision introspective et troublante que Beauchemin évoque, tant sur ses précédents titres que sur sa démarche vitale actuelle. Le malheur constant, l'injustice accablante, la douleur corporelle, façonnent la poétique beauté, matière la plus réelle, donc vraie, pour « exiger que la nature humaine se modifie, mais sans la souffrance, qu'elle atteigne cette grande place où le ciel bat comme une porte restée ouverte. »
On a résumé, non la pensée magistralement bienveillante de l'écrivain Jean-François Beauchemin, mais la réflexion inlassable d'un homme anonyme, venu du fond d'âges immémoriaux, méditatif et non distrait par sa venue au monde. Les livres de Beauchemin ont le don de sanctifier ce qui ne saurait l'être. On s'attarde sur leur teneur, on relit des phrases, on ne les encombre surtout pas de nos expériences, on les laisse vagabonder jusqu'à ce qu'un souffle les ôte de notre tête, les emportant, dissemblables, vers un prochain livre. On veille, sentinelle attentive au talent d'un écrivain désintéressé, qui nous apprend sans cesse l'émouvante dispersion de l'homme, mais aussi sa maturité quand il s'agit d'en rassembler les défaites et les victoires.
Plusieurs photos personnelles de l'auteur agrémentent ses textes, leur apportant encore plus d'intensité.
Une enfance mal fermée, Jean-François Beauchemin
Éditions Leméac, Montréal, 2014, 192 pages
C'est toujours avec une curiosité intellectuelle inégalée, un bonheur profond de lecture qu'on ouvre un livre de cet auteur. On ne résiste pas à la lucidité grave ou joyeuse de son regard s'attardant sur le monde, comme si tout à coup ce monde devenait le centre de ce qui nous entoure. Parcourant les pages fragmentées de son discours intérieur, nous accédons aux choses simples de la vie, mais aussi au refus du narrateur à se laisser duper par ce qui lui semble accessoire. D'emblée, il informe le lecteur que sa vie n'est pas très compliquée. À l'aube, son chat Scooter quitte la chaise où il passe ses nuits, vient frotter la joue de l'écrivain, comme s'il lui ordonnait de se lever pour écrire. Les joies quotidiennes sont empreintes de réflexion et de générosité. Y sont rassemblés des détails infimes concernant Manon, la compagne « venue de l'avenir, et qui n'est jamais repartie. » Ses quatre frères et sa sœur. « Un chien, quelques étoiles, et ma mort. »
Le récit aborde l'enfance crédule, souvent escortée de la mère attentive, l'adolescence turbulente, l'étudiant rebelle qui se cherche, se terre au creux d'un talent qu'il ne parvient pas à définir. Il vole sa nourriture dans les épiceries, ceci avoué avec la distanciation que crée le temps élastique, atténuant la gravité de l'acte. Mais que sera l'avenir ? s'interroge le jeune homme. Conscient de sa valeur artistique, nébuleuse et prometteuse, il se range vers un fatalisme serein qu'il ne bouscule d'aucune inquiétude. Plus tard, l'homme qu'il est devenu accumulera les notes éparpillées dans sa mémoire, l'heure étant venue de rendre des comptes.
Le monde tourne tant bien que mal, la présence de Dieu n'étant pas nécessaire à fortifier le lot de beauté que l'écrivain enferme en son âme et, que dans tous ses livres, Beauchemin décrit, tel un désir de combattre « les idées toujours rétrogrades défendues par la religion. » Comment lui donner tort, même si la certitude des croyants en Dieu semble reposante mais combien naïve. Les étoiles révélées par le père, suffisent à remplir les yeux émerveillés du jeune garçon, à calmer les battements de son cœur affolé. L'image de la mère qui a compris que ce fils était différent, constamment présente auprès de l'enfant, de l'adolescent, nous concerne davantage que l'abstraction d'une foi ayant besoin de s'alimenter d'écrits ennuyeux. Le secret de la poésie, la réalité du corps qui a trahi l'écrivain, le bouillonnement du sang, telle une nécessité à expliquer, sans le dénoncer, le secret de ce qui ne peut être divulgué. Le corps, si souvent évoqué, « comme tout ce qui est mortel, était si tragiquement poétique. » Les idées vertigineuses abondent, sillonnent la pensée angoissée, la désolation, si cet homme mourait, de ne plus pouvoir « discuter » avec Manon ; elle est là, telle la femme biblique, celle qui écoute et partage.
C'est une vision introspective et troublante que Beauchemin évoque, tant sur ses précédents titres que sur sa démarche vitale actuelle. Le malheur constant, l'injustice accablante, la douleur corporelle, façonnent la poétique beauté, matière la plus réelle, donc vraie, pour « exiger que la nature humaine se modifie, mais sans la souffrance, qu'elle atteigne cette grande place où le ciel bat comme une porte restée ouverte. »
On a résumé, non la pensée magistralement bienveillante de l'écrivain Jean-François Beauchemin, mais la réflexion inlassable d'un homme anonyme, venu du fond d'âges immémoriaux, méditatif et non distrait par sa venue au monde. Les livres de Beauchemin ont le don de sanctifier ce qui ne saurait l'être. On s'attarde sur leur teneur, on relit des phrases, on ne les encombre surtout pas de nos expériences, on les laisse vagabonder jusqu'à ce qu'un souffle les ôte de notre tête, les emportant, dissemblables, vers un prochain livre. On veille, sentinelle attentive au talent d'un écrivain désintéressé, qui nous apprend sans cesse l'émouvante dispersion de l'homme, mais aussi sa maturité quand il s'agit d'en rassembler les défaites et les victoires.
Plusieurs photos personnelles de l'auteur agrémentent ses textes, leur apportant encore plus d'intensité.
Une enfance mal fermée, Jean-François Beauchemin
Éditions Leméac, Montréal, 2014, 192 pages
lundi 27 octobre 2014
Des héros désenchantés *** 1/2
Humeur. À l'ère discutable des selfies, on ne peut plus s'entretenir d'un sujet avec une tierce personne, homme ou femme, sans que cette personne le ramenât à elle. Et interrompe notre échange. Égotisme mental, nécessité de parler de soi insignifiante. Quand ces individus apprendront-ils à se taire ? À écouter ? On est excédée par tant de nombrilisme immature. Parlons du recueil de récits d'Olivier Demers, Contes violents.
Le moins qu'on puisse dire, c'est de ne pas s'attendre à lire des textes où femmes et hommes, blessés par la vie, se penchent, compassés, sur leurs états d'âme. La littérature québécoise ne nous ayant pas habitués à ce genre de récits où s'agitent des hommes — on dit bien des hommes — aux prises avec des éléments violents de l'Histoire. Cela est supportable, cela nous emporte loin des sentiers battus où l'ordinaire de la vie n'existe pas, ou si peu, que nous oublions qu'ailleurs, toujours ailleurs, des êtres ont pris part à des révolutions, d'autres à des complots. À un moment donné, il faut concrétiser le rêve, le rendre palpable, humain, rien qu'humain. C'est oublier que l'onirisme se fie à la loyauté de nos actes pour essayer de changer le monde. Hélas, le prix à payer se frotte à nos reniements, à nos désertions. À nos failles. Que reste-t-il d'un homme sur un champ de bataille, que ce décor ensanglanté se situe dans l'Antiquité ou dans un monde contemporain ?
On a voulu comprendre ce qui se tramait dans la tête d'un combattant involontaire quand, à la frontière sud de l'Érythrée, il attend un éventuel ennemi dont il a du mal à saisir les enjeux militaires. Ils sont trois à s'observer, à s'analyser. Steve, l'officier, Hogbit, la sentinelle, le narrateur, un désenchanté cynique. Quand les combats auront repris puis cessé, il ne restera plus rien des conjectures, plus rien de deux hommes décimés, le troisième s'étant réfugié au Canada. Bien des années plus tard, hanté par son passé de jeune homme mal aimé, sur le quai d'un métro, le narrateur croit revoir Hogbit, son camarade de combat. La jeune fille et la main, Gombino, fils de paysans incultes, se rappelle comment il a été recruté par « l'armée d'Argentine », comment, pris dans un engrenage irréversible, il a torturé, tué des personnes innocentes. Au point que sa présence dans son pays étant devenue gênante, son avocat lui conseille de partir au Canada où il pourra se « la couler douce ». Si le hasard parfois donne un coup de pouce à la vie, il ne prévoit pas de malencontreuses rencontres. Le remords n'est-il pas réservé aux victimes ? De magnifiques portraits de femmes ensoleillent ces contes. Elles sont sensuelles, passionnées, révolutionnaires. N'est-ce pas le cas tragique de Lupe Sanchez, dépeinte par l'homme qui l'a aimée ? Il risquera sa vie pour la faire sortir d'une prison où, dans les couloirs, jusqu'à la cellule de Lupe, il n'entend que des cris, des lamentations d'innocents écrasés sous la torture. Quand la jeune femme sera libérée, ils devront fuir le Chili. Le Canada, havre de paix, les recevra, mais plus jamais rien ne sera pareil. Les spectres ont eu raison de leur désir intense de changer ce qui pouvait l'être. Il y a aussi l'anarchiste Maria Frédérika Wogel, qui, quarante ans plus tôt, en Allemagne fédérale, a essayé de haranguer la foule bourgeoise, monde de soumis, de mafieux, qu'elle secoue en maudissant l'humanité. Celui qui raconte cette épopée est devenu un homme comme les autres, mais nulle part, ni personne, ne lui a fait oublier « le charme capiteux de Maria Wogel, aux jours de son ultime secousse, avec sa jeunesse héroïque et révolutionnaire. » Un texte pathétique, l'un des rares du recueil, l'histoire de la petite Nagomé qui, blottie contre son père dans un vieux container, attend le marin soudoyé, qui doit les ravitailler. Plus de nourriture, plus d'eau potable, les trois autres clandestins se déchaînent contre Nagomé, qu'ils jugent responsable de la trahison du marin. N'est-elle pas une sorcière ? Nagomé se demande, avec sa foi naïve, si prier ne va pas la sauver une fois encore.
Plus nous avançons dans la lecture de ces contes étonnants et cruels, moins le drame se fait douloureux. L'humour mordant de l'auteur adoucit le malheur. Des événements collectifs nous cernent, nous regardons s'ébrouer des hommes de pouvoir qui, de l'Antiquité au début du vingtième siècle, se sont emparés de l'histoire officielle, vengeant, dirons-nous, des héros morts précédemment pour une cause grandiose. Un idéal qui, nous n'en doutons pas, ne veut plus dire grand-chose. Événements glorieux que nous retrouvons mentionnés sur des monuments, telles des épitaphes gravées dans nos mémoires. Nous apprenons les bévues stratégiques de grands hommes : Hannibal, Spartacus, Napoléon. Des lieux sanguinaires : la bataille de Hastings, la défaite des Français d'Amérique qui « perdirent tout le 13 septembre 1759, à cause de l'intervention de Satan. » Et c'est bien satanique quand Olivier Demers, jubilatoire, relate comment le marquis de Montcalm bat en retraite, pour « rejoindre une gamine délurée »... Le recueil se ferme sur la folie soudaine de Louis Riel qui, s'improvisant chef de guerre, fomente une rébellion contre les colons exploitant honteusement les Métis et les Indiens. Il parcourt les grandes plaines du Canada en brandissant un énorme Christ en plâtre, faisant échouer la stratégie si simple de son ami métis et chasseur expérimenté, Gabriel Dumont. Nous connaissons la fin : Louis Riel subira un procès politique, il sera condamné à être pendu.
Que faut-il retenir censément de ces hommes qui ont vécu par procuration ? De leur pouvoir insensé qui a fini par rattraper ce qu'il y avait de faillible en eux, les contraignant à n'être que des êtres ordinaires, embourbés qu'ils étaient dans un rêve gigantesque que ne pouvaient concevoir leurs subordonnés, incapables de les suivre dans leur dédale de folie furieuse ? Parce que ces récits ne ressemblent en rien à ceux que nous lisons confortablement, l'esprit assoupi, n'attendant pas grand-chose de nouveau, on recommande ce recueil de contes. Il éveille notre conscience apathique, rancarde nos idées toutes faites dans un monde dénaturé que ne renieraient pas les esprits les plus subversifs. C'est dire le remue-ménage intentionnel fomenté par un auteur original, peu enclin à laisser le lecteur se délecter d'histoires conventionnelles, fréquenter des héros routiniers, traditionnels.
Contes violents, Olivier Demers
Éditions Triptyque, Montréal, 2014, 179 pages
Le moins qu'on puisse dire, c'est de ne pas s'attendre à lire des textes où femmes et hommes, blessés par la vie, se penchent, compassés, sur leurs états d'âme. La littérature québécoise ne nous ayant pas habitués à ce genre de récits où s'agitent des hommes — on dit bien des hommes — aux prises avec des éléments violents de l'Histoire. Cela est supportable, cela nous emporte loin des sentiers battus où l'ordinaire de la vie n'existe pas, ou si peu, que nous oublions qu'ailleurs, toujours ailleurs, des êtres ont pris part à des révolutions, d'autres à des complots. À un moment donné, il faut concrétiser le rêve, le rendre palpable, humain, rien qu'humain. C'est oublier que l'onirisme se fie à la loyauté de nos actes pour essayer de changer le monde. Hélas, le prix à payer se frotte à nos reniements, à nos désertions. À nos failles. Que reste-t-il d'un homme sur un champ de bataille, que ce décor ensanglanté se situe dans l'Antiquité ou dans un monde contemporain ?
On a voulu comprendre ce qui se tramait dans la tête d'un combattant involontaire quand, à la frontière sud de l'Érythrée, il attend un éventuel ennemi dont il a du mal à saisir les enjeux militaires. Ils sont trois à s'observer, à s'analyser. Steve, l'officier, Hogbit, la sentinelle, le narrateur, un désenchanté cynique. Quand les combats auront repris puis cessé, il ne restera plus rien des conjectures, plus rien de deux hommes décimés, le troisième s'étant réfugié au Canada. Bien des années plus tard, hanté par son passé de jeune homme mal aimé, sur le quai d'un métro, le narrateur croit revoir Hogbit, son camarade de combat. La jeune fille et la main, Gombino, fils de paysans incultes, se rappelle comment il a été recruté par « l'armée d'Argentine », comment, pris dans un engrenage irréversible, il a torturé, tué des personnes innocentes. Au point que sa présence dans son pays étant devenue gênante, son avocat lui conseille de partir au Canada où il pourra se « la couler douce ». Si le hasard parfois donne un coup de pouce à la vie, il ne prévoit pas de malencontreuses rencontres. Le remords n'est-il pas réservé aux victimes ? De magnifiques portraits de femmes ensoleillent ces contes. Elles sont sensuelles, passionnées, révolutionnaires. N'est-ce pas le cas tragique de Lupe Sanchez, dépeinte par l'homme qui l'a aimée ? Il risquera sa vie pour la faire sortir d'une prison où, dans les couloirs, jusqu'à la cellule de Lupe, il n'entend que des cris, des lamentations d'innocents écrasés sous la torture. Quand la jeune femme sera libérée, ils devront fuir le Chili. Le Canada, havre de paix, les recevra, mais plus jamais rien ne sera pareil. Les spectres ont eu raison de leur désir intense de changer ce qui pouvait l'être. Il y a aussi l'anarchiste Maria Frédérika Wogel, qui, quarante ans plus tôt, en Allemagne fédérale, a essayé de haranguer la foule bourgeoise, monde de soumis, de mafieux, qu'elle secoue en maudissant l'humanité. Celui qui raconte cette épopée est devenu un homme comme les autres, mais nulle part, ni personne, ne lui a fait oublier « le charme capiteux de Maria Wogel, aux jours de son ultime secousse, avec sa jeunesse héroïque et révolutionnaire. » Un texte pathétique, l'un des rares du recueil, l'histoire de la petite Nagomé qui, blottie contre son père dans un vieux container, attend le marin soudoyé, qui doit les ravitailler. Plus de nourriture, plus d'eau potable, les trois autres clandestins se déchaînent contre Nagomé, qu'ils jugent responsable de la trahison du marin. N'est-elle pas une sorcière ? Nagomé se demande, avec sa foi naïve, si prier ne va pas la sauver une fois encore.
Plus nous avançons dans la lecture de ces contes étonnants et cruels, moins le drame se fait douloureux. L'humour mordant de l'auteur adoucit le malheur. Des événements collectifs nous cernent, nous regardons s'ébrouer des hommes de pouvoir qui, de l'Antiquité au début du vingtième siècle, se sont emparés de l'histoire officielle, vengeant, dirons-nous, des héros morts précédemment pour une cause grandiose. Un idéal qui, nous n'en doutons pas, ne veut plus dire grand-chose. Événements glorieux que nous retrouvons mentionnés sur des monuments, telles des épitaphes gravées dans nos mémoires. Nous apprenons les bévues stratégiques de grands hommes : Hannibal, Spartacus, Napoléon. Des lieux sanguinaires : la bataille de Hastings, la défaite des Français d'Amérique qui « perdirent tout le 13 septembre 1759, à cause de l'intervention de Satan. » Et c'est bien satanique quand Olivier Demers, jubilatoire, relate comment le marquis de Montcalm bat en retraite, pour « rejoindre une gamine délurée »... Le recueil se ferme sur la folie soudaine de Louis Riel qui, s'improvisant chef de guerre, fomente une rébellion contre les colons exploitant honteusement les Métis et les Indiens. Il parcourt les grandes plaines du Canada en brandissant un énorme Christ en plâtre, faisant échouer la stratégie si simple de son ami métis et chasseur expérimenté, Gabriel Dumont. Nous connaissons la fin : Louis Riel subira un procès politique, il sera condamné à être pendu.
Que faut-il retenir censément de ces hommes qui ont vécu par procuration ? De leur pouvoir insensé qui a fini par rattraper ce qu'il y avait de faillible en eux, les contraignant à n'être que des êtres ordinaires, embourbés qu'ils étaient dans un rêve gigantesque que ne pouvaient concevoir leurs subordonnés, incapables de les suivre dans leur dédale de folie furieuse ? Parce que ces récits ne ressemblent en rien à ceux que nous lisons confortablement, l'esprit assoupi, n'attendant pas grand-chose de nouveau, on recommande ce recueil de contes. Il éveille notre conscience apathique, rancarde nos idées toutes faites dans un monde dénaturé que ne renieraient pas les esprits les plus subversifs. C'est dire le remue-ménage intentionnel fomenté par un auteur original, peu enclin à laisser le lecteur se délecter d'histoires conventionnelles, fréquenter des héros routiniers, traditionnels.
Contes violents, Olivier Demers
Éditions Triptyque, Montréal, 2014, 179 pages
mardi 14 octobre 2014
Des fils invisibles ****
La personne, une femme, qui bidouille notre page personnelle et qui se figure qu'on est dupe. Si cette personne réalisait à quel degré on la méprise, elle s'occuperait de choses plus valorisantes. Mais pour elle, toutes les manières sont bonnes pour essayer d'attirer notre regard indifférent. On a lu le recueil de nouvelles de Sylvie Massicotte, Avant d'éteindre.
On pourrait résumer ces vingt-quatre nouvelles en quelques lignes, les enjolivant de balbutiements, de voix basses, d'yeux ouverts sur nos mondes intimes, ceux qui parfois nous font rencontrer des êtres empreints d'une profonde tendresse et qui n'osent la dire. Pudeur mais aussi nécessité de se taire face à l'incompréhension de nos semblables. Avec une discrétion qu'on lui connaît, Sylvie Massicotte a regroupé divers textes, comme elle aurait rassemblé autour d'elle des personnes aimées. Elle nous présente ses personnages en les situant au centre d'anecdotes qui les auraient blessés à un moment précis de leur vie. Blessure de l'un, maladresse de l'autre, on s'attarde au texte L'arbre invisible. Une mère frustrée sème sur le chemin de son fils, devenu jeune adulte, des indices révélant un père inexistant. Il est l'homme invisible, l'homme absent qui ne peut se défendre. Tu m'avais dit que tu téléphonerais, le soulagement d'une jeune femme qui attend l'appel de son amant désinvolte et qui, le recevant, ferme son cellulaire. Plus loin, Le porte-bijoux, un père, veuf inconsolable, offre à ses deux grandes filles, des bijoux que leur mère portait. Mais il y a une « petite boucle rouge » tellement dérangeante, débordante de souvenirs, qu'il vaut mieux détourner le regard vers la fenêtre. Dehors, des arbres marqués d'un ruban rouge seront abattus, ils encombrent le paysage. On a aimé Resto-bar des îles. Une mère encore séjourne avec son jeune fils, Félix, dans un village perdu au bord du fleuve. Pour dissiper l'ennui que Félix éprouve loin de ses amis d'école, elle l'emmène manger des frites dans un restaurant quelconque, autrefois dirigé par un ancien amant qu'elle a profondément aimé. Face à la mer, elle s'interroge : est-ce lui le père de l'enfant ? Semblable à la nostalgie de cette femme, son doute est constamment entravé par les allées et venues de la serveuse qui apporte enfin les frites à Félix. Le trophée ou les retrouvailles à Calgary de deux anciens collègues de travail. Jim accueille Antoine dans sa maison, lui présente les photos et les objets rapportés de ses voyages. Des trophées, pense Antoine, qui s'étonne de sa réflexion. Lui-même n'a-t-il pas rapporté des souvenirs de différents pays qu'il a visités ? Entre les deux hommes, aucune complicité, aucun désir de se confier. Seule, la politesse évoque une hôtesse parfaite. Peu à peu, au cours du repas, se dévoilent les intentions de Jim. Un trophée de chasse auquel Antoine veut échapper à tout prix.
En filigrane, s'amorcent des amours anxieuses, des oublis irrémissibles. La femme amère et souriante de la nouvelle Dans le ciel bleu d'automne se promène avec un homme qu'elle a aimé, qu'elle aime encore, alors que lui croque une pomme, sans se soucier du passé. C'est elle qui le recompose. La marionnette signe la fin d'un morceau de musique, d'une poupée articulée, paraphe le courage de Léa tellement le froid la parcourt. Tous les froids représentés par le regard sombre d'un « type à l'air dédaigneux » qui suit la gesticulation de la marionnette activée par Léa. Tilio, dans le récit Les blessures, confié à la maison d'accueil de madame Brunet, regrette le geste brusque qu'il a commis envers Colin, enfant craintif, que traumatise le simple fait de lui ouvrir les bras. Tilio, épouvanté et malheureux, s'en arrache les ongles des pieds. Mais madame Brunet veille à tout.
Ces histoires qu'on ne peut toutes citer ici, sont liées par d'indicibles détails qui captent le regard, témoignent de l'importance de faits restés dans l'ombre, combien salutaires quand il s'agit de soigner une douleur qui donne envie de hurler, alors que par convention il faut la taire. Cette habileté à esquiver les pièges consternants de la vie, ne s'acquiert pas dans l'immédiat mais dans l'expérience de l'écriture si particulière au genre. À la maîtrise qu'exige la phrase construite à partir de l'essentiel, ces non-dits, tels des silences qu'il est si difficile de garder en soi. Hommes et femmes décrits par Sylvie Massicotte reflètent l'art de l'écrivaine : elle les achemine vers la ténuité paisible de la réconciliation. D'une manière floue, nous y retrouvons ceux et celles qui, inconsciemment ou pas, leur ont infligé une blessure palpable, à fleur d'âme.
Vingt-quatre nouvelles sans faille aucune, qu'on a lues avec délectation. Avec la certitude que des Mozart de l'écriture succincte existent. Diffusent dans l'esprit du lecteur ému leur petite musique de jour et de nuit. Recueil à lire absolument.
Avant d'éteindre, Sylvie Massicotte
Éditions L'instant même, Québec, 2014, 112 pages.
On pourrait résumer ces vingt-quatre nouvelles en quelques lignes, les enjolivant de balbutiements, de voix basses, d'yeux ouverts sur nos mondes intimes, ceux qui parfois nous font rencontrer des êtres empreints d'une profonde tendresse et qui n'osent la dire. Pudeur mais aussi nécessité de se taire face à l'incompréhension de nos semblables. Avec une discrétion qu'on lui connaît, Sylvie Massicotte a regroupé divers textes, comme elle aurait rassemblé autour d'elle des personnes aimées. Elle nous présente ses personnages en les situant au centre d'anecdotes qui les auraient blessés à un moment précis de leur vie. Blessure de l'un, maladresse de l'autre, on s'attarde au texte L'arbre invisible. Une mère frustrée sème sur le chemin de son fils, devenu jeune adulte, des indices révélant un père inexistant. Il est l'homme invisible, l'homme absent qui ne peut se défendre. Tu m'avais dit que tu téléphonerais, le soulagement d'une jeune femme qui attend l'appel de son amant désinvolte et qui, le recevant, ferme son cellulaire. Plus loin, Le porte-bijoux, un père, veuf inconsolable, offre à ses deux grandes filles, des bijoux que leur mère portait. Mais il y a une « petite boucle rouge » tellement dérangeante, débordante de souvenirs, qu'il vaut mieux détourner le regard vers la fenêtre. Dehors, des arbres marqués d'un ruban rouge seront abattus, ils encombrent le paysage. On a aimé Resto-bar des îles. Une mère encore séjourne avec son jeune fils, Félix, dans un village perdu au bord du fleuve. Pour dissiper l'ennui que Félix éprouve loin de ses amis d'école, elle l'emmène manger des frites dans un restaurant quelconque, autrefois dirigé par un ancien amant qu'elle a profondément aimé. Face à la mer, elle s'interroge : est-ce lui le père de l'enfant ? Semblable à la nostalgie de cette femme, son doute est constamment entravé par les allées et venues de la serveuse qui apporte enfin les frites à Félix. Le trophée ou les retrouvailles à Calgary de deux anciens collègues de travail. Jim accueille Antoine dans sa maison, lui présente les photos et les objets rapportés de ses voyages. Des trophées, pense Antoine, qui s'étonne de sa réflexion. Lui-même n'a-t-il pas rapporté des souvenirs de différents pays qu'il a visités ? Entre les deux hommes, aucune complicité, aucun désir de se confier. Seule, la politesse évoque une hôtesse parfaite. Peu à peu, au cours du repas, se dévoilent les intentions de Jim. Un trophée de chasse auquel Antoine veut échapper à tout prix.
En filigrane, s'amorcent des amours anxieuses, des oublis irrémissibles. La femme amère et souriante de la nouvelle Dans le ciel bleu d'automne se promène avec un homme qu'elle a aimé, qu'elle aime encore, alors que lui croque une pomme, sans se soucier du passé. C'est elle qui le recompose. La marionnette signe la fin d'un morceau de musique, d'une poupée articulée, paraphe le courage de Léa tellement le froid la parcourt. Tous les froids représentés par le regard sombre d'un « type à l'air dédaigneux » qui suit la gesticulation de la marionnette activée par Léa. Tilio, dans le récit Les blessures, confié à la maison d'accueil de madame Brunet, regrette le geste brusque qu'il a commis envers Colin, enfant craintif, que traumatise le simple fait de lui ouvrir les bras. Tilio, épouvanté et malheureux, s'en arrache les ongles des pieds. Mais madame Brunet veille à tout.
Ces histoires qu'on ne peut toutes citer ici, sont liées par d'indicibles détails qui captent le regard, témoignent de l'importance de faits restés dans l'ombre, combien salutaires quand il s'agit de soigner une douleur qui donne envie de hurler, alors que par convention il faut la taire. Cette habileté à esquiver les pièges consternants de la vie, ne s'acquiert pas dans l'immédiat mais dans l'expérience de l'écriture si particulière au genre. À la maîtrise qu'exige la phrase construite à partir de l'essentiel, ces non-dits, tels des silences qu'il est si difficile de garder en soi. Hommes et femmes décrits par Sylvie Massicotte reflètent l'art de l'écrivaine : elle les achemine vers la ténuité paisible de la réconciliation. D'une manière floue, nous y retrouvons ceux et celles qui, inconsciemment ou pas, leur ont infligé une blessure palpable, à fleur d'âme.
Vingt-quatre nouvelles sans faille aucune, qu'on a lues avec délectation. Avec la certitude que des Mozart de l'écriture succincte existent. Diffusent dans l'esprit du lecteur ému leur petite musique de jour et de nuit. Recueil à lire absolument.
Avant d'éteindre, Sylvie Massicotte
Éditions L'instant même, Québec, 2014, 112 pages.
lundi 29 septembre 2014
L'enfer en soi-même *** 1/2
On aime les nombres impairs. Les nombres pairs, trop simples à résoudre, nous ennuient. On aime la trinité des êtres et des choses, le triangle d'une île déserte repérée dans internet, le trèfle à trois feuilles qui ne porte pas bonheur, le trio théâtral des couples las de s'aimer. On aime que deux hommes occupent notre espace vital et composent pour trois une aria harmonieuse. On a terminé de lire le récent roman de Marie-Christine Arbour, Schizo.
Qui parle d'enfance, bien souvent a le sourire aux lèvres, des larmes aux yeux. Nous y décelons un nostalgique désir de recouvrer le vert paradis. Ce qui n'est pas le cas de Christine, la narratrice de ce long récit plus que moins autobiographique. Les jeunes années sont partagées entre une mère instable, un père mal à l'aise entre sa femme et sa fille. Il les quittera pour une autre, trop jeune, qui le quittera à son tour pour un homme de son âge. C'est aller vite dans le temps routinier d'une fillette qui grandit mal, intelligente et lucide, en compagnie d'une mère qui cherche le compagnon idéal. Qu'elle ne trouvera qu'à travers sa fille, à la fois mère castratrice, amoureuse d'une image qu'elle se fabrique pour ne pas être seule. La solitude s'avère le drame de cette femme traumatisée par la rupture brutale d'un foyer duquel elle ne peut se passer. Symbole d'une féminité discutable : ses longs cheveux, les hommes les préfèrent aux cheveux courts, confiera-t-elle à Christine qui, elle, s'installe dans une androgynie sans cesse remise en question. Cheveux longs, cheveux courts, de curieux hommes feront partie de son univers interlope, déjà dépeint dans des romans précédents. Douée pour les mathématiques, elle fréquente l'université, soutenue financièrement par son père. Les algorithmes apaisent ses tourments de jeune femme cherchant un absolu masculin dans des amours de pacotille, d'appartements sordides en quartiers lugubres, de Vancouver au Québec. Va-et-vient géographique, métronome sentimental qui la précipitent dans une dépression soignée à coups de médicaments, desquels elle devient dépendante. Au loin la mère veille, sujette elle aussi à des vides intérieurs que ne comble pas la présence de compagnons versatiles. L'amour déserte ces deux femmes qui, exaspérées par leur ressemblance, ne savent se passer l'une de l'autre. Elles se téléphonent. Christine l'accuse d'étouffement, alors que sa liberté, soumise à des amants velléitaires, s'effrite dans les méandres compliqués de relations plus sexuelles qu'amoureuses. L'une à Montréal, l'autre à Vancouver, elles finiront par se rejoindre, l'une a vieilli, l'autre a mûri. La mère mourra, la fille devient schizophrène. Le père poursuit de cahotantes liaisons, lui non plus ne sachant vivre seul.
Ce n'est pas simple de décrire une histoire terriblement humaine, émaillée de tous les manques et traumatismes que subit une jeune femme désemparée. Qui aime la musique, la littérature, les équations algébriques. Avant tout, qui aime la vie, ne sait comment la poursuivre sans se blesser. Elle s'enferme dans des lieux hasardeux, chambres misérables et bars louches. Des sons l'assaillent — l'aum. Elle court dans la nuit pour fuir un homme trop lâche pour l'aimer en retour. Jeune femme allant à contre-courant des normes établies et, là encore, qu'elle fuit pour ne pas grandir. Éternelle étudiante sporadique, éternelle petite fille qu'étouffe une mère abusive, un père constamment présent quand il s'agit d'alimenter sa paresse pathologique.
Roman que portent les expériences difficiles de la vie, la fiction ayant ici peu de place. Dire que le cas de Christine nous a passionnée outre mesure serait excessif. On y perdrait notre compassion ressentie pour l'ensemble des êtres humains. La façon qu'ils ont de se blesser mortellement à des pièges tendus sur leur route épineuse, de ressusciter miraculeusement quand plus rien ne les y incite, quand plus personne ne s'y attend, surtout pas eux.
Depuis la parution de son premier roman, on suit le parcours tantôt réaliste, tantôt idéaliste de Marie-Christine Arbour, on songe à Bergson. L'intelligence analytique dont l'écrivaine fait preuve, son courage sans concession à exposer ses malheurs, ses espoirs qui rebondissent d'un livre à l'autre, servis par une écriture incisive, toujours à la mesure de ses démesures humaines. Un des aspects plaisants du roman, c'est que le ton ne s'appuie sur aucun style particulier, poésie symboliste et réflexions piaculaires s'y confondent, aucune mode ne parvenant à défigurer ses propos. Phrases longues ou courtes, tels les cheveux de la narratrice, on aime ou pas. On lit ou pas. On a lu, on a aimé.
Schizo, Marie-Christine Arbour
Les Éditions Triptyque, Montréal, 2014, 288 pages.
Qui parle d'enfance, bien souvent a le sourire aux lèvres, des larmes aux yeux. Nous y décelons un nostalgique désir de recouvrer le vert paradis. Ce qui n'est pas le cas de Christine, la narratrice de ce long récit plus que moins autobiographique. Les jeunes années sont partagées entre une mère instable, un père mal à l'aise entre sa femme et sa fille. Il les quittera pour une autre, trop jeune, qui le quittera à son tour pour un homme de son âge. C'est aller vite dans le temps routinier d'une fillette qui grandit mal, intelligente et lucide, en compagnie d'une mère qui cherche le compagnon idéal. Qu'elle ne trouvera qu'à travers sa fille, à la fois mère castratrice, amoureuse d'une image qu'elle se fabrique pour ne pas être seule. La solitude s'avère le drame de cette femme traumatisée par la rupture brutale d'un foyer duquel elle ne peut se passer. Symbole d'une féminité discutable : ses longs cheveux, les hommes les préfèrent aux cheveux courts, confiera-t-elle à Christine qui, elle, s'installe dans une androgynie sans cesse remise en question. Cheveux longs, cheveux courts, de curieux hommes feront partie de son univers interlope, déjà dépeint dans des romans précédents. Douée pour les mathématiques, elle fréquente l'université, soutenue financièrement par son père. Les algorithmes apaisent ses tourments de jeune femme cherchant un absolu masculin dans des amours de pacotille, d'appartements sordides en quartiers lugubres, de Vancouver au Québec. Va-et-vient géographique, métronome sentimental qui la précipitent dans une dépression soignée à coups de médicaments, desquels elle devient dépendante. Au loin la mère veille, sujette elle aussi à des vides intérieurs que ne comble pas la présence de compagnons versatiles. L'amour déserte ces deux femmes qui, exaspérées par leur ressemblance, ne savent se passer l'une de l'autre. Elles se téléphonent. Christine l'accuse d'étouffement, alors que sa liberté, soumise à des amants velléitaires, s'effrite dans les méandres compliqués de relations plus sexuelles qu'amoureuses. L'une à Montréal, l'autre à Vancouver, elles finiront par se rejoindre, l'une a vieilli, l'autre a mûri. La mère mourra, la fille devient schizophrène. Le père poursuit de cahotantes liaisons, lui non plus ne sachant vivre seul.
Ce n'est pas simple de décrire une histoire terriblement humaine, émaillée de tous les manques et traumatismes que subit une jeune femme désemparée. Qui aime la musique, la littérature, les équations algébriques. Avant tout, qui aime la vie, ne sait comment la poursuivre sans se blesser. Elle s'enferme dans des lieux hasardeux, chambres misérables et bars louches. Des sons l'assaillent — l'aum. Elle court dans la nuit pour fuir un homme trop lâche pour l'aimer en retour. Jeune femme allant à contre-courant des normes établies et, là encore, qu'elle fuit pour ne pas grandir. Éternelle étudiante sporadique, éternelle petite fille qu'étouffe une mère abusive, un père constamment présent quand il s'agit d'alimenter sa paresse pathologique.
Roman que portent les expériences difficiles de la vie, la fiction ayant ici peu de place. Dire que le cas de Christine nous a passionnée outre mesure serait excessif. On y perdrait notre compassion ressentie pour l'ensemble des êtres humains. La façon qu'ils ont de se blesser mortellement à des pièges tendus sur leur route épineuse, de ressusciter miraculeusement quand plus rien ne les y incite, quand plus personne ne s'y attend, surtout pas eux.
Depuis la parution de son premier roman, on suit le parcours tantôt réaliste, tantôt idéaliste de Marie-Christine Arbour, on songe à Bergson. L'intelligence analytique dont l'écrivaine fait preuve, son courage sans concession à exposer ses malheurs, ses espoirs qui rebondissent d'un livre à l'autre, servis par une écriture incisive, toujours à la mesure de ses démesures humaines. Un des aspects plaisants du roman, c'est que le ton ne s'appuie sur aucun style particulier, poésie symboliste et réflexions piaculaires s'y confondent, aucune mode ne parvenant à défigurer ses propos. Phrases longues ou courtes, tels les cheveux de la narratrice, on aime ou pas. On lit ou pas. On a lu, on a aimé.
Schizo, Marie-Christine Arbour
Les Éditions Triptyque, Montréal, 2014, 288 pages.
lundi 15 septembre 2014
Un père hors de tous les temps *** 1/2
Pensées éparpillées de fin d'été. On a visité quelques blogues qui parlent de livres, on est vite revenue à ce qu'on écrit. On a flâné dans le parc, observé hommes et femmes accablés par la chaleur, préoccupés de leur bronzage. Manière insouciante d'oublier que le monde se porte mal. Notre planète bleue, la Terre, commence à s'essouffler. On fait de même quand on regarde la pile de livres qui ne demandent qu'à occuper nos insomnies. On a lu le sixième roman de Catherine Mavrikakis, Une ballade d'Ali Baba.
Nous sommes en 1968. Érina, fille aînée de Vassili Papadopoulos, nous entraîne au cours de son voyage qu'elle a fait à Key West avec son père et ses sœurs jumelles. Elle n'avait que neuf ans, les jumelles cinq. Pour fêter l'année nouvelle, ce père divorcé tient à ce que ses filles voient la mer. Voyage effréné qu'Érina se remémore avec un humour tendre. Ils ont roulé deux jours, ont visité la boutique d'El Pedro, capharnaüm à souvenirs, ont vu la mer durant trois jours, puis sont retournés à Montréal dans un laps de temps aussi court. Instants fervents et fiévreux. En 1970, à Las Vegas, Érina sert de « gri-gri » à son père un soir au casino. C'est un passionné du jeu de craps. Elle est fière de tenir compagnie à ce père tant admiré par les femmes, tant aimé par la fillette. En 2013, Érina est devenue une femme, elle enseigne, se spécialise dans l'œuvre de Shakespeare, Hamlet en particulier. Elle est aussi écrivaine. Depuis neuf mois, son père est mort, elle semble avoir perdu de vue sa mère et ses deux sœurs. Ce soir-là, elle se hâte vers la bibliothèque de l'Université McGill alors qu'une violente tempête de neige sévit. L'obscurité commence à descendre quand elle aperçoit un vieil homme frêle marcher péniblement dans le blizzard. Surgit une « déneigeuse à chenilles » qui risque de renverser et d'écraser le vieil imprudent. Hanté par son père, qu'elle voit un peu partout, Érina se précipite, bouscule le vieillard dans un tas de neige, le sauve in extremis. Quand il se relève, il est heureux de revoir sa fille. Il lui tient une diatribe endiablée sur les dernières années qu'il a vécues avec sa mère. N'a-t-elle pas pris soin de lui avant qu'il meure ? Sur ses amours avec des jeunes femmes, sur l'amitié, sur le fait qu'Érina n'ait su fonder un foyer. Sur Sofia, sa vieille compagne actuelle. Sidérée, Érina évoque l'époque où son père vivait parmi eux, l'époque des possibles alors qu'elle se trouve dans une situation improbable face à ce vieillard qui prétend être son père.
L'évocation de ce père mythique interviendra toujours hors du temps, ce " temps hors de ses gonds ", propos cité dans Hamlet, œuvre à laquelle Érina a consacré deux chapitres de sa thèse. Nomade impétueux, vif et roublard, Vassili Papadoulos est un immigrant grec qui a quitté Rhodes en 1939 avec sa famille pour Alger où, très jeune, il dut gagner sa vie. Plus tard, à New York où il se plaira à jouer à l'Américain. Cet homme, qui se montre tel le spectre du père de Hamlet, demandera un ultime service à sa fille. En cette nuit enneigée, il lui donne rendez-vous au premier jour du solstice d'été dans le cimetière où la mère d'Érina a fait construire un « grand monument pompeux [ ... ] » Si Hamlet redoute pour diverses raisons d'accomplir la vengeance ordonnée par le spectre paternel, Érina n'hésitera pas à se conformer au dernier désir de son père à elle, mais aussi à le cerner dans un avenir qu'elle n'imagine plus sans sa présence aléatoire. Il sera lové au cœur de tous les possibles, il sera dans tous les récits, il ne sera plus rien, conclut l'écrivaine.
D'une écriture redoutablement efficace, mettant en relief son style inimitable, Catherine Mavrikakis touche au cœur de sa peine, son père étant mort un an et demi plus tôt. Tendresse et humour, lucidité et originalité font partie de la démarche intelligente et brillante que l'auteure a tentée en compagnie de fantomatiques souvenirs, comme le deviennent les réminiscences quand l'usure de la souffrance a atténué le manque d'un être irremplaçable. La mémoire, pas mieux que l'écrivaine, ne tient compte d'aucune chronologie, l'ordre du temps n'existant pas. Le désordre, ici, dressant le magistral portrait d'un homme qui, sans cesse, a frôlé les frontières permises de la vie et de la mort. Toujours avec excès, avec éclat. Mais aussi toujours dans la fuite des autres et de lui-même. Qui mieux que sa fille pouvait interrompre sa course infernale pour, enfin, se mesurer à la grandeur variable de l'éternité ? La ballade de Vassili Papadopoulous nous rappelle celle d'un autre Grec, étourdissant et charmeur, fredonnée et dansée sous soleil intense, scandée des accords du santouri. Sans hésitation aucune, on nomme Alexis Zorba, délivré de toute croyance, épris lui aussi de liberté, d'un insatiable besoin de ne rêver que de châteaux en Espagne.
La ballade d'Ali Baba, Catherine Mavrikakis
Éditions Héliotrope, Montréal, 2014, 212 pages
Nous sommes en 1968. Érina, fille aînée de Vassili Papadopoulos, nous entraîne au cours de son voyage qu'elle a fait à Key West avec son père et ses sœurs jumelles. Elle n'avait que neuf ans, les jumelles cinq. Pour fêter l'année nouvelle, ce père divorcé tient à ce que ses filles voient la mer. Voyage effréné qu'Érina se remémore avec un humour tendre. Ils ont roulé deux jours, ont visité la boutique d'El Pedro, capharnaüm à souvenirs, ont vu la mer durant trois jours, puis sont retournés à Montréal dans un laps de temps aussi court. Instants fervents et fiévreux. En 1970, à Las Vegas, Érina sert de « gri-gri » à son père un soir au casino. C'est un passionné du jeu de craps. Elle est fière de tenir compagnie à ce père tant admiré par les femmes, tant aimé par la fillette. En 2013, Érina est devenue une femme, elle enseigne, se spécialise dans l'œuvre de Shakespeare, Hamlet en particulier. Elle est aussi écrivaine. Depuis neuf mois, son père est mort, elle semble avoir perdu de vue sa mère et ses deux sœurs. Ce soir-là, elle se hâte vers la bibliothèque de l'Université McGill alors qu'une violente tempête de neige sévit. L'obscurité commence à descendre quand elle aperçoit un vieil homme frêle marcher péniblement dans le blizzard. Surgit une « déneigeuse à chenilles » qui risque de renverser et d'écraser le vieil imprudent. Hanté par son père, qu'elle voit un peu partout, Érina se précipite, bouscule le vieillard dans un tas de neige, le sauve in extremis. Quand il se relève, il est heureux de revoir sa fille. Il lui tient une diatribe endiablée sur les dernières années qu'il a vécues avec sa mère. N'a-t-elle pas pris soin de lui avant qu'il meure ? Sur ses amours avec des jeunes femmes, sur l'amitié, sur le fait qu'Érina n'ait su fonder un foyer. Sur Sofia, sa vieille compagne actuelle. Sidérée, Érina évoque l'époque où son père vivait parmi eux, l'époque des possibles alors qu'elle se trouve dans une situation improbable face à ce vieillard qui prétend être son père.
L'évocation de ce père mythique interviendra toujours hors du temps, ce " temps hors de ses gonds ", propos cité dans Hamlet, œuvre à laquelle Érina a consacré deux chapitres de sa thèse. Nomade impétueux, vif et roublard, Vassili Papadoulos est un immigrant grec qui a quitté Rhodes en 1939 avec sa famille pour Alger où, très jeune, il dut gagner sa vie. Plus tard, à New York où il se plaira à jouer à l'Américain. Cet homme, qui se montre tel le spectre du père de Hamlet, demandera un ultime service à sa fille. En cette nuit enneigée, il lui donne rendez-vous au premier jour du solstice d'été dans le cimetière où la mère d'Érina a fait construire un « grand monument pompeux [ ... ] » Si Hamlet redoute pour diverses raisons d'accomplir la vengeance ordonnée par le spectre paternel, Érina n'hésitera pas à se conformer au dernier désir de son père à elle, mais aussi à le cerner dans un avenir qu'elle n'imagine plus sans sa présence aléatoire. Il sera lové au cœur de tous les possibles, il sera dans tous les récits, il ne sera plus rien, conclut l'écrivaine.
D'une écriture redoutablement efficace, mettant en relief son style inimitable, Catherine Mavrikakis touche au cœur de sa peine, son père étant mort un an et demi plus tôt. Tendresse et humour, lucidité et originalité font partie de la démarche intelligente et brillante que l'auteure a tentée en compagnie de fantomatiques souvenirs, comme le deviennent les réminiscences quand l'usure de la souffrance a atténué le manque d'un être irremplaçable. La mémoire, pas mieux que l'écrivaine, ne tient compte d'aucune chronologie, l'ordre du temps n'existant pas. Le désordre, ici, dressant le magistral portrait d'un homme qui, sans cesse, a frôlé les frontières permises de la vie et de la mort. Toujours avec excès, avec éclat. Mais aussi toujours dans la fuite des autres et de lui-même. Qui mieux que sa fille pouvait interrompre sa course infernale pour, enfin, se mesurer à la grandeur variable de l'éternité ? La ballade de Vassili Papadopoulous nous rappelle celle d'un autre Grec, étourdissant et charmeur, fredonnée et dansée sous soleil intense, scandée des accords du santouri. Sans hésitation aucune, on nomme Alexis Zorba, délivré de toute croyance, épris lui aussi de liberté, d'un insatiable besoin de ne rêver que de châteaux en Espagne.
La ballade d'Ali Baba, Catherine Mavrikakis
Éditions Héliotrope, Montréal, 2014, 212 pages
lundi 8 septembre 2014
Le temps et ses oscillations *** 1/2
Il arrive que rien, ni personne, ne nous inspire pour nous élancer vers l'écriture d'une critique. Un livre nous emporte, submerge les faits divers qui alimentent nos introductions. On profite de ce bien-être pour contempler le jour qui s'éteint, la nuit étendant ses ombres dans les moindres recoins. Les bruits se raréfiant, on écoute les battements du cœur de la ville, rythme imperturbable de notre condition humaine. On a lu le récent roman de Max Férandon, Un lundi sans bruit.
D'emblée, nous sommes cernés dans un village français, oublié du monde. Y vivent des êtres pittoresques, tel Amédée, le « scieur de long » qui, dans une scierie mal abritée des intempéries, à l'aide de sa « maraudeuse », découpe des arbres en tranches. À pratiquer cette amère entreprise, il a perdu deux doigts « inattentifs ». Après avoir été en « chômage technique » il ne rêve plus qu'à se reposer le lundi. Il en est là de ses réflexions plutôt nostalgiques, quand surgissent devant lui deux « primates », Lazar et Grigor, assis confortablement dans leur BMW. Ils recherchent Goguenard, l'ineffable patron d'Amédée, avec qui ils ont des comptes à régler. À propos d'un tableau volé dans la résidence d'un riche industriel, Raoul de La Mothe Grébière, à la retraite. La fille du soir. À partir de ce tableau, fil conducteur d'une histoire rocambolesque, surgiront des personnages invraisemblables, merveilleusement campés et drôles. Le mime, Quentin Prunier, qui déambule avec son petit cirque, Le Théâtre perdu. La « quatre-vingt-dixgénaire » Simone Marcellin, ancienne institutrice, doyenne du lieu, qui a tant de souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale à raconter, dont ceux du petit Jérôme Quermand. Un bout de gamin qui, en réalité, s'appelait Josef Ackermann. Il y a aussi Vincent, chômeur institutionnel, « qui saute de stage en stage comme on joue à la marelle. » En ce moment, il conduit le camion de la bibliothèque départementale en attendant de trouver mieux. Les Tardieu, elle, institutrice retraitée, lui, ancien percepteur du Trésor public. L'auteur, avec beaucoup d'humour, se demande ce qu'ils font ensemble. Dresse un tableau primesautier, bien que digne, de ceux et celles qui gravitent autour de Goguenard en fuite, poursuivi par les deux frères arnaqueurs. De ce fait, nous connaîtrons les regrets et les secrets — en ont-ils véritablement ? —, plus ou moins pathétiques de chacun des protagonistes aux prises avec les relents éhontés d'une guerre, dont les blessures apaisées ne parviennent pas à cicatriser.
Si l'action désopilante des villageois se déroule en un lundi pluvieux de ces dernières années, la mémoire est si prolixe, à fleur de peau, qu'une fois les deux Ukrainiens détalés vers de hasardeuses aventures, il était inévitable que, par la voix de l'écrivain, le village ne bondisse pas soixante-dix ans en arrière, en juin quarante-trois, territoire occupé par les Allemands. Nous y retrouvons les « Grands Anciens », jeunes et résistants. L'enfant Josef Ackermann et ses parents, noyau disparate réfugié à la campagne, chacun s'ignorant presque. Un fonctionnaire de la préfecture répondant au nom gonflant de Raoul La Mothe Grébière. Possesseur d'un tableau alors inconnu, peint par un nazi au regard triste, gamin dramatiquement doué. Mais le personnage qui domine ces années outragées est un curieux officier allemand, le capitaine Brehmer, qui, malgré lui, sauvera les villageois d'une mise à mort certaine.
L'originalité du roman tient dans la non linéarité du récit. La mémoire se propage avant que les faits n'aient causé leurs ravages envers les uns, sauvé les autres d'offensantes humiliations. Les camps de concentration diffusent leur odeur de charnier. Dans une sorte de vie communautaire, comme seules les guerres savent parfois susciter, les langues se taisent, les silences obstruent l'immédiat. L'instant présent a des saveurs que le temps et ses oscillations ne peuvent diluer.
On a aimé l'humour décapant, le style vif, tonique et poétique, que Max Férandon a utilisés pour mettre en branle un village aux prises avec deux malfrats sortis tout droit d'une étonnante boîte de Pandore. Des faux jumeaux, symbole à peine dissimulé de sinistres démons, qui éveilleraient la mémoire à des réminiscences antérieures, activant des êtres presque surannés. Une fois l'agitation passée, semblables à Amédée, le scieur de long, les villageois n'aspirent plus qu'à se ranger parmi les lundis tranquilles qui leur restent à vivre.
Un lundi sans bruit, Max Férandon
Éditions Alto, Québec, 2014, 192 pages
D'emblée, nous sommes cernés dans un village français, oublié du monde. Y vivent des êtres pittoresques, tel Amédée, le « scieur de long » qui, dans une scierie mal abritée des intempéries, à l'aide de sa « maraudeuse », découpe des arbres en tranches. À pratiquer cette amère entreprise, il a perdu deux doigts « inattentifs ». Après avoir été en « chômage technique » il ne rêve plus qu'à se reposer le lundi. Il en est là de ses réflexions plutôt nostalgiques, quand surgissent devant lui deux « primates », Lazar et Grigor, assis confortablement dans leur BMW. Ils recherchent Goguenard, l'ineffable patron d'Amédée, avec qui ils ont des comptes à régler. À propos d'un tableau volé dans la résidence d'un riche industriel, Raoul de La Mothe Grébière, à la retraite. La fille du soir. À partir de ce tableau, fil conducteur d'une histoire rocambolesque, surgiront des personnages invraisemblables, merveilleusement campés et drôles. Le mime, Quentin Prunier, qui déambule avec son petit cirque, Le Théâtre perdu. La « quatre-vingt-dixgénaire » Simone Marcellin, ancienne institutrice, doyenne du lieu, qui a tant de souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale à raconter, dont ceux du petit Jérôme Quermand. Un bout de gamin qui, en réalité, s'appelait Josef Ackermann. Il y a aussi Vincent, chômeur institutionnel, « qui saute de stage en stage comme on joue à la marelle. » En ce moment, il conduit le camion de la bibliothèque départementale en attendant de trouver mieux. Les Tardieu, elle, institutrice retraitée, lui, ancien percepteur du Trésor public. L'auteur, avec beaucoup d'humour, se demande ce qu'ils font ensemble. Dresse un tableau primesautier, bien que digne, de ceux et celles qui gravitent autour de Goguenard en fuite, poursuivi par les deux frères arnaqueurs. De ce fait, nous connaîtrons les regrets et les secrets — en ont-ils véritablement ? —, plus ou moins pathétiques de chacun des protagonistes aux prises avec les relents éhontés d'une guerre, dont les blessures apaisées ne parviennent pas à cicatriser.
Si l'action désopilante des villageois se déroule en un lundi pluvieux de ces dernières années, la mémoire est si prolixe, à fleur de peau, qu'une fois les deux Ukrainiens détalés vers de hasardeuses aventures, il était inévitable que, par la voix de l'écrivain, le village ne bondisse pas soixante-dix ans en arrière, en juin quarante-trois, territoire occupé par les Allemands. Nous y retrouvons les « Grands Anciens », jeunes et résistants. L'enfant Josef Ackermann et ses parents, noyau disparate réfugié à la campagne, chacun s'ignorant presque. Un fonctionnaire de la préfecture répondant au nom gonflant de Raoul La Mothe Grébière. Possesseur d'un tableau alors inconnu, peint par un nazi au regard triste, gamin dramatiquement doué. Mais le personnage qui domine ces années outragées est un curieux officier allemand, le capitaine Brehmer, qui, malgré lui, sauvera les villageois d'une mise à mort certaine.
L'originalité du roman tient dans la non linéarité du récit. La mémoire se propage avant que les faits n'aient causé leurs ravages envers les uns, sauvé les autres d'offensantes humiliations. Les camps de concentration diffusent leur odeur de charnier. Dans une sorte de vie communautaire, comme seules les guerres savent parfois susciter, les langues se taisent, les silences obstruent l'immédiat. L'instant présent a des saveurs que le temps et ses oscillations ne peuvent diluer.
On a aimé l'humour décapant, le style vif, tonique et poétique, que Max Férandon a utilisés pour mettre en branle un village aux prises avec deux malfrats sortis tout droit d'une étonnante boîte de Pandore. Des faux jumeaux, symbole à peine dissimulé de sinistres démons, qui éveilleraient la mémoire à des réminiscences antérieures, activant des êtres presque surannés. Une fois l'agitation passée, semblables à Amédée, le scieur de long, les villageois n'aspirent plus qu'à se ranger parmi les lundis tranquilles qui leur restent à vivre.
Un lundi sans bruit, Max Férandon
Éditions Alto, Québec, 2014, 192 pages
lundi 25 août 2014
Une balade en couleurs ***
On aime la campagne, la mer, la montagne. On est contente d'y séjourner, d'assister au grand déploiement de la nature, de rêver à la découverte improbable de nouveaux continents, de contempler le ciel étoilé s'étalant au sommet des montagnes. Mais on préférera toujours la ville, ses odeurs toxiques, ses bruits assourdissants, son agitation fébrile. Manifestations vitales desquelles on ne se lasse pas. On a lu le récit de Pierre Lussier, Promenade dans les pensées d'un peintre.
Au cours d'une randonnée pédestre proposée par l'artiste peintre, on s'attardera sur certains paysages campagnards transmués en mots poétiques par l'écrivain. Tant d'esthétisme enrobe la peinture des siècles passés, qu'il titille notre imaginaire, stimule notre curiosité intellectuelle. Il est question dans ces deux cent trente-cinq strophes, composées telle une aubade, de faire corps et âme avec la nature qui alimente tous nos sens, de la considérer comme un idéal, celui qui nous rapproche de l'infini. Le temps ne semble pas compter pour l'artiste, il médite dans des sentiers fleuris du mois d'août, dans ceux figés du froid de l'hiver. Nous avons l'impression étourdissante d'entrer dans des univers abolis, qui ne permettent plus de contempler l'eau bondissante et joyeuse de l'été, le ploiement d'une branche alourdie par la neige. Pourtant, l'artiste peintre proteste, nous devons « parvenir au delà du mur des apparences », assure-t-il, observer le ciel, plus loin nous attend un tableau. Faire confiance à l'inspiration qui se nourrit librement, éloigner le statique, ne pas rechercher des cibles, des buts définitifs. Avant tout, nous devons nous infiltrer entièrement dans le sujet, comme un écrivain revêt la peau de l'un de ses personnages. D'où revenons-nous ? Qu'avons-nous traversé au cours d'une promenade où nous avons vu le ciel s'assombrir, les arbres gauchir sous la force implacable du vent, annonçant un orage ? Le pas se fait incertain, le corps oscille, courbé vers l'avant. Nous nous heurtons à la fragilité de l'être imparfait, celui nanti de certitudes, celui aveuglé par sa volition, alors qu'il devrait s'en tenir à la générosité de la vision qui, elle, l'élève dans un état exaltant, confirme que la peinture est vivante.
La pensée picturale de Pierre Lussier est sertie, pourrait-on avancer, des couleurs de tous les peintres d'antan. De leur génie, ils ont borné des espaces-temps, qu'avec délectation l'écrivain-poète cite, ne pouvant nier leur influence. Vinci, Rubens, Turner, Le Lorrain. Des peintres de la Renaissance, il a tout appris au point de regretter des « copies » inexistantes, « apprentissage irremplaçable ». Botticelli, Piero Della Francesca, Michel-Ange. Marchant sciemment dans les pas du maître, nous ne laissons aucune trace, nous entendons que nous n'inventons pas la beauté, « c'est elle qui nous surprend. » Que l'homme est un. Étonnée, on se questionne : L'homme n'est-il pas multiple ? Le narrateur nous incite à flâner sans but précis en quête d'images qui dansent, elles ont tant à nous dire. Dans ces réflexions qui sollicitent l'attention du lecteur, il est aussi question de la solitude, du sacré et du profane, de la lumière. L'essayiste Jean Bédard, qui a écrit la préface, ne s'y trompe pas en mentionnant Christian Bobin, le récit de Pierre Lussier s'inscrivant dans une sorte de naïveté désarmante, semblable aux paysages qu'il peint, expose avec succès. Des évidences révélant le comportement humain reflètent une âme d'enfant ou, mieux, une bonté puérile peut-être acquise au contact permanent de la nature. Celle-ci serait-elle l'antidote anesthésiant tous nos maux, nous désunissant du reste de la terre, ce qui deviendrait le symbole inquiétant d'un bonheur presque insoutenable ?
Discours de la peinture agréable à lire, Pierre Lussier, artiste peintre, clame un désir de vivre transcendant l'homme qu'il est. « L'homme est debout dans son corps d'ange. » Interrogeant son âme à propos d'un paysage « qui fait battre mon cœur si fort. » Certes, le ciel se propulse, la terre est amie, mais ce langage parfois désincarné nous a paru éloigné du monde dans lequel on vit. Il nous est impossible de le regarder autrement qu'avec des yeux remplis de tous les doutes que nos semblables y sèment dangereusement.
Quinze dessins originaux de l'auteur illustrent son livre.
Promenade dans les pensées d'un peintre, Pierre Lussier
Éditions Fides, Montréal, 2014, 192 pages
Au cours d'une randonnée pédestre proposée par l'artiste peintre, on s'attardera sur certains paysages campagnards transmués en mots poétiques par l'écrivain. Tant d'esthétisme enrobe la peinture des siècles passés, qu'il titille notre imaginaire, stimule notre curiosité intellectuelle. Il est question dans ces deux cent trente-cinq strophes, composées telle une aubade, de faire corps et âme avec la nature qui alimente tous nos sens, de la considérer comme un idéal, celui qui nous rapproche de l'infini. Le temps ne semble pas compter pour l'artiste, il médite dans des sentiers fleuris du mois d'août, dans ceux figés du froid de l'hiver. Nous avons l'impression étourdissante d'entrer dans des univers abolis, qui ne permettent plus de contempler l'eau bondissante et joyeuse de l'été, le ploiement d'une branche alourdie par la neige. Pourtant, l'artiste peintre proteste, nous devons « parvenir au delà du mur des apparences », assure-t-il, observer le ciel, plus loin nous attend un tableau. Faire confiance à l'inspiration qui se nourrit librement, éloigner le statique, ne pas rechercher des cibles, des buts définitifs. Avant tout, nous devons nous infiltrer entièrement dans le sujet, comme un écrivain revêt la peau de l'un de ses personnages. D'où revenons-nous ? Qu'avons-nous traversé au cours d'une promenade où nous avons vu le ciel s'assombrir, les arbres gauchir sous la force implacable du vent, annonçant un orage ? Le pas se fait incertain, le corps oscille, courbé vers l'avant. Nous nous heurtons à la fragilité de l'être imparfait, celui nanti de certitudes, celui aveuglé par sa volition, alors qu'il devrait s'en tenir à la générosité de la vision qui, elle, l'élève dans un état exaltant, confirme que la peinture est vivante.
La pensée picturale de Pierre Lussier est sertie, pourrait-on avancer, des couleurs de tous les peintres d'antan. De leur génie, ils ont borné des espaces-temps, qu'avec délectation l'écrivain-poète cite, ne pouvant nier leur influence. Vinci, Rubens, Turner, Le Lorrain. Des peintres de la Renaissance, il a tout appris au point de regretter des « copies » inexistantes, « apprentissage irremplaçable ». Botticelli, Piero Della Francesca, Michel-Ange. Marchant sciemment dans les pas du maître, nous ne laissons aucune trace, nous entendons que nous n'inventons pas la beauté, « c'est elle qui nous surprend. » Que l'homme est un. Étonnée, on se questionne : L'homme n'est-il pas multiple ? Le narrateur nous incite à flâner sans but précis en quête d'images qui dansent, elles ont tant à nous dire. Dans ces réflexions qui sollicitent l'attention du lecteur, il est aussi question de la solitude, du sacré et du profane, de la lumière. L'essayiste Jean Bédard, qui a écrit la préface, ne s'y trompe pas en mentionnant Christian Bobin, le récit de Pierre Lussier s'inscrivant dans une sorte de naïveté désarmante, semblable aux paysages qu'il peint, expose avec succès. Des évidences révélant le comportement humain reflètent une âme d'enfant ou, mieux, une bonté puérile peut-être acquise au contact permanent de la nature. Celle-ci serait-elle l'antidote anesthésiant tous nos maux, nous désunissant du reste de la terre, ce qui deviendrait le symbole inquiétant d'un bonheur presque insoutenable ?
Discours de la peinture agréable à lire, Pierre Lussier, artiste peintre, clame un désir de vivre transcendant l'homme qu'il est. « L'homme est debout dans son corps d'ange. » Interrogeant son âme à propos d'un paysage « qui fait battre mon cœur si fort. » Certes, le ciel se propulse, la terre est amie, mais ce langage parfois désincarné nous a paru éloigné du monde dans lequel on vit. Il nous est impossible de le regarder autrement qu'avec des yeux remplis de tous les doutes que nos semblables y sèment dangereusement.
Quinze dessins originaux de l'auteur illustrent son livre.
Promenade dans les pensées d'un peintre, Pierre Lussier
Éditions Fides, Montréal, 2014, 192 pages
lundi 11 août 2014
Être libre encagé *** 1/2
Les couleurs estivales nous comblent. Surtout les verts multiples de la canopée des arbres du parc. Des bancs bruns ou rouges nous accueillent, peu vêtue, avec un livre. On évite les bancs rouges, on n'aime pas cette teinte agressive, elle symbolise les pires catastrophes qu'inventent les hommes pour humilier leurs semblables. Rouge du sang. Penser se vêtir de ce coloris, s'en chapeauter, ne nous viendrait pas à l'idée, on y verrait une indécence. On a lu les nouvelles d'Elsa Pépin, Quand j'étais l'Amérique.
Treize textes qui nous parlent de liberté chèrement acquise, d'indépendance observée chez les uns et les autres. En soi, lorsque des circonstances se présentent, auxquelles personne ne peut échapper. Une sorte de route encombrée d'inadvertances qu'empruntent des hommes et des femmes curieux d'ouvrir des portes sur le monde et ses envers. Dans les récits d'Elsa Pépin, la famille ne fait pas exception à ce qu'elle a toujours été, miroir gigantesque dans lequel chacun se contemple, essaie de se définir. La faim d'Alfred nous griffe. Malgré le dédain que lui a porté son père durant son enfance, Alfred poursuit un rêve qui se retournera contre lui. Contre la vie routinière qu'il exècre mais qui lui colle à la peau, comme s'il était incapable d'oublier en lui l'enfant qui n'a pas fini de grandir. L'enfance tient une place prépondérante dans ces nouvelles, perçue par des témoins retrouvés par hasard. Il en est ainsi de L'enfant au bois mort. Une jeune femme qui, « après deux décennies d'absence » revoit Betty, s'interroge sur la personne inachevée qu'elle est restée. Elle se souvient de la petite fille vive et indépendante, se rend compte soudainement que Betty n'est plus la même ; interpellée par une ancienne compagne, elle devient Élizabeth. Une adulte, une inconnue. La symbolique de l'aubier et du bois dur convient admirablement à la personnalité forte et fragile de Betty.
Si la frivolité aiguise une amère lucidité surgie de comportements oisifs, elle éloigne la futilité de rencontres hasardeuses ou provoquées par des êtres qui ont cru bien faire. Chassé-croisé de la séduction qui se lasse, au même titre que les paroles rabâchées, les gestes anodins, la réalité nous rendant à nos turpitudes habituelles. Une jeune fille, Léo, joue avec le feu de la séduction, ne se laisse pas retenir. L'homme qui l'a aimée n'a su entraver sa course ; tourbillonnante, trop vivante, elle lui a fait peur, il a fui. Quand Léo s'en est allée pour l'éternité, il se remémore. En lisant ces histoires, on a souvent l'impression qu'il est trop tard, que les pendules, affolées, se sont décalées dans le temps. Comment imaginer que dans un village, un couple rempli de bonnes intentions envers les habitants puisse faire naître tant de haine ? En milieu rural où chacun s'affaire à assouvir ses fantasmes, Adèle brasille. Sa présence flamboyante intensifie des délires qui s'affilient au meurtre moyenâgeux, affamés de vengeance silencieuse.
Ces textes contiennent l'affadissement du cœur, quand ils n'entrent plus dans une démesure que permettent les retours sur l'enfance, sur les exagérations qui l'embellissent, induisent les souvenirs en erreur, en méconnaissance des autres et de soi. La nouvelle Nécrogénéalogie entretient ce lien malaisé entre Bénédicte et sa grand-mère Rose. Quand celle-ci sera morte, Bénédicte fera la connaissance de la vraie Rose de qui elle ignorait la moindre parcelle de sa vie de femme. Rebelle Rose, insatiable Bénédicte. La mort s'avère parfois une renaissance. Quand j'étais l'Amérique, récit éponyme, informe le lecteur des difficultés de l'auteure avec sa famille maternelle, originaire de France. Pendant ses séjours estivaux, elle affronte une parenté différente qui, inconsciemment, dédaigne, moqueuse et curieuse, sa culture du « pays de la lente parole à naître ». Québec et Amérique soudés. Qui dit liberté ne manque pas de se frotter à la solitude. Nous n'acquérons aucun lien marginal, dérangeant, sans nous déposséder un tant soi peu. Ce qui arrive aux personnages d'Elsa Pépin, attachants, déroutés. La liberté, telle que nous la concevons, ne marque de son sceau indélébile que des êtres excessifs, inassouvis. Ceux et celles qui, toujours, se tournent vers des interrogations, rarement épris de certitudes, déstabilisant leurs repères dans les mouvances d'une existence constamment remise en question.
À lire, parce que ces nouvelles parlent d'amour mais aussi d'incompréhension qu'il faut décoder tant qu'un brin d'humanité nous cerne, la vieillesse imposant trop souvent sa dureté. À lire, parce que l'écriture, déliée et poétique, s'inscrit ici cadencée dans la démarche réaliste d'Elsa Pépin. Dans sa manière moderne de nous faire part de rendez-vous manqués avec celui ou celle qui nous était peut-être destiné. À partir d'un rien, d'un tout, une vie s'accomplit, se déchire.
Quand j'étais l'Amérique, Elsa Pépin
Collection « Quai No 5 »
Éditions XYZ, Montréal, 2014, 168 pages
Treize textes qui nous parlent de liberté chèrement acquise, d'indépendance observée chez les uns et les autres. En soi, lorsque des circonstances se présentent, auxquelles personne ne peut échapper. Une sorte de route encombrée d'inadvertances qu'empruntent des hommes et des femmes curieux d'ouvrir des portes sur le monde et ses envers. Dans les récits d'Elsa Pépin, la famille ne fait pas exception à ce qu'elle a toujours été, miroir gigantesque dans lequel chacun se contemple, essaie de se définir. La faim d'Alfred nous griffe. Malgré le dédain que lui a porté son père durant son enfance, Alfred poursuit un rêve qui se retournera contre lui. Contre la vie routinière qu'il exècre mais qui lui colle à la peau, comme s'il était incapable d'oublier en lui l'enfant qui n'a pas fini de grandir. L'enfance tient une place prépondérante dans ces nouvelles, perçue par des témoins retrouvés par hasard. Il en est ainsi de L'enfant au bois mort. Une jeune femme qui, « après deux décennies d'absence » revoit Betty, s'interroge sur la personne inachevée qu'elle est restée. Elle se souvient de la petite fille vive et indépendante, se rend compte soudainement que Betty n'est plus la même ; interpellée par une ancienne compagne, elle devient Élizabeth. Une adulte, une inconnue. La symbolique de l'aubier et du bois dur convient admirablement à la personnalité forte et fragile de Betty.
Si la frivolité aiguise une amère lucidité surgie de comportements oisifs, elle éloigne la futilité de rencontres hasardeuses ou provoquées par des êtres qui ont cru bien faire. Chassé-croisé de la séduction qui se lasse, au même titre que les paroles rabâchées, les gestes anodins, la réalité nous rendant à nos turpitudes habituelles. Une jeune fille, Léo, joue avec le feu de la séduction, ne se laisse pas retenir. L'homme qui l'a aimée n'a su entraver sa course ; tourbillonnante, trop vivante, elle lui a fait peur, il a fui. Quand Léo s'en est allée pour l'éternité, il se remémore. En lisant ces histoires, on a souvent l'impression qu'il est trop tard, que les pendules, affolées, se sont décalées dans le temps. Comment imaginer que dans un village, un couple rempli de bonnes intentions envers les habitants puisse faire naître tant de haine ? En milieu rural où chacun s'affaire à assouvir ses fantasmes, Adèle brasille. Sa présence flamboyante intensifie des délires qui s'affilient au meurtre moyenâgeux, affamés de vengeance silencieuse.
Ces textes contiennent l'affadissement du cœur, quand ils n'entrent plus dans une démesure que permettent les retours sur l'enfance, sur les exagérations qui l'embellissent, induisent les souvenirs en erreur, en méconnaissance des autres et de soi. La nouvelle Nécrogénéalogie entretient ce lien malaisé entre Bénédicte et sa grand-mère Rose. Quand celle-ci sera morte, Bénédicte fera la connaissance de la vraie Rose de qui elle ignorait la moindre parcelle de sa vie de femme. Rebelle Rose, insatiable Bénédicte. La mort s'avère parfois une renaissance. Quand j'étais l'Amérique, récit éponyme, informe le lecteur des difficultés de l'auteure avec sa famille maternelle, originaire de France. Pendant ses séjours estivaux, elle affronte une parenté différente qui, inconsciemment, dédaigne, moqueuse et curieuse, sa culture du « pays de la lente parole à naître ». Québec et Amérique soudés. Qui dit liberté ne manque pas de se frotter à la solitude. Nous n'acquérons aucun lien marginal, dérangeant, sans nous déposséder un tant soi peu. Ce qui arrive aux personnages d'Elsa Pépin, attachants, déroutés. La liberté, telle que nous la concevons, ne marque de son sceau indélébile que des êtres excessifs, inassouvis. Ceux et celles qui, toujours, se tournent vers des interrogations, rarement épris de certitudes, déstabilisant leurs repères dans les mouvances d'une existence constamment remise en question.
À lire, parce que ces nouvelles parlent d'amour mais aussi d'incompréhension qu'il faut décoder tant qu'un brin d'humanité nous cerne, la vieillesse imposant trop souvent sa dureté. À lire, parce que l'écriture, déliée et poétique, s'inscrit ici cadencée dans la démarche réaliste d'Elsa Pépin. Dans sa manière moderne de nous faire part de rendez-vous manqués avec celui ou celle qui nous était peut-être destiné. À partir d'un rien, d'un tout, une vie s'accomplit, se déchire.
Quand j'étais l'Amérique, Elsa Pépin
Collection « Quai No 5 »
Éditions XYZ, Montréal, 2014, 168 pages
lundi 28 juillet 2014
Frères ennemis modernes *** 1/2
On a lu un fait divers effarant. À cause de son éducation excessivement rigide et puritaine, une femme n'a découvert l'amour des hommes qu'à l'âge de soixante-quatre ans. Plus jeune, elle fermait les yeux sur la sensualité, de peur de pécher. On est consternée que des idées truffées de grossiers mensonges aient pu gâcher à ce point de non-retour la vie d'un être humain. On parle du roman de Vic Verdier, L'imprimeur doit mourir.
Disons-le d'emblée, ce roman en partie historique, dont l'action se situe à Québec, en 1919, draine avec lui un air de vacances estivales. Malgré le sérieux de l'histoire, on s'est laissée aller à suivre, détendue, les péripéties parentales de Victor-Hugo Verdier, frère aîné de Napoléon-Bonaparte Verdier. Le premier gère l'imprimerie Jacques-Cartier, annexe désargentée d'une fabrique de balais et brosses, la plus grosse en Amérique, appartenant depuis des générations à sa famille. Il a toujours été rejeté des siens, atteint qu'il est d'un pied bot. Un physique quelconque le désavantage, contrairement à Napoléon-Bonaparte, jeune homme séduisant, calculateur, qui, revenu en héros de la Grande Guerre, héritera, à la mort du père, de l'entreprise familiale. La Verdier & Co. Son ambition : s'approprier l'imprimerie régie par Victor-Hugo. Tous les moyens seront mis en œuvre pour s'octroyer ce que son frère aîné a défendu âprement, au point de devenir le meilleur imprimeur de la ville. Le supprimer s'il le faut. Course contre la montre pour sauver l'imprimeur et l'imprimerie de mains meurtrières, mettant en scène des personnages surprenants, sortes d'anarchistes au grand cœur, qui fréquentent la Maison Rouge, où Joan l'Anglaise, la plus belle recrue du bordel, règne sur le cœur de Madéus, aveugle, pianiste du lieu. Toby Wiseman, journaliste juif, le meilleur ami de Vic. S'ajoutera à ces personnages pittoresques, Rosie, assistante d'un magicien de passage. Jeune femme rebelle et ubiquiste. Vic succombera à ses attraits irrésistibles, lui si peu prisé des femmes.
En parallèle à ces aventures loufoques, Vic, sous le pseudonyme de Pierre Cimon, rédige en cachette un feuilleton populaire, les aventures de Phantomax, publié chaque semaine dans le quotidien Le Mercure. À mesure que nous entrons dans l'action mouvementée de Victor-Hugo et de ses compagnons, l'image de Phantomax se précise, Gonzague Aylwin est aux prises avec les bijoux volés d'une riche héritière londonienne. Troublante omniprésence virtuelle ne cessant d'aller d'une certaine fiction à une certaine réalité ; les destins s'entrecroisent, se démultiplient, telle une autobiographie frelatée qu'écrirait Vic pour analyser ses rapports à son frère cupide, à sa mère arrogante, à ses amis à qui il doit d'être en vie. Un plan machiavélique jaillira du cerveau paranoïaque de son frère pour réduire Victor-Hugo à néant. N'a-t-il pas, avec l'aide de sbires haineux, assassiné deux imprimeurs montréalais qui ne se pliaient pas à ses exigences ? Les événements se liguant contre Vic, il devra se soumettre, ou faire semblant, au dessein monstrueux de son frère. Projet insensé qui annihilerait leur réputation, les condamnerait à la mort ou à s'exiler. Nous sommes en 1919...
Une poignée d'amis dévoués, une femme amoureuse connaissant les moindres ficelles de la magie, une pute désenchantée, un commissaire piétinant sur une piste ayant peu à voir avec les mésaventures de Vic et celles de ses acolytes, court-circuiteront les objectifs vénaux de Napoléon-Bonaparte. Mais au prix de la liberté de quelques-uns, l'histoire ayant été relatée bien des années plus tard dans un manuscrit hérité par Caroline, petite-fille d'Antoine Saulnier, scénariste reconnu. Personnage qui intervient au début du roman, des décennies plus tôt.
Roman à tiroirs, habilement déployé, telles des couches sédimentaires concourent à la formation de phénomènes résultant de leur érosion. Emportés par l'intensité d'un récit où deux frères rivalisent d'habiletés dévastatrices, nous apprenons ce qui a poussé les protagonistes, gravitant autour de Victor-Hugo, à devenir ce qu'ils sont en apparence, des femmes et des hommes outrageusement blessés qui se réfugient dans les tricheries d'une existence bancale, dans le moment présent qui n'a de suite que le temps d'un spectacle. En ce début de XXe siècle, où la vie moderne explose et s'installe, il est réconfortant d'assister à une soirée de blues avec Tom Millard, à une revue de magie à la Houdini, à l'amerrissage d'un hydravion à Québec. Qu'importe de savoir si ces événements se sont manifestés comme les a dépeints l'écrivain. Notre lecture, tenant elle aussi de l'illusion, enrobe notre imaginaire d'un plaisir extrême.
Afin qu'aucune confusion ne se crée entre l'écrivain et le personnage de son imprimeur, on signale que Vic Verdier est le nom de plume de Simon-Pierre Pouliot.
L'imprimeur doit mourir, Vic Verdier
Éditions XYZ, Montréal, 2014, 340 pages
Disons-le d'emblée, ce roman en partie historique, dont l'action se situe à Québec, en 1919, draine avec lui un air de vacances estivales. Malgré le sérieux de l'histoire, on s'est laissée aller à suivre, détendue, les péripéties parentales de Victor-Hugo Verdier, frère aîné de Napoléon-Bonaparte Verdier. Le premier gère l'imprimerie Jacques-Cartier, annexe désargentée d'une fabrique de balais et brosses, la plus grosse en Amérique, appartenant depuis des générations à sa famille. Il a toujours été rejeté des siens, atteint qu'il est d'un pied bot. Un physique quelconque le désavantage, contrairement à Napoléon-Bonaparte, jeune homme séduisant, calculateur, qui, revenu en héros de la Grande Guerre, héritera, à la mort du père, de l'entreprise familiale. La Verdier & Co. Son ambition : s'approprier l'imprimerie régie par Victor-Hugo. Tous les moyens seront mis en œuvre pour s'octroyer ce que son frère aîné a défendu âprement, au point de devenir le meilleur imprimeur de la ville. Le supprimer s'il le faut. Course contre la montre pour sauver l'imprimeur et l'imprimerie de mains meurtrières, mettant en scène des personnages surprenants, sortes d'anarchistes au grand cœur, qui fréquentent la Maison Rouge, où Joan l'Anglaise, la plus belle recrue du bordel, règne sur le cœur de Madéus, aveugle, pianiste du lieu. Toby Wiseman, journaliste juif, le meilleur ami de Vic. S'ajoutera à ces personnages pittoresques, Rosie, assistante d'un magicien de passage. Jeune femme rebelle et ubiquiste. Vic succombera à ses attraits irrésistibles, lui si peu prisé des femmes.
En parallèle à ces aventures loufoques, Vic, sous le pseudonyme de Pierre Cimon, rédige en cachette un feuilleton populaire, les aventures de Phantomax, publié chaque semaine dans le quotidien Le Mercure. À mesure que nous entrons dans l'action mouvementée de Victor-Hugo et de ses compagnons, l'image de Phantomax se précise, Gonzague Aylwin est aux prises avec les bijoux volés d'une riche héritière londonienne. Troublante omniprésence virtuelle ne cessant d'aller d'une certaine fiction à une certaine réalité ; les destins s'entrecroisent, se démultiplient, telle une autobiographie frelatée qu'écrirait Vic pour analyser ses rapports à son frère cupide, à sa mère arrogante, à ses amis à qui il doit d'être en vie. Un plan machiavélique jaillira du cerveau paranoïaque de son frère pour réduire Victor-Hugo à néant. N'a-t-il pas, avec l'aide de sbires haineux, assassiné deux imprimeurs montréalais qui ne se pliaient pas à ses exigences ? Les événements se liguant contre Vic, il devra se soumettre, ou faire semblant, au dessein monstrueux de son frère. Projet insensé qui annihilerait leur réputation, les condamnerait à la mort ou à s'exiler. Nous sommes en 1919...
Une poignée d'amis dévoués, une femme amoureuse connaissant les moindres ficelles de la magie, une pute désenchantée, un commissaire piétinant sur une piste ayant peu à voir avec les mésaventures de Vic et celles de ses acolytes, court-circuiteront les objectifs vénaux de Napoléon-Bonaparte. Mais au prix de la liberté de quelques-uns, l'histoire ayant été relatée bien des années plus tard dans un manuscrit hérité par Caroline, petite-fille d'Antoine Saulnier, scénariste reconnu. Personnage qui intervient au début du roman, des décennies plus tôt.
Roman à tiroirs, habilement déployé, telles des couches sédimentaires concourent à la formation de phénomènes résultant de leur érosion. Emportés par l'intensité d'un récit où deux frères rivalisent d'habiletés dévastatrices, nous apprenons ce qui a poussé les protagonistes, gravitant autour de Victor-Hugo, à devenir ce qu'ils sont en apparence, des femmes et des hommes outrageusement blessés qui se réfugient dans les tricheries d'une existence bancale, dans le moment présent qui n'a de suite que le temps d'un spectacle. En ce début de XXe siècle, où la vie moderne explose et s'installe, il est réconfortant d'assister à une soirée de blues avec Tom Millard, à une revue de magie à la Houdini, à l'amerrissage d'un hydravion à Québec. Qu'importe de savoir si ces événements se sont manifestés comme les a dépeints l'écrivain. Notre lecture, tenant elle aussi de l'illusion, enrobe notre imaginaire d'un plaisir extrême.
Afin qu'aucune confusion ne se crée entre l'écrivain et le personnage de son imprimeur, on signale que Vic Verdier est le nom de plume de Simon-Pierre Pouliot.
L'imprimeur doit mourir, Vic Verdier
Éditions XYZ, Montréal, 2014, 340 pages
lundi 21 juillet 2014
Un homme et l'Everest *** 1/2
Pensée de la nuit, comme d'autres du jour. " J'ai été admiré, respecté et même envié. Mais ai-je été aimé ? " Avant de mourir, est-ce l'ultime interrogation de l'empereur romain Hadrien, homme à l'esprit grec, dépeint admirablement par Marguerite Yourcenar ? On a lu Par-dessus tout, roman signé Tanis Rideout.
On connaissait peu George Leigh Mallory avant d'entreprendre la lecture de ce livre passionné et combien efficace. L'auteure nous conduit vers un homme épris d'absolu, un idéaliste qui rêve de conquérir l'Everest. Le toit du monde. Nous sommes en 1924 dans l'Himalaya, Mallory fait partie de la troisième expédition britannique qui tentera d'atteindre le but qu'elle s'est fixée. L'histoire hors-norme de ce fervent alpiniste est relatée d'une manière fictive, ce qui est un tour de force quand nous savons ce qu'impliquent des recherches sur un homme détenteur d'un mystère jamais élucidé. C'était un distrait, un dandy velléitaire, nous révèle notre propre enquête. L'historien Lytton Strachey, membre du Bloomsbury Group, le décrit, dans une lettre adressée à Virginia Woolf, comme un charmeur auquel ni hommes ni femmes ne résistent. Ruth Turner, l'épouse de Mallory, nous renseigne sur sa beauté physique et son élégance naturelle. Pendant que son mari essaie de réaliser son rêve grandiose de conquérant montagnard, nous suivons Ruth durant une journée, du matin jusqu'au soir ; elle attend son héros tragique en relisant ses lettres, en s'occupant de leurs trois enfants. On a aimé pénétrer l'âme angoissée de Ruth, jeune femme elle aussi d'une grande beauté, dévouée à la cause éperdue de son fou d'altitude, bien qu'elle en souffrît énormément. Riche et condensée, cette chronique intime n'est pas sans rappeler la description de quelque personnage féminin de Virginia Woolf. Douceur grinçante, ennuyeuse, de la vie de Ruth, entrecoupée de l'entreprise difficile, pour ne pas dire surhumaine, de Mallory et de ses compagnons. Conditions harassantes, tensions extrêmes, créent de sournois malentendus qu'aiguise la promiscuité à laquelle ils ne peuvent se soustraire. La montagne ne les épargne pas, elle soumet leur psychisme à une dépression sous-jacente constante, manière de repousser les importuns. Sont dépeints aussi leur lucidité, leur épuisement, leur désir obscur de faire demi-tour. Des drames surviennent. La noyade d'un enfant sherpa, la mort accidentelle d'un de leurs porteurs. Mallory est soupçonné d'être responsable du décès de sept sherpas dû à une imprudence commise lors de la deuxième expédition. A-t-il été fautif de négligence ? Il est considéré comme un homme qui a le goût du risque. Pour lui, une course en montagne est une symphonie. Éternel insatisfait, pouvait-il vaincre l'Everest et se contenter de ce suprême exploit ? On en doute. Plane aussi sur l'équipe l'esprit meurtrier de la Première Guerre mondiale où sera tué le frère de George. Événement mortifère qui creusera davantage le différend l'opposant à son père.
Parmi les huit compagnons de Mallory se démarque un jeune homme, Andrew Irvine — Sandy —, âgé de vingt-deux ans, « étudiant bricoleur » à Oxford, sans expérience de la haute montagne, admirateur inconditionnel de George Mallory. De longues conversations sur moult sujets les rapprochent jusqu'à se demander pourquoi cet engouement l'un pour l'autre. Pourtant, deux femmes peuplent leurs rares moments de solitude. Ruth, épouse de Mallory, à qui il écrit sans cesse. Marjory, mariée à Dick, avec qui Sandy entretient une liaison amoureuse. Deux femmes dans un monde qu'ils ont déserté pour vaincre ce qui, avant eux, ne le fut jamais. À mesure que les jours passent, chaque début de chapitre mentionne le nombre de pieds franchis, localise les camps dressés où tous s'alimentent et se reposent. Parfois, se heurtent. Ils dépendent des saisons, celle de la mousson plus particulièrement. Dans l'Himalaya le climat est rude, il n'accorde aucune concession à ceux qui le négligent. Le 8 juin 1924, Mallory décrète que la voie est ouverte pour une dernière tentative. À la surprise générale, il choisira Andrew Irvine comme coéquipier et non le géologue Noel Odell, « expérimenté et en excellente forme. » Pour expliquer ce geste inconsidéré, Mallory invoque le fait que Sandy a montré sa parfaite connaissance des appareils à oxygène. Nous ne saurons jamais le véritable enjeu de sa décision, les deux hommes ayant disparu dans la journée, au cours d'une tempête, à quelques centaines de pieds du sommet.
Cette fin douloureuse, très bellement supposée, éloquemment décrite par Tanis Rideout, fera en sorte que George Mallory, trente-huit ans, entrera dans la légende. Nul ne saura s'il a atteint le sommet avec son compagnon, aucune preuve matérielle n'existant pour résoudre cette énigme. Seuls les deux appareils photo d'Andrew Irvine détiennent ces témoignages irréfutables. Si le corps momifié de Mallory fut découvert en 1999 par une équipe d'alpinistes allemands, celui d'Irvine, et ses appareils photo, sont restés à ce jour introuvables. Bien des discussions enflammées, des hypothèses interminables ont amplifié, à tort ou à raison, la légende de George Leigh Mallory.
On a lu ce roman tel qu'il est conçu, entre fiction et réalité. Entre le rêve et le cauchemar qu'a traversés cet homme pour aboutir à une solution finale. Celle qu'au fond de lui, il désirait peut-être. On a du mal à imaginer ce que serait devenu ce puriste après qu'il ait vaincu ce qui semblait impossible de l'être à l'époque. T. E. Lawrence, lui-même de la trempe d'aventuriers indomptables, n'a-t-il pas tranché entre une existence insipide et la fin d'un rêve duquel il ne s'est jamais réveillé ? Étrange destinée que celle d'une poignée d'hommes qui, grâce à leur folie, car c'en est une, ont modifié le cours du monde en échange de leur vie.
La traduction de Daniel Lauzon convient parfaitement au ton sensible de ce roman étonnant.
Par-dessus tout, Tanis Rideout
Traduit de l'anglais (Canada) par Daniel Lauzon
VLB éditeur, Montréal, 2014, 400 pages
On connaissait peu George Leigh Mallory avant d'entreprendre la lecture de ce livre passionné et combien efficace. L'auteure nous conduit vers un homme épris d'absolu, un idéaliste qui rêve de conquérir l'Everest. Le toit du monde. Nous sommes en 1924 dans l'Himalaya, Mallory fait partie de la troisième expédition britannique qui tentera d'atteindre le but qu'elle s'est fixée. L'histoire hors-norme de ce fervent alpiniste est relatée d'une manière fictive, ce qui est un tour de force quand nous savons ce qu'impliquent des recherches sur un homme détenteur d'un mystère jamais élucidé. C'était un distrait, un dandy velléitaire, nous révèle notre propre enquête. L'historien Lytton Strachey, membre du Bloomsbury Group, le décrit, dans une lettre adressée à Virginia Woolf, comme un charmeur auquel ni hommes ni femmes ne résistent. Ruth Turner, l'épouse de Mallory, nous renseigne sur sa beauté physique et son élégance naturelle. Pendant que son mari essaie de réaliser son rêve grandiose de conquérant montagnard, nous suivons Ruth durant une journée, du matin jusqu'au soir ; elle attend son héros tragique en relisant ses lettres, en s'occupant de leurs trois enfants. On a aimé pénétrer l'âme angoissée de Ruth, jeune femme elle aussi d'une grande beauté, dévouée à la cause éperdue de son fou d'altitude, bien qu'elle en souffrît énormément. Riche et condensée, cette chronique intime n'est pas sans rappeler la description de quelque personnage féminin de Virginia Woolf. Douceur grinçante, ennuyeuse, de la vie de Ruth, entrecoupée de l'entreprise difficile, pour ne pas dire surhumaine, de Mallory et de ses compagnons. Conditions harassantes, tensions extrêmes, créent de sournois malentendus qu'aiguise la promiscuité à laquelle ils ne peuvent se soustraire. La montagne ne les épargne pas, elle soumet leur psychisme à une dépression sous-jacente constante, manière de repousser les importuns. Sont dépeints aussi leur lucidité, leur épuisement, leur désir obscur de faire demi-tour. Des drames surviennent. La noyade d'un enfant sherpa, la mort accidentelle d'un de leurs porteurs. Mallory est soupçonné d'être responsable du décès de sept sherpas dû à une imprudence commise lors de la deuxième expédition. A-t-il été fautif de négligence ? Il est considéré comme un homme qui a le goût du risque. Pour lui, une course en montagne est une symphonie. Éternel insatisfait, pouvait-il vaincre l'Everest et se contenter de ce suprême exploit ? On en doute. Plane aussi sur l'équipe l'esprit meurtrier de la Première Guerre mondiale où sera tué le frère de George. Événement mortifère qui creusera davantage le différend l'opposant à son père.
Parmi les huit compagnons de Mallory se démarque un jeune homme, Andrew Irvine — Sandy —, âgé de vingt-deux ans, « étudiant bricoleur » à Oxford, sans expérience de la haute montagne, admirateur inconditionnel de George Mallory. De longues conversations sur moult sujets les rapprochent jusqu'à se demander pourquoi cet engouement l'un pour l'autre. Pourtant, deux femmes peuplent leurs rares moments de solitude. Ruth, épouse de Mallory, à qui il écrit sans cesse. Marjory, mariée à Dick, avec qui Sandy entretient une liaison amoureuse. Deux femmes dans un monde qu'ils ont déserté pour vaincre ce qui, avant eux, ne le fut jamais. À mesure que les jours passent, chaque début de chapitre mentionne le nombre de pieds franchis, localise les camps dressés où tous s'alimentent et se reposent. Parfois, se heurtent. Ils dépendent des saisons, celle de la mousson plus particulièrement. Dans l'Himalaya le climat est rude, il n'accorde aucune concession à ceux qui le négligent. Le 8 juin 1924, Mallory décrète que la voie est ouverte pour une dernière tentative. À la surprise générale, il choisira Andrew Irvine comme coéquipier et non le géologue Noel Odell, « expérimenté et en excellente forme. » Pour expliquer ce geste inconsidéré, Mallory invoque le fait que Sandy a montré sa parfaite connaissance des appareils à oxygène. Nous ne saurons jamais le véritable enjeu de sa décision, les deux hommes ayant disparu dans la journée, au cours d'une tempête, à quelques centaines de pieds du sommet.
Cette fin douloureuse, très bellement supposée, éloquemment décrite par Tanis Rideout, fera en sorte que George Mallory, trente-huit ans, entrera dans la légende. Nul ne saura s'il a atteint le sommet avec son compagnon, aucune preuve matérielle n'existant pour résoudre cette énigme. Seuls les deux appareils photo d'Andrew Irvine détiennent ces témoignages irréfutables. Si le corps momifié de Mallory fut découvert en 1999 par une équipe d'alpinistes allemands, celui d'Irvine, et ses appareils photo, sont restés à ce jour introuvables. Bien des discussions enflammées, des hypothèses interminables ont amplifié, à tort ou à raison, la légende de George Leigh Mallory.
On a lu ce roman tel qu'il est conçu, entre fiction et réalité. Entre le rêve et le cauchemar qu'a traversés cet homme pour aboutir à une solution finale. Celle qu'au fond de lui, il désirait peut-être. On a du mal à imaginer ce que serait devenu ce puriste après qu'il ait vaincu ce qui semblait impossible de l'être à l'époque. T. E. Lawrence, lui-même de la trempe d'aventuriers indomptables, n'a-t-il pas tranché entre une existence insipide et la fin d'un rêve duquel il ne s'est jamais réveillé ? Étrange destinée que celle d'une poignée d'hommes qui, grâce à leur folie, car c'en est une, ont modifié le cours du monde en échange de leur vie.
La traduction de Daniel Lauzon convient parfaitement au ton sensible de ce roman étonnant.
Par-dessus tout, Tanis Rideout
Traduit de l'anglais (Canada) par Daniel Lauzon
VLB éditeur, Montréal, 2014, 400 pages
lundi 7 juillet 2014
La route et ses déroutes *** 1/2
Il en faut du courage et de l'audace, sinon une générosité obstinée, à U., soixante-douze ans, pour entretenir, depuis trois ans, une relation amoureuse avec un homme de trente-quatre ans son cadet. Femme couguar, on vous admire, car malgré notre désir de nous montrer insolente face aux bien-pensants, on n'oserait vous suivre sur cette voie sans issue. On a terminé de lire le numéro 118 de la revue XYZ. La revue de la nouvelle.
La route exerce une fascination indubitable sur les écrivains d'hier et d'aujourd'hui. Citons pour exemple Jack Kerouac, Henry Miller, Jacques Poulin. Le dernier en date, Christian Guay-Poliquin, auteur du roman Le fil des kilomètres, duquel on a parlé dans notre blogue. Il était prévisible que le thème de la route tente une revue littéraire et quelques écrivains invités par David Dorais, qui a piloté cette dernière livraison. Lui-même nous propose un récit peu orthodoxe. Un homme se souvient de sa conversion dans une chambre d'hôtel minable, à Atlanta. L'atmosphère suffocante amenée dès la première ligne crée l'ambiance nauséeuse qui règne dans la ville. La pourriture des êtres, leurs conditions de survie abominables au temps des « Négros » assujettis aux Blancs, des « Négresses » qui, malgré elles, se prostituent. C'est l'une d'elles, plus misérable que ses consœurs qui, tel le pilier de Notre-Dame de Paris enveloppant Paul Claudel, jouera le rôle de sa « sœur en Christ. » On ne sait qui croire des deux intéressés, David Dorais créant une métaphorique ambivalence de lecture.
Des nuits angoissantes, des hôtels de passage, des restos douteux, des femmes et des hommes ordinaires ou pitoyables, sillonnent des routes brusquement entravées d'un obstacle. Un rêve inabouti comme dans la nouvelle de Catherine Mavrikakis. Une fillette narre comment sa mère aimerait se rendre à Nashville en RV de luxe. Passionnée de folklore, de musique country, elle attend le retour de son mari parti à Seattle en voyage d'affaires. Pendant ce temps, la jeune narratrice et ses deux frères occupent joyeusement le RV stationné dans leur entrée de garage, qu'un ami leur a prêté. C'est pendant une nuit qu'un homme, imaginé par Raymond Bock, Les grillons, s'arrête devant l'enseigne d'un restaurant. Il a envie d'uriner, de manger, il a pris la route au hasard, à quatre heures de l'après-midi. Il n'en peut plus du néant de sa vie, il désire il ne sait trop quoi. Il ne peut voir que le crasseux autour de lui, en lui. Il n'a envie de rien. Il n'a pas de passeport, il ne sait où aller. Soudain, les cris d'effroi de deux jeunes enfants le sortent de son marasme. Quand le tumulte se calme, il n'entend plus que la stridulation des grillons. On a aimé le désespoir de cet inconnu qui attend, espère tant de lui-même. Un récit pathétique signé Jean-Simon DesRochers, La terre de personne, nous montre un jeune divorcé, Charles, réfugié dans un hôtel avec ses deux enfants, à la veille d'une tempête de neige. Il est au centre d'un univers d'hommes affublés de sa condition : tous partagent la garde des enfants avec leur ex-femme venue quérir leur progéniture pour la fin de semaine. Charles est terriblement fatigué, une mauvaise grippe le mine ; Liliane et Jérémie confiés à leur mère, il n'a qu'un désir, celui de dormir dans la chambre 19, là où des décennies plus tôt, son père et sa mère l'ont conçu. La chambre supposée d'un hôtel anonyme serait-elle la terre de personne ?
Un solide et attendrissant texte de Suzanne Myre titré À la frontière du sourire, nous a beaucoup touchée. Une douanière ne peut oublier la petite fille blonde qui envahit ses rêves. Une dizaine d'années plus tôt, « l'homme qui était dans sa vie » a refusé d'assumer sa paternité ; il l'a quittée, elle s'est faite avorter. Depuis, elle mène la vie dure aux automobilistes qui franchissent la frontière qu'elle surveille, maussade, rancunière. Une petite fille albinos, passagère singulière dans la voiture de ses parents, lui offrira, avec la complicité de sa mère, son ours en peluche.
Plusieurs textes ont attisé notre désir d'arpenter des routes oubliées, celle de l'enfance, du premier émoi sexuel suscité incidemment par une image pornographique, dépeinte par Nicolas Charette, J'étais un garçon normal. Celle de Jean Pierre Girard, «Mavie», un homme se souvient d'une jeune fille qu'il a aimée, qu'il a défendue contre une « bande de larves » qui essayait de l'attaquer. De la mort accidentelle de Jacques, son ami d'adolescence. Douloureux amalgame de deux événements survenus « dans ce bouge poussiéreux des États-Unis d'Amérique », quatre ans plus tôt.
Dans la rubrique " Thème libre ", la nouvelle de David Clerson, Bob : l'ordre et le désordre, nous a fascinée : un homme et son ombre, celle-ci témoignant de ce qu'il est. Lui aussi roule sur une autoroute américaine. Ce phénomène de la route serait-il relié à l'Amérique du Nord ? À l'influence des écrivains états-uniens hantés par un ailleurs, « itinéraire linéaire et ordonné » ou un besoin de rompre une certaine monotonie ?
Ce dernier numéro de la revue XYZ, nous a particulièrement intéressée. On a poursuivi sans pause, au bord de notre propre route, le parcours chaotique d'hommes et de femmes qui ont fait du pouce à l'extérieur de leur territoire, à l'intérieur de leur clos. En friche, il va de soi. Pour tirer une conclusion sur ce numéro exceptionnel, on rêve que les routes aient été construites par des hommes épris d'une fraternelle liberté.
Nouvelles de la route. XYZ. La revue de la nouvelle.
Numéro 118 piloté par David Dorais
Montréal, 2014, 102 pages
La route exerce une fascination indubitable sur les écrivains d'hier et d'aujourd'hui. Citons pour exemple Jack Kerouac, Henry Miller, Jacques Poulin. Le dernier en date, Christian Guay-Poliquin, auteur du roman Le fil des kilomètres, duquel on a parlé dans notre blogue. Il était prévisible que le thème de la route tente une revue littéraire et quelques écrivains invités par David Dorais, qui a piloté cette dernière livraison. Lui-même nous propose un récit peu orthodoxe. Un homme se souvient de sa conversion dans une chambre d'hôtel minable, à Atlanta. L'atmosphère suffocante amenée dès la première ligne crée l'ambiance nauséeuse qui règne dans la ville. La pourriture des êtres, leurs conditions de survie abominables au temps des « Négros » assujettis aux Blancs, des « Négresses » qui, malgré elles, se prostituent. C'est l'une d'elles, plus misérable que ses consœurs qui, tel le pilier de Notre-Dame de Paris enveloppant Paul Claudel, jouera le rôle de sa « sœur en Christ. » On ne sait qui croire des deux intéressés, David Dorais créant une métaphorique ambivalence de lecture.
Des nuits angoissantes, des hôtels de passage, des restos douteux, des femmes et des hommes ordinaires ou pitoyables, sillonnent des routes brusquement entravées d'un obstacle. Un rêve inabouti comme dans la nouvelle de Catherine Mavrikakis. Une fillette narre comment sa mère aimerait se rendre à Nashville en RV de luxe. Passionnée de folklore, de musique country, elle attend le retour de son mari parti à Seattle en voyage d'affaires. Pendant ce temps, la jeune narratrice et ses deux frères occupent joyeusement le RV stationné dans leur entrée de garage, qu'un ami leur a prêté. C'est pendant une nuit qu'un homme, imaginé par Raymond Bock, Les grillons, s'arrête devant l'enseigne d'un restaurant. Il a envie d'uriner, de manger, il a pris la route au hasard, à quatre heures de l'après-midi. Il n'en peut plus du néant de sa vie, il désire il ne sait trop quoi. Il ne peut voir que le crasseux autour de lui, en lui. Il n'a envie de rien. Il n'a pas de passeport, il ne sait où aller. Soudain, les cris d'effroi de deux jeunes enfants le sortent de son marasme. Quand le tumulte se calme, il n'entend plus que la stridulation des grillons. On a aimé le désespoir de cet inconnu qui attend, espère tant de lui-même. Un récit pathétique signé Jean-Simon DesRochers, La terre de personne, nous montre un jeune divorcé, Charles, réfugié dans un hôtel avec ses deux enfants, à la veille d'une tempête de neige. Il est au centre d'un univers d'hommes affublés de sa condition : tous partagent la garde des enfants avec leur ex-femme venue quérir leur progéniture pour la fin de semaine. Charles est terriblement fatigué, une mauvaise grippe le mine ; Liliane et Jérémie confiés à leur mère, il n'a qu'un désir, celui de dormir dans la chambre 19, là où des décennies plus tôt, son père et sa mère l'ont conçu. La chambre supposée d'un hôtel anonyme serait-elle la terre de personne ?
Un solide et attendrissant texte de Suzanne Myre titré À la frontière du sourire, nous a beaucoup touchée. Une douanière ne peut oublier la petite fille blonde qui envahit ses rêves. Une dizaine d'années plus tôt, « l'homme qui était dans sa vie » a refusé d'assumer sa paternité ; il l'a quittée, elle s'est faite avorter. Depuis, elle mène la vie dure aux automobilistes qui franchissent la frontière qu'elle surveille, maussade, rancunière. Une petite fille albinos, passagère singulière dans la voiture de ses parents, lui offrira, avec la complicité de sa mère, son ours en peluche.
Plusieurs textes ont attisé notre désir d'arpenter des routes oubliées, celle de l'enfance, du premier émoi sexuel suscité incidemment par une image pornographique, dépeinte par Nicolas Charette, J'étais un garçon normal. Celle de Jean Pierre Girard, «Mavie», un homme se souvient d'une jeune fille qu'il a aimée, qu'il a défendue contre une « bande de larves » qui essayait de l'attaquer. De la mort accidentelle de Jacques, son ami d'adolescence. Douloureux amalgame de deux événements survenus « dans ce bouge poussiéreux des États-Unis d'Amérique », quatre ans plus tôt.
Dans la rubrique " Thème libre ", la nouvelle de David Clerson, Bob : l'ordre et le désordre, nous a fascinée : un homme et son ombre, celle-ci témoignant de ce qu'il est. Lui aussi roule sur une autoroute américaine. Ce phénomène de la route serait-il relié à l'Amérique du Nord ? À l'influence des écrivains états-uniens hantés par un ailleurs, « itinéraire linéaire et ordonné » ou un besoin de rompre une certaine monotonie ?
Ce dernier numéro de la revue XYZ, nous a particulièrement intéressée. On a poursuivi sans pause, au bord de notre propre route, le parcours chaotique d'hommes et de femmes qui ont fait du pouce à l'extérieur de leur territoire, à l'intérieur de leur clos. En friche, il va de soi. Pour tirer une conclusion sur ce numéro exceptionnel, on rêve que les routes aient été construites par des hommes épris d'une fraternelle liberté.
Nouvelles de la route. XYZ. La revue de la nouvelle.
Numéro 118 piloté par David Dorais
Montréal, 2014, 102 pages
lundi 23 juin 2014
Ce que nous ne deviendrons jamais *** 1/2
À propos de l'homme dans notre blogue, qui se cache derrière nous. Que de curiosité malsaine, de questions indiscrètes, d'indifférence feinte il a suscitées. Que de ricanements cancaniers, de silences médisants, de sibyllines suppositions il a fait naître. Il y a ceux et celles qui, complices attendris, ont éclaté de rire avec nous. On veut dire, lui et nous. Parlons des nouvelles de Hans-Jürgen Greif, Échardes.
Quarante-quatre textes brefs, incisifs. Lucides, au style acéré. Divisés en cinq parties. Autant d'images qui ne sont pas sans rappeler la précision avec laquelle un film se déroule, film de la vie dans ce cas-ci. Si le temps joue un rôle important dans la situation précaire de personnages dépeints par l'écrivain, il était nécessaire de démontrer au lecteur qu'un rien suffit pour que s'effondrent nos préjugés, nos manières de regarder les êtres se démenant autour de nous. Et aussi notre crédulité face aux hommes et femmes impuissants parce que trop âgés pour fuir la mort qui finit par les rattraper. Des centenaires font semblant d'être présents, certains voudraient mourir mais la mort les dédaigne. Un jour, un soir, ils finissent par s'éteindre, nous ne savons pas, nous ne saurons jamais quelles ont été leurs dernières pensées. Leur regard ultime posé sur une chose floue, à peine effleurée. Le mot est juste, il y a de l'effleurement dans les gestes et les regards quand la vie se languit et se fluidifie. Quelques-unes de ces vieilles personnes, ne voulant pas s'avouer vaincues, triomphent de survivre à un nouveau matin. Atteindront-elles la nuit, celle-ci s'avérant perfide, indécente, quand s'acharne la Grande Faucheuse.
Tous ces récits remettent en cause la condition humaine, sa dignité, son intégrité. Sa bassesse, sa fourberie. Son égoïsme. La grandeur de l'existence mais aussi sa banalité. Des femmes qui se croient indispensables, des hommes qui ne sont pas dupes, des blessures infligées aux autres, commises à l'égard de soi-même. Des échardes sous la peau, sous les ongles. Ce sont là les grands traits des nouvelles proposées par cet écrivain prolifique, qui ne cesse d'étonner tant son sens de l'observation est aigu, sa compassion envers ses personnages enrobée d'une fatalité contre laquelle il est inutile de lutter, ni essayer de combattre, le fulgurant destin de chacun étant de se plier aux exigences de situations écartées de ses choix. La réalité, aussi mesquine soit-elle, l'emporte sur l'utopie, les individus nous défaisant de nos illusions. Vacuité de la vie qui se tresse malgré soi.
Le temps élastique, les lieux cosmopolites, les milieux professionnels balisent ces quarante-quatre histoires. On ne les titre pas individuellement, on se souvient, on se délecte de leur ensemble. Elles réjouissent ou effraient. Font sourire ou attristent. On croit connaître l'être humain, il n'en est rien. La vanité trop souvent fait figure de trahison, d'esprit mesquin. Que vaut la nature humaine quand elle régit ses semblables ? Hans-Jürgen Greif répond au lecteur avec indulgence et humour ; l'être humain occupant le centre de son œuvre, ses forces, ses faiblesses permettent à l'auteur de l'évaluer à sa juste mesure, ce qui enrichit les protagonistes d'une dimension autrement marginale que celle stéréotypée de leurs agissements. L'ouvrage ne rendant compte que du microcosme d'une société perçue par l'œil scrutateur d'un écrivain chaque fois que se manifeste un individu aux prises avec ses démons, petits ou grands. On se dit que, trop désespérant, ce dernier ne vaudrait pas la peine que nous nous attardions sur ce qu'il représente depuis qu'il est, depuis qu'il nous harcèle, nous séduit. Lui donner une importance, comme l'a fait si rigoureusement Hans-Jürgen Greif, signifie que le bénéfice du doute lui est accordé, la nudité de son âme se révélant moins arbitraire que les appeaux sous lesquels il s'affuble pour mieux se laisser prendre au désabusement vital dont il est plusieurs fois la proie naïve.
À lire, pour se faire une idée de ce que nous sommes. Et serons toujours malgré les épreuves, malgré les promesses discréditées. Nous ne deviendrons jamais, le caractère de nos empreintes morales s'avérant indélébile, efficacement prégnant.
Échardes, Hans-Jürgen Greif,
Éditions L'instant même, Québec, 2014, 268 pages
Quarante-quatre textes brefs, incisifs. Lucides, au style acéré. Divisés en cinq parties. Autant d'images qui ne sont pas sans rappeler la précision avec laquelle un film se déroule, film de la vie dans ce cas-ci. Si le temps joue un rôle important dans la situation précaire de personnages dépeints par l'écrivain, il était nécessaire de démontrer au lecteur qu'un rien suffit pour que s'effondrent nos préjugés, nos manières de regarder les êtres se démenant autour de nous. Et aussi notre crédulité face aux hommes et femmes impuissants parce que trop âgés pour fuir la mort qui finit par les rattraper. Des centenaires font semblant d'être présents, certains voudraient mourir mais la mort les dédaigne. Un jour, un soir, ils finissent par s'éteindre, nous ne savons pas, nous ne saurons jamais quelles ont été leurs dernières pensées. Leur regard ultime posé sur une chose floue, à peine effleurée. Le mot est juste, il y a de l'effleurement dans les gestes et les regards quand la vie se languit et se fluidifie. Quelques-unes de ces vieilles personnes, ne voulant pas s'avouer vaincues, triomphent de survivre à un nouveau matin. Atteindront-elles la nuit, celle-ci s'avérant perfide, indécente, quand s'acharne la Grande Faucheuse.
Tous ces récits remettent en cause la condition humaine, sa dignité, son intégrité. Sa bassesse, sa fourberie. Son égoïsme. La grandeur de l'existence mais aussi sa banalité. Des femmes qui se croient indispensables, des hommes qui ne sont pas dupes, des blessures infligées aux autres, commises à l'égard de soi-même. Des échardes sous la peau, sous les ongles. Ce sont là les grands traits des nouvelles proposées par cet écrivain prolifique, qui ne cesse d'étonner tant son sens de l'observation est aigu, sa compassion envers ses personnages enrobée d'une fatalité contre laquelle il est inutile de lutter, ni essayer de combattre, le fulgurant destin de chacun étant de se plier aux exigences de situations écartées de ses choix. La réalité, aussi mesquine soit-elle, l'emporte sur l'utopie, les individus nous défaisant de nos illusions. Vacuité de la vie qui se tresse malgré soi.
Le temps élastique, les lieux cosmopolites, les milieux professionnels balisent ces quarante-quatre histoires. On ne les titre pas individuellement, on se souvient, on se délecte de leur ensemble. Elles réjouissent ou effraient. Font sourire ou attristent. On croit connaître l'être humain, il n'en est rien. La vanité trop souvent fait figure de trahison, d'esprit mesquin. Que vaut la nature humaine quand elle régit ses semblables ? Hans-Jürgen Greif répond au lecteur avec indulgence et humour ; l'être humain occupant le centre de son œuvre, ses forces, ses faiblesses permettent à l'auteur de l'évaluer à sa juste mesure, ce qui enrichit les protagonistes d'une dimension autrement marginale que celle stéréotypée de leurs agissements. L'ouvrage ne rendant compte que du microcosme d'une société perçue par l'œil scrutateur d'un écrivain chaque fois que se manifeste un individu aux prises avec ses démons, petits ou grands. On se dit que, trop désespérant, ce dernier ne vaudrait pas la peine que nous nous attardions sur ce qu'il représente depuis qu'il est, depuis qu'il nous harcèle, nous séduit. Lui donner une importance, comme l'a fait si rigoureusement Hans-Jürgen Greif, signifie que le bénéfice du doute lui est accordé, la nudité de son âme se révélant moins arbitraire que les appeaux sous lesquels il s'affuble pour mieux se laisser prendre au désabusement vital dont il est plusieurs fois la proie naïve.
À lire, pour se faire une idée de ce que nous sommes. Et serons toujours malgré les épreuves, malgré les promesses discréditées. Nous ne deviendrons jamais, le caractère de nos empreintes morales s'avérant indélébile, efficacement prégnant.
Échardes, Hans-Jürgen Greif,
Éditions L'instant même, Québec, 2014, 268 pages
lundi 16 juin 2014
Là où la vie hésite ***
Un siècle plus tôt, il lui écrivait : " Venir vers vous, c'est me perdre." Qui oserait de nos jours matérialistes, se perdre dans l'amour d'un homme ou d'une femme ? Il est tellement rassurant d'emprunter le droit chemin, de ne pas s'égarer sur des routes balisées d'interdits. Plus tard, au seuil de la vieillesse, que reste-t-il de ces rendez-vous manqués, mis à part le regret de s'être dérobé à une fraction de lumière intérieure ? On parle du recueil de nouvelles de Frederick Letia, Les chroniques de l'inquiétude.
Sept textes où l'angoisse, la peur, les incertitudes mènent le bal. À notre époque superficielle qui nous cerne jusqu'à nous corrompre, il est tentant de se laisser aller à rêver plutôt que de concrétiser nos désirs. Même si la conscience, de temps à autre, nous titille, elle est vite remisée dans les turbulences de nos journées, dans le sommeil agité de nos nuits. Frederick Letia donne la parole à des hommes et des femmes qui nous font part de leur déconvenue, ont peu fait pour dériver loin de leur randonnée tortueuse. Pourtant, ces événements marquants ont défiguré le présent au point de se poser de vaines questions. Jutra, personnage éponyme de la première nouvelle, narre à un homme l'amour qu'elle a porté à un artiste peintre « originaire de Namur. » Quand les sentiments excessifs de Jutra, auxquels il a cédé, l'ont accaparé, il a profité de son absence pour fuir, retourner dans son pays natal. Fuir l'être aimé pour préserver sa liberté, éviter de trop se compromettre au seuil d'une existence rangée, n'est-ce point là la peur que tout homme appréhende ? Si ce court récit donne le ton à ceux qui suivront, on doute fortement de sa touche finale. Incapable de prendre une décision et bien qu'elle en soit malheureuse, Aisha partagera deux amants pour qui elle éprouve un amour violent mais différent. Durant une soirée mondaine, la jeune femme impressionnera un invité qui se fera raconter son histoire par une amie commune, présente elle aussi à cette soirée. Ce texte mettant en scène des femmes et des hommes orientaux, il est plausible que le destin soit une raison légitime de ne pas le troubler, un relatif bonheur se tressant au rythme de la peur que chacun ressent. Jusqu'à quand ce mouvement métronomique ? Le professeur, individu qui occupe le troisième récit, doit donner une conférence, déclic imprévisible sur ses années d'enseignant, de chercheur solitaire. Enfermé dans sa tour d'ivoire, il n'a su voir les êtres qui l'ont aimé. Un mariage raté, une profession exigeante, des amis inexistants. Il ne vit que pour l'Histoire et ses embûches. À Toronto, ville où il doit donner sa conférence, un incident se produira qui changera le cours de sa propre histoire. Dénouement inattendu, heureux et courageux.
Deux narrations qui drainent des rêves sans intention de les formuler. Ils décevraient, se conjugueraient à la banalité du quotidien. L'un, Max Gianni, à peine quarante ans, a acheté une crèmerie, fabule sur la qualité exceptionnelle des produits qu'il offrira à ses clients mais tarde toujours à ouvrir son magasin. Il ne sait trop pourquoi il a peur, de cette peur paralysante qui empêche de regarder la réalité les yeux grands ouverts. L'autre, « un monsieur très fortuné » « veuf de fraîche date » a une passion secrète, il rêve de posséder un voilier. De parcourir les mers idéalisées par Melville, Conrad et Loti. Quand il achètera le voilier idéal, ses rêves prendront tournure de délire. Pour contrer ses peurs de naviguer seul, il ne cesse de rénover son bateau, « d'effacer toute trace de l'ancien maître. » Pendant trois ans, son sloop restera à quai. Jusqu'au jour où il se décide enfin à rassembler les plaisanciers à une somptueuse réception à bord de son voilier. Le cœur n'y est plus, le cœur vacille. Le rêve ne peut que faire naufrage. Autre naufrage pathétique, celui d'une femme, Madeleine, qui, pendant des années, a aimé un homme qui a refusé de s'engager. Homme indifférent, se suffisant à ce qu'il est, pas grand-chose de consistant, il est soudainement pris de remords envers son ancienne compagne qu'il a quittée pour suivre Madeleine. Drame qui se déroule dans le huis clos d'une auberge, relaté par Madeleine à un inconnu de passage. Même si les agissements de cette femme passionnée nous ont surprise, ce texte reste le plus séduisant du nombre, le dernier, Le yâbe, semblant avoir été rattaché à l'ensemble du recueil. Il est à considérer que ce sont les femmes, peu nombreuses, qui prennent leur vie en main malgré les miettes qu'elles récoltent. Les hommes rêvent, se défilent. Ou meurent.
Ces nouvelles à la thématique moderne, conformes à notre époque basée sur la peur d'échouer, sur la crainte de décevoir, sur l'angoisse de perdre, auraient mérité d'être resserrées, d'être moins prolixes, trop éparpillées qu'elles sont dans des considérations de surface. L'ensemble y aurait gagné en rigueur, le plaisir de lecture s'y serait ressenti. N'est-ce pas l'art de la nouvelle que de savoir déjouer les non-dits ?
Les chroniques de l'inquiétude, Frederick Letia
Les éditions Sémaphore, Montréal, 2014, 132 pages
Sept textes où l'angoisse, la peur, les incertitudes mènent le bal. À notre époque superficielle qui nous cerne jusqu'à nous corrompre, il est tentant de se laisser aller à rêver plutôt que de concrétiser nos désirs. Même si la conscience, de temps à autre, nous titille, elle est vite remisée dans les turbulences de nos journées, dans le sommeil agité de nos nuits. Frederick Letia donne la parole à des hommes et des femmes qui nous font part de leur déconvenue, ont peu fait pour dériver loin de leur randonnée tortueuse. Pourtant, ces événements marquants ont défiguré le présent au point de se poser de vaines questions. Jutra, personnage éponyme de la première nouvelle, narre à un homme l'amour qu'elle a porté à un artiste peintre « originaire de Namur. » Quand les sentiments excessifs de Jutra, auxquels il a cédé, l'ont accaparé, il a profité de son absence pour fuir, retourner dans son pays natal. Fuir l'être aimé pour préserver sa liberté, éviter de trop se compromettre au seuil d'une existence rangée, n'est-ce point là la peur que tout homme appréhende ? Si ce court récit donne le ton à ceux qui suivront, on doute fortement de sa touche finale. Incapable de prendre une décision et bien qu'elle en soit malheureuse, Aisha partagera deux amants pour qui elle éprouve un amour violent mais différent. Durant une soirée mondaine, la jeune femme impressionnera un invité qui se fera raconter son histoire par une amie commune, présente elle aussi à cette soirée. Ce texte mettant en scène des femmes et des hommes orientaux, il est plausible que le destin soit une raison légitime de ne pas le troubler, un relatif bonheur se tressant au rythme de la peur que chacun ressent. Jusqu'à quand ce mouvement métronomique ? Le professeur, individu qui occupe le troisième récit, doit donner une conférence, déclic imprévisible sur ses années d'enseignant, de chercheur solitaire. Enfermé dans sa tour d'ivoire, il n'a su voir les êtres qui l'ont aimé. Un mariage raté, une profession exigeante, des amis inexistants. Il ne vit que pour l'Histoire et ses embûches. À Toronto, ville où il doit donner sa conférence, un incident se produira qui changera le cours de sa propre histoire. Dénouement inattendu, heureux et courageux.
Deux narrations qui drainent des rêves sans intention de les formuler. Ils décevraient, se conjugueraient à la banalité du quotidien. L'un, Max Gianni, à peine quarante ans, a acheté une crèmerie, fabule sur la qualité exceptionnelle des produits qu'il offrira à ses clients mais tarde toujours à ouvrir son magasin. Il ne sait trop pourquoi il a peur, de cette peur paralysante qui empêche de regarder la réalité les yeux grands ouverts. L'autre, « un monsieur très fortuné » « veuf de fraîche date » a une passion secrète, il rêve de posséder un voilier. De parcourir les mers idéalisées par Melville, Conrad et Loti. Quand il achètera le voilier idéal, ses rêves prendront tournure de délire. Pour contrer ses peurs de naviguer seul, il ne cesse de rénover son bateau, « d'effacer toute trace de l'ancien maître. » Pendant trois ans, son sloop restera à quai. Jusqu'au jour où il se décide enfin à rassembler les plaisanciers à une somptueuse réception à bord de son voilier. Le cœur n'y est plus, le cœur vacille. Le rêve ne peut que faire naufrage. Autre naufrage pathétique, celui d'une femme, Madeleine, qui, pendant des années, a aimé un homme qui a refusé de s'engager. Homme indifférent, se suffisant à ce qu'il est, pas grand-chose de consistant, il est soudainement pris de remords envers son ancienne compagne qu'il a quittée pour suivre Madeleine. Drame qui se déroule dans le huis clos d'une auberge, relaté par Madeleine à un inconnu de passage. Même si les agissements de cette femme passionnée nous ont surprise, ce texte reste le plus séduisant du nombre, le dernier, Le yâbe, semblant avoir été rattaché à l'ensemble du recueil. Il est à considérer que ce sont les femmes, peu nombreuses, qui prennent leur vie en main malgré les miettes qu'elles récoltent. Les hommes rêvent, se défilent. Ou meurent.
Ces nouvelles à la thématique moderne, conformes à notre époque basée sur la peur d'échouer, sur la crainte de décevoir, sur l'angoisse de perdre, auraient mérité d'être resserrées, d'être moins prolixes, trop éparpillées qu'elles sont dans des considérations de surface. L'ensemble y aurait gagné en rigueur, le plaisir de lecture s'y serait ressenti. N'est-ce pas l'art de la nouvelle que de savoir déjouer les non-dits ?
Les chroniques de l'inquiétude, Frederick Letia
Les éditions Sémaphore, Montréal, 2014, 132 pages