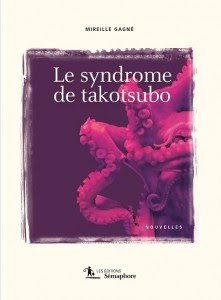Les mots, ces petits vocables remplis de pouvoir néfaste ou conciliateur. Chacun les utilise à sa manière, pour faire ou défaire son propre monde. Il nous est arrivé de poser la question, à savoir si les mots avaient quelque importance dans une conversation qu'on menait avec franchise. La réponse fut mensongère, on a su depuis, pour l'avoir éprouvé, que les mots n'étaient que matamores, à l'image de la personne qui les prononçait. On commente le recueil de nouvelles de Mireille Gagné, Le syndrome de takotsubo.
Ce sont d'étranges fictions aux titres quelque peu intrigants, abrégées d'un sous-titre qui semble éclairer une histoire brève, intimiste, comme doit l'imposer le genre. Dix-sept nouvelles qui mettent en vedette le cœur humain et ses aléas. Parfois, il est sur le point d'éclater, ou bien, moins fougueux, il se repose. Ses battements servent de baromètre à qui subit les avatars que concocte notre existence, nous rendent vulnérables, faillibles ou plus forts. Petite musique qui devrait nous faire sourire à mesure que nous grandissons. On généralise le rôle éprouvant du cœur, celui-ci se fatigant à énumérer les états d'âme des protagonistes qui peuplent le recueil. Un étrange syndrome l'afflige, bien heureusement explicité par la nouvellière. Un éclatement de l'organe qui permet de circuler dans et hors de sentiers battus.
Témoignant de l'état harassé des personnages, la première nouvelle nous apprend que le pire reste à venir quand un couple japonais émigre sur un continent totalement inconnu. C'était il y a longtemps, mais peu de changements sont survenus face à l'étranger qui essaie de se faire une place non au soleil mais dans l'ombre des natifs du pays d'accueil. Ces émigrants ont beau user de discrétion, de patience, taire la douleur, rien n'y fait, il faut toujours prouver. Ne reste qu'une honteuse blessure qui s'avère l'échec cuisant de l'aventure. Des forces antinomiques se manifestent, elles ordonnent de retourner au pays natal. Le cœur peut être aussi un miroir, celui des yeux d'un bourreau envers une femme qui, par jalousie, a tué son mari. Elle est condamnée à être pendue. Un texte qui reviendra ranimer les arcanes fragiles du cœur, à deux ou trois reprises, tel un refus à disparaitre. La narratrice, d'une lucidité implacable, dépeindra sa condition de criminelle, sans aucun remords. Une autre fiction relate au lecteur comment nous pouvons perdre nos acquis quand notre prénom se heurte à un organisme social ou politique, nous défaisant de notre pouvoir identitaire. Combattre les péripéties qui font et défont ce que nous sommes. Le pouvoir public fait partie du pire qui accable un individu quand il est victime d'une crise cardiaque dans une limousine. La jeune femme qui l'accompagne n'a plus qu'à se réfugier dans son « petit appartement délabré », donnant presque la parole à un enfant victime lui aussi de l'atrophie de son prénom. Boucle étonnante que ce texte conduisant le lecteur vers un cœur brisé. Une femme quitte son mari à l'aube pour aller travailler. Le soir, elle lui téléphone qu'elle sortira avec ses amies, ce qui le désespère, sachant très bien qu'elle ment. Elle a besoin d'un homme autre que lui. Seul le corps se donne et se prend. Pendant cette nuit hostile, le cœur de l'homme a cessé de battre. Conclusion surprenante qui révèle la qualité de ces récits, l'écriture servant d'exutoire à des êtres fictifs que la vie nous fait rencontrer, essaimés par de curieux hasards.
Tout le livre est ainsi. Bondé de cœurs épuisés. Bardé de cœurs défaillants. De corps qui se démènent comme ils peuvent. Il y a aussi des cris qui s'ajustent à des situations desquelles une femme ou un homme n'est pas toujours responsable. Dans le récit, Le cri n'est pas une parole hermétique, la narratrice se souvient de son angoisse mêlée à la fierté, quand son père, un an avant de mourir, l'a initiée à la chasse. Père de peu de mots mais de gestes conséquents. Elle devait tuer les oies au moment de leur migration. Son incapacité à les achever si elles n'étaient que blessées par son tir maladroit. Aujourd'hui, à l'agonie, le père refuse à s'en aller. Il faudra les paroles apaisantes de la mère pour que le cœur cesse de battre. Nouvelle émouvante, prépondérant l'amour filial, comme souvent cela se produit entre un père et sa fille. Tout est relatif, ramène le lecteur à une réalité qui mine une langue quand, dans un pays non affirmé, elle devient minoritaire. À sa manière, le narrateur, qui enseigne le français à des adolescents, le défend à travers un sentiment passionnel qu'il éprouve pour une de ses étudiantes. Il sera radié du corps enseignant, devra se convertir à une profession inadéquate, lui, qui a connu la mort de près. Mort symbolique, mort du cœur sous la peau. Il y a des alertes qui ne trompent pas, des blessures qui ne cicatrisent pas, des gémissements, des cris. Des murmures qui font de ces textes une panoplie d'identités flouées, nous rappelant que nos sentiments naissent à partir d'une appellation intimiste, personnifiée et non généralisée dans un monde qui se prête à toutes les manigances. Ceux et celles qui échappent à cette condition, s'égarent loin des conventions, ne sont plus que des errants, cédant aux cauchemars, à la mort, parce qu'il « existe des endroits pour mourir ». Un temple japonais, par exemple. Autre marginal, cet homme qui ne parvient plus à remplir la feuille blanche, frustré au point de suivre une femme rencontrée dans une librairie, rêvant d'écrire sur sa peau, qu'il juge parfaite. Ambigüité excessive des protagonistes même s'ils passent et repassent, se confondent aux ombres des arbres, n'ont l'air que de simples quidams innocents. L'acte de survivre l'emporte sur le fait de vivre, comme si l'existence s'avérait un constant naufrage qu'il faut atténuer de quelque originalité pour éviter de se noyer. De mourir.
C'est un recueil déstabilisant, intelligent jusque dans les titres. Favorablement hermétique. Combien attachant et subtil quand des circonstances non atténuantes transforment les individus en des cœurs qui ne demandent qu'à battre, orchestrant le temps — le moment — qui leur est alloué. Cela peut durer des décennies ces battements machinaux, jusqu'au délabrement du muscle coronarien qui ne peut rien contre les effets poétiques de récits écrits de main de maitre par une écrivaine qui a saisi l'art minimaliste de la nouvelle.
Le syndrome de takotsubo, Mireille Gagné
Les Éditions Sémaphore, Montréal, 2018, 120 pages
Critique de livres, romans, nouvelles, récits.
Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Jean Cocteau
lundi 17 décembre 2018
lundi 3 décembre 2018
Une femme, des hommes et des bêtes *** 1/2
Il nous a demandé quels modèles façonnaient nos introductions. Pas besoin de chercher midi à quatorze heures, le monde s'agitant violemment autour de nous, il n'est pas nécessaire d'arpenter le sol accidenté de la Terre pour se convaincre du bien et du mal qui se dégagent de chacun d'entre nous, et de soi-même. Rien ni personne en particulier ne nous inspire, on prend exemple sur ce qui forge l'être humain. On commente l'essai de Claire Varin, Animalis.
Si le genre entre peu dans nos habituelles chroniques, on a fait exception pour cet essai mettant en vedette non des humains mais des animaux. Il est rare, à notre connaissance, qu'une écrivaine leur réserve une place de choix où chacun devrait s'instruire. Si nous pensons tout savoir de nos amies les bêtes, Claire Varin s'empresse de nous dissuader, faisant preuve d'une compassion pénétrante pour les défendre. D'entrée de jeu, elle prend la main du lecteur, en fait son complice. Tel un préambule, elle nous ouvre sa maison qu'elle partage avec le « père nourricier » de leurs animaux. C'est dit avec une tendresse ironique, l'homme en question, l'accompagnant de temps à autre dans ses voyages animaliers. Puis, la narratrice nous fait part de son amour inconditionnel pour les animaux depuis son jeune âge. Révélation qui ne pouvait qu'aboutir à un livre. Quête résultant de ses déplacements passionnés mais réalistes auprès d'animaux qui lui tiennent à cœur, il lui faut tester l'humain envers ses amis à quatre et deux pattes. Comportement parfois peu louable quand l'animal devient objet, délaissant son titre de sujet. L'essayiste ne ménage personne, surtout pas le lecteur à qui elle relate les maltraitances que subissent les bêtes, domestiques ou sauvages. Elle souhaite que la nature se venge, ayant si facilement « mal aux animaux, aux enfants, aux arbres, à tout ce qui appelle une protection dans la sombre société des hommes [ ... ] » N'aimant pas tourner en rond, elle a posé sa candidature au programme de Spoken Word du Banf Centre, institution internationale vouée aux arts et à la créativité, au cœur des Rocheuses. Ayant été acceptée, elle s'envolera vers les montagnes inscrites au patrimoine de l'UNESCO et vers les bêtes en liberté.
Avec beaucoup de lucidité et douée d'un grand sens de l'observation, Claire Varin, escortée de guides professionnels qui consacrent leur temps, et leur probité, au règne animal, elle dépeindra les loups hors et dans leurs refuges, nous assurant que cet animal timide est pourchassé, telles des bêtes nuisibles. Il est donc peu probable d'en croiser un dans une forêt. Toute raison aussi stupide soit-elle s'avère une occasion de les tuer. Cela se produit malheureusement dans tous les pays européens et américains. Ici, en Alberta. Il fut un temps où fermiers et propriétaires terriens jouissaient de dix mois pour s'en donner à cœur peu scrupuleux. Dans les parcs nationaux, ils sont protégés au même titre que la flore locale. Il y a aussi les autres, ceux destinés à la boucherie, l'accablant pillage des braconniers qui, en 2012, en Afrique, ont décimé vingt-deux mille éléphants. Le Québec n'est pas épargné quand nous apprenons que vingt-cinq mille animaux sont abandonnés chaque année. Aucune issue à proposer, sinon l'euthanasie. Autre abattoir... Heureusement, nous apaisent les moments à marcher le long d'une rivière. Le confort des animaux domestiques soulage la narratrice de tant de misère à leur égard. Misère aussi personnelle quand la mère meurt et que se profile la vente de la maison familiale, discrétion pudique de la narratrice qui narre sans se lamenter ouvertement. On a apprécié ces événements relatés sans démonstration excessive. La mort des deux chattes, le chagrin incommensurable partagé avec l'homme de sa vie, « ours bouddhiste » qui fait son possible pour alléger la sensibilité à fleur de peau de sa compagne. Les réminiscences, faisant revivre chats et mère, s'entrecroisent sans jamais se dissocier du bestiaire, comme pour souffler un peu, raccommoder le fil du temps et celui, plus précaire, de la mémoire. D'où le jaillissement subit de la narratrice vers le soleil, pour se « réchauffer les entrailles ». Où qu'elle se trouve, elle ne perd jamais de vue le comportement des humains. Ici, les touristes qui se montrent un peu infantiles face aux exhibitions attrayantes de dauphins. Elle nous avise d'une triste réalité : l'exploitation des mammifères aquatiques, amusant le quidam.
La curiosité, souvent, tient lieu d'ouverture d'esprit, d'un désir instinctif d'aller au-delà de ce dont nous sommes capables. Claire Varin sera attirée par les parcs animaliers, les zoos, là où sont retraités des lions, des gorilles, des éléphants, toujours sous la vigilance d'un guide pragmatique. La visite du zoo de Granby est particulièrement riche en émotions quand la promeneuse disserte sur la variété des animaux occupant un espace qui leur est aménagé. Des miracles opèrent quand elle obtiendra la permission de visiter le refuge Pageau, créé dans les années 1980 par Michel Pageau et son épouse. Elle dépeint avec une immense bonté les bêtes qui s'agitent autour d'elle, cobayes rescapés de laboratoires, faisant à nouveau confiance en la gente humaine. Arche de Noé où s'ébattent les oiseaux, s'expriment les ours, se meuvent les louves et la meute, ces dernières particulièrement admirées par la visiteuse. Même constat quand on la retrouvera au parc national de la Mauricie. Les loups ayant été, depuis la nuit des temps, considérés comme de dangereux prédateurs qui ont alimenté bien de fausses idées à leur sujet, confirme l'auteure.
Retour au Banf Centre quitté un an plus tôt. L'écrivaine entraine le lecteur dans une église où se déroule une cérémonie de bénédiction des animaux. Nous ne manquerons pas de la suivre, les détails savoureux dont elle nous gratifie piquant notre ignorance. Son guide, Peter, l'invite à une manifestation pour la protection des parcs nationaux. Elle y croisera des personnes qui l'aideront à rencontrer des grizzlis. Dernière étape de ce fabuleux périple, celui-ci exposant l'endroit et l'envers de sa lumière et de ses ombres. Le charme grinçant de ce livre nous a séduite, nous intéressant, de loin ou de près, au monde enchanté des animaux, au monde discutable des humains. Certains les secourent, les respectent, d'autres les maltraitent, les tortures, les tuent. Qu'inspire au juste l'univers animal, insufflant naturellement des comportements complexes ?
Essai simple d'accès, l'écriture fluide, la réflexive pensée, ne rebutant à aucun moment le lecteur à voir plus loin, se baladant d'un chapitre à l'autre sans aucune contrainte. Le récit est pétri d'un allocentrisme éclairant, d'un savoir impressionnant sur le règne de tous ces amis à plumes et à poils. Amour inlassable des animaux de la part de Claire Varin, sans ne jamais tomber dans un douteux anthropomorphisme mais s'étonnant que des humains cultivés, qui les étudient, doutent de leur sensibilité émotive. On dirait que plus proche adhère le sujet, plus dérangeant il se pose. La fin du livre tire sa conclusion sur une question déroutante mais tellement véridique, nous faisant prendre conscience de notre état de prédateur toxique. Les animaux étant nos amis, les mange-t-on ? Interrogation se projetant vers l'avenir animal et sur nous-mêmes.
Animalis, Claire Varin
Leméac Éditeur, Montréal, 2018, 117 pages
Si le genre entre peu dans nos habituelles chroniques, on a fait exception pour cet essai mettant en vedette non des humains mais des animaux. Il est rare, à notre connaissance, qu'une écrivaine leur réserve une place de choix où chacun devrait s'instruire. Si nous pensons tout savoir de nos amies les bêtes, Claire Varin s'empresse de nous dissuader, faisant preuve d'une compassion pénétrante pour les défendre. D'entrée de jeu, elle prend la main du lecteur, en fait son complice. Tel un préambule, elle nous ouvre sa maison qu'elle partage avec le « père nourricier » de leurs animaux. C'est dit avec une tendresse ironique, l'homme en question, l'accompagnant de temps à autre dans ses voyages animaliers. Puis, la narratrice nous fait part de son amour inconditionnel pour les animaux depuis son jeune âge. Révélation qui ne pouvait qu'aboutir à un livre. Quête résultant de ses déplacements passionnés mais réalistes auprès d'animaux qui lui tiennent à cœur, il lui faut tester l'humain envers ses amis à quatre et deux pattes. Comportement parfois peu louable quand l'animal devient objet, délaissant son titre de sujet. L'essayiste ne ménage personne, surtout pas le lecteur à qui elle relate les maltraitances que subissent les bêtes, domestiques ou sauvages. Elle souhaite que la nature se venge, ayant si facilement « mal aux animaux, aux enfants, aux arbres, à tout ce qui appelle une protection dans la sombre société des hommes [ ... ] » N'aimant pas tourner en rond, elle a posé sa candidature au programme de Spoken Word du Banf Centre, institution internationale vouée aux arts et à la créativité, au cœur des Rocheuses. Ayant été acceptée, elle s'envolera vers les montagnes inscrites au patrimoine de l'UNESCO et vers les bêtes en liberté.
Avec beaucoup de lucidité et douée d'un grand sens de l'observation, Claire Varin, escortée de guides professionnels qui consacrent leur temps, et leur probité, au règne animal, elle dépeindra les loups hors et dans leurs refuges, nous assurant que cet animal timide est pourchassé, telles des bêtes nuisibles. Il est donc peu probable d'en croiser un dans une forêt. Toute raison aussi stupide soit-elle s'avère une occasion de les tuer. Cela se produit malheureusement dans tous les pays européens et américains. Ici, en Alberta. Il fut un temps où fermiers et propriétaires terriens jouissaient de dix mois pour s'en donner à cœur peu scrupuleux. Dans les parcs nationaux, ils sont protégés au même titre que la flore locale. Il y a aussi les autres, ceux destinés à la boucherie, l'accablant pillage des braconniers qui, en 2012, en Afrique, ont décimé vingt-deux mille éléphants. Le Québec n'est pas épargné quand nous apprenons que vingt-cinq mille animaux sont abandonnés chaque année. Aucune issue à proposer, sinon l'euthanasie. Autre abattoir... Heureusement, nous apaisent les moments à marcher le long d'une rivière. Le confort des animaux domestiques soulage la narratrice de tant de misère à leur égard. Misère aussi personnelle quand la mère meurt et que se profile la vente de la maison familiale, discrétion pudique de la narratrice qui narre sans se lamenter ouvertement. On a apprécié ces événements relatés sans démonstration excessive. La mort des deux chattes, le chagrin incommensurable partagé avec l'homme de sa vie, « ours bouddhiste » qui fait son possible pour alléger la sensibilité à fleur de peau de sa compagne. Les réminiscences, faisant revivre chats et mère, s'entrecroisent sans jamais se dissocier du bestiaire, comme pour souffler un peu, raccommoder le fil du temps et celui, plus précaire, de la mémoire. D'où le jaillissement subit de la narratrice vers le soleil, pour se « réchauffer les entrailles ». Où qu'elle se trouve, elle ne perd jamais de vue le comportement des humains. Ici, les touristes qui se montrent un peu infantiles face aux exhibitions attrayantes de dauphins. Elle nous avise d'une triste réalité : l'exploitation des mammifères aquatiques, amusant le quidam.
La curiosité, souvent, tient lieu d'ouverture d'esprit, d'un désir instinctif d'aller au-delà de ce dont nous sommes capables. Claire Varin sera attirée par les parcs animaliers, les zoos, là où sont retraités des lions, des gorilles, des éléphants, toujours sous la vigilance d'un guide pragmatique. La visite du zoo de Granby est particulièrement riche en émotions quand la promeneuse disserte sur la variété des animaux occupant un espace qui leur est aménagé. Des miracles opèrent quand elle obtiendra la permission de visiter le refuge Pageau, créé dans les années 1980 par Michel Pageau et son épouse. Elle dépeint avec une immense bonté les bêtes qui s'agitent autour d'elle, cobayes rescapés de laboratoires, faisant à nouveau confiance en la gente humaine. Arche de Noé où s'ébattent les oiseaux, s'expriment les ours, se meuvent les louves et la meute, ces dernières particulièrement admirées par la visiteuse. Même constat quand on la retrouvera au parc national de la Mauricie. Les loups ayant été, depuis la nuit des temps, considérés comme de dangereux prédateurs qui ont alimenté bien de fausses idées à leur sujet, confirme l'auteure.
Retour au Banf Centre quitté un an plus tôt. L'écrivaine entraine le lecteur dans une église où se déroule une cérémonie de bénédiction des animaux. Nous ne manquerons pas de la suivre, les détails savoureux dont elle nous gratifie piquant notre ignorance. Son guide, Peter, l'invite à une manifestation pour la protection des parcs nationaux. Elle y croisera des personnes qui l'aideront à rencontrer des grizzlis. Dernière étape de ce fabuleux périple, celui-ci exposant l'endroit et l'envers de sa lumière et de ses ombres. Le charme grinçant de ce livre nous a séduite, nous intéressant, de loin ou de près, au monde enchanté des animaux, au monde discutable des humains. Certains les secourent, les respectent, d'autres les maltraitent, les tortures, les tuent. Qu'inspire au juste l'univers animal, insufflant naturellement des comportements complexes ?
Essai simple d'accès, l'écriture fluide, la réflexive pensée, ne rebutant à aucun moment le lecteur à voir plus loin, se baladant d'un chapitre à l'autre sans aucune contrainte. Le récit est pétri d'un allocentrisme éclairant, d'un savoir impressionnant sur le règne de tous ces amis à plumes et à poils. Amour inlassable des animaux de la part de Claire Varin, sans ne jamais tomber dans un douteux anthropomorphisme mais s'étonnant que des humains cultivés, qui les étudient, doutent de leur sensibilité émotive. On dirait que plus proche adhère le sujet, plus dérangeant il se pose. La fin du livre tire sa conclusion sur une question déroutante mais tellement véridique, nous faisant prendre conscience de notre état de prédateur toxique. Les animaux étant nos amis, les mange-t-on ? Interrogation se projetant vers l'avenir animal et sur nous-mêmes.
Animalis, Claire Varin
Leméac Éditeur, Montréal, 2018, 117 pages
lundi 26 novembre 2018
Les ombres menaçantes de la lune *** 1/2
Ce qui est terrifiant à nos yeux, c'est de voir un homme qui se dit
moderne, émancipé, ouvert à toutes les causes, vouloir devenir ce qu'il
n'est pas. À ce jeu du chat et de la souris avec soi-même, on se heurte à des murs qui, livrant leur écho, nous rappelle qu'il est indigne et
mensonger de tromper celui ou celle qui se trouve en face. Les miroirs
reflétant une fausse personnalité finissent tous par exploser, semblable
au célèbre tableau de René Magritte. On parle des nouvelles de
Françoise Major, Le nombril de la lune.
On ressort de ces textes avec l'impression étrange d'avoir été souvent en danger. On a ressenti des creux de vagues sournoises, comme dans la nouvelle Socorro où une mère et son jeune fils, se baignant imprudemment, ont failli être emportés au large du Pacifique. Nous sommes à Mexico, le temps de faire connaissance avec de jeunes protagonistes qui vont et viennent, aux limites de la méfiance, mais toujours sur la brèche de l'art de vivre avec peu de moyens, sinon ceux du bord, comme nous disons. Hoy por mi, manana pour toi, nouvelle où le danger se personnalise. Un matin, le narrateur s'en va à son école d'informatique. Il est six heures quinze, le lieu où marche le jeune homme est désert, le décor peu rassurant, il vient de pleuvoir. Aucune possibilité d'échapper à l'homme qui s'est approché de lui, le menace d'un pistolet, d'un couteau, « quoi d'autre ? » Un dialogue s'établit entre les deux hommes, une entente particulière sauvera la vie de l'étudiant. Intarissable menace qui, nuit et jour, poursuit le narrateur, terriblement révélée dans la nouvelle Numéro 140301751, soit la disparition de quarante-trois étudiants d'Ayotzinapa, le 26 mars 2015. Ils ne furent jamais retrouvés, ni vivants ni morts. Tous les textes, sans se référer véritablement à ce tragique événement, s'en inspirent, les ombres mouvantes ne cessant, entre gravité et dérision, d'informer le lecteur de ce qui se passe d'insolite à Mexico, ville envoûtante. L'air de ne pas considérer les choses trop sérieusement, l'écrivaine, qui a vécu six ans dans cette capitale, prend le risque, à travers des personnages éloquents, d'inventer quelques fables où le danger est bien réel. Que ce soit à l'occasion d'une fête d'anniversaire, au moment de larguer un chien infidèle, de dépeindre un migrant de retour au pays, garant de ses privilèges, le regard de l'écrivaine posé sur les êtres humains que ses narrateurs et narratrices côtoient, est empreint de symboles inavoués, d'intentions que ne dément jamais une certaine passivité désespérée. Lot encombrant d'une jeunesse déterminée. Le récit, La muchachada, s'avère un ramassis éparpillé d'une société microcosmique venue fêter l'anniversaire de Fercho, jeune homme de dix-huit ans. Cela se passe dans la maison du père du narrateur, le vieil homme vivant seul dans cette demeure qu'il a construite lui-même. Son fils se souvient et narre comment la soirée et la nuit se sont déroulées. Le père, exaspéré du tintamarre environnant, est sorti de sa chambre, témoignant d'une génération qui connaissait peu le plaisir de fêter bruyamment, ou de fêter, simplement. Un texte évocateur soulignant la mésentente subite entre un père silencieux, un fils exubérant, en même temps que la ville s'éveille, accentuant les odeurs fétides des abus des invités qui ont fui la colère du vieil homme. On a senti dans cette ambiance malaisée les rouages pernicieux de Mexico, dénonçant une fois encore des dangers nocturnes. L'haleine avinée, les yeux rougis par la drogue, le désenchantement de rencontres hasardeuses, excès d'où suinte une musique venue des bas-fonds de la cité, comme réverbérée sur les murs de la maison.
Terremotos, dramatique, nous rappelle le tremblement de terre survenu à Mexico en 1985. La narratrice n'était pas encore née, elle poussait dans le ventre de sa mère. Plus tard, elle relate des situations qui essoufflent le lecteur, l'entrainant dans divers quartiers blessés, décrivant comment chacun réagit à une telle catastrophe. Si ses points de repère s'appuient sur des monceaux de pierre et sur des victimes terrorisées, elle se souvient de ses âges qui feront d'elle une enfant du " terremoto ". Souvenirs qui s'entremêlent à ceux de personnages ayant tout perdu, une fois encore symboles d'une menace qui aboutit au pire, laissant la mémoire intacte. Une mémoire ne pouvant que faire confiance aux êtres que nous côtoyons, de gré ou de force. Ce que semble interpréter à répétitions la fiction romanesque Deux oiseaux, un chemin, insinuant que tout peut changer d'une manière inattendue, l'amitié et l'amour étant souvent liés l'un à l'autre. Au fond de nous, malgré les sentences sociales, politiques, nous restons des humains curieux du déferlement évènementiel qui renforce l'insécurité dramatique de villes gigantesques, le doute assaillant la mémoire de ses habitants, étrangers parfois à eux-mêmes.
Plusieurs de ces nouvelles nous ont particulièrement touchée. Émue, devrait-on préciser. Elles reflètent un monde incertain, faillible, prêt à faire peau neuve, sans avoir mis au clair ce qui rend une ville autant magique que dangereuse. Fascination éprouvée dans des capitales disparates, sinon opposées, leur prêtant une personnalité effrénée. Mexico devient ici personnage, donc capitale imparfaite. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui fait la beauté et la laideur d'une mégapole sinon notre façon d'interpréter, de relativiser ce qui en vaut la peine. Le regard acéré, finement poétique de Françoise Major, ne se berce d'aucune illusoire réconciliation, pas plus qu'elle n'en laisse au lecteur, celui-ci fasciné de pénétrer dans un univers qui ne lui est en rien familier. Des fictions, on n'en est pas certaine, qui façonnent cet autrement indiscipliné qui nous habite, que nous ne voulons pas toujours admettre, la crainte de la différence nous faisant grincer des dents. Recueil à lire, rédigé entre espagnol et français, agrémenté d'un glossaire, pour que nous nous prenions conscience du danger encouru par d'autres, plus hardis que nous le sommes.
Le nombril de la lune, Françoise Major
Éditions Le Cheval d'août, Montréal, 2018, 288 pages
On ressort de ces textes avec l'impression étrange d'avoir été souvent en danger. On a ressenti des creux de vagues sournoises, comme dans la nouvelle Socorro où une mère et son jeune fils, se baignant imprudemment, ont failli être emportés au large du Pacifique. Nous sommes à Mexico, le temps de faire connaissance avec de jeunes protagonistes qui vont et viennent, aux limites de la méfiance, mais toujours sur la brèche de l'art de vivre avec peu de moyens, sinon ceux du bord, comme nous disons. Hoy por mi, manana pour toi, nouvelle où le danger se personnalise. Un matin, le narrateur s'en va à son école d'informatique. Il est six heures quinze, le lieu où marche le jeune homme est désert, le décor peu rassurant, il vient de pleuvoir. Aucune possibilité d'échapper à l'homme qui s'est approché de lui, le menace d'un pistolet, d'un couteau, « quoi d'autre ? » Un dialogue s'établit entre les deux hommes, une entente particulière sauvera la vie de l'étudiant. Intarissable menace qui, nuit et jour, poursuit le narrateur, terriblement révélée dans la nouvelle Numéro 140301751, soit la disparition de quarante-trois étudiants d'Ayotzinapa, le 26 mars 2015. Ils ne furent jamais retrouvés, ni vivants ni morts. Tous les textes, sans se référer véritablement à ce tragique événement, s'en inspirent, les ombres mouvantes ne cessant, entre gravité et dérision, d'informer le lecteur de ce qui se passe d'insolite à Mexico, ville envoûtante. L'air de ne pas considérer les choses trop sérieusement, l'écrivaine, qui a vécu six ans dans cette capitale, prend le risque, à travers des personnages éloquents, d'inventer quelques fables où le danger est bien réel. Que ce soit à l'occasion d'une fête d'anniversaire, au moment de larguer un chien infidèle, de dépeindre un migrant de retour au pays, garant de ses privilèges, le regard de l'écrivaine posé sur les êtres humains que ses narrateurs et narratrices côtoient, est empreint de symboles inavoués, d'intentions que ne dément jamais une certaine passivité désespérée. Lot encombrant d'une jeunesse déterminée. Le récit, La muchachada, s'avère un ramassis éparpillé d'une société microcosmique venue fêter l'anniversaire de Fercho, jeune homme de dix-huit ans. Cela se passe dans la maison du père du narrateur, le vieil homme vivant seul dans cette demeure qu'il a construite lui-même. Son fils se souvient et narre comment la soirée et la nuit se sont déroulées. Le père, exaspéré du tintamarre environnant, est sorti de sa chambre, témoignant d'une génération qui connaissait peu le plaisir de fêter bruyamment, ou de fêter, simplement. Un texte évocateur soulignant la mésentente subite entre un père silencieux, un fils exubérant, en même temps que la ville s'éveille, accentuant les odeurs fétides des abus des invités qui ont fui la colère du vieil homme. On a senti dans cette ambiance malaisée les rouages pernicieux de Mexico, dénonçant une fois encore des dangers nocturnes. L'haleine avinée, les yeux rougis par la drogue, le désenchantement de rencontres hasardeuses, excès d'où suinte une musique venue des bas-fonds de la cité, comme réverbérée sur les murs de la maison.
Terremotos, dramatique, nous rappelle le tremblement de terre survenu à Mexico en 1985. La narratrice n'était pas encore née, elle poussait dans le ventre de sa mère. Plus tard, elle relate des situations qui essoufflent le lecteur, l'entrainant dans divers quartiers blessés, décrivant comment chacun réagit à une telle catastrophe. Si ses points de repère s'appuient sur des monceaux de pierre et sur des victimes terrorisées, elle se souvient de ses âges qui feront d'elle une enfant du " terremoto ". Souvenirs qui s'entremêlent à ceux de personnages ayant tout perdu, une fois encore symboles d'une menace qui aboutit au pire, laissant la mémoire intacte. Une mémoire ne pouvant que faire confiance aux êtres que nous côtoyons, de gré ou de force. Ce que semble interpréter à répétitions la fiction romanesque Deux oiseaux, un chemin, insinuant que tout peut changer d'une manière inattendue, l'amitié et l'amour étant souvent liés l'un à l'autre. Au fond de nous, malgré les sentences sociales, politiques, nous restons des humains curieux du déferlement évènementiel qui renforce l'insécurité dramatique de villes gigantesques, le doute assaillant la mémoire de ses habitants, étrangers parfois à eux-mêmes.
Plusieurs de ces nouvelles nous ont particulièrement touchée. Émue, devrait-on préciser. Elles reflètent un monde incertain, faillible, prêt à faire peau neuve, sans avoir mis au clair ce qui rend une ville autant magique que dangereuse. Fascination éprouvée dans des capitales disparates, sinon opposées, leur prêtant une personnalité effrénée. Mexico devient ici personnage, donc capitale imparfaite. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui fait la beauté et la laideur d'une mégapole sinon notre façon d'interpréter, de relativiser ce qui en vaut la peine. Le regard acéré, finement poétique de Françoise Major, ne se berce d'aucune illusoire réconciliation, pas plus qu'elle n'en laisse au lecteur, celui-ci fasciné de pénétrer dans un univers qui ne lui est en rien familier. Des fictions, on n'en est pas certaine, qui façonnent cet autrement indiscipliné qui nous habite, que nous ne voulons pas toujours admettre, la crainte de la différence nous faisant grincer des dents. Recueil à lire, rédigé entre espagnol et français, agrémenté d'un glossaire, pour que nous nous prenions conscience du danger encouru par d'autres, plus hardis que nous le sommes.
Le nombril de la lune, Françoise Major
Éditions Le Cheval d'août, Montréal, 2018, 288 pages
lundi 12 novembre 2018
Grandeur et massacre d'un empire pétrifié ****
V. est persuadée que la vie est trop courte pour la prendre au sérieux. Elle déplore l'état nauséabond du monde, le sort peu enviable de femmes brimées qui n'osent se rebeller de peur de représailles. De l'innocence bafouée d'enfants prostitués ou travaillant pour des hommes dépourvus de conscience scrupuleuse. V. se considère comme une femme privilégiée, à son âge elle se crée encore des souvenirs. Elle a quatre-vingt ans. Parlons du roman de Gilles Jobidon, Le Tranquille affligé.
On a parfois l'impression, après que les hommes ont accompli ce qui devait l'être, que Dieu intervient pour mettre un terme à leurs inventions, qui feront faire un bond magistral à l'humanité. Après lecture du magnifique récit de Gilles Jobidon, on a éprouvé une profonde admiration malaisée pour la Chine du XIXe siècle, qui n'a su protéger ses arrières quand il en était encore temps. Toutes les grandes civilisations ont connu ces époques de saturation qui les ont conduites à la catastrophe. Des hommes soi-disant plus évolués, se référant d'un Dieu autrement plus redoutable que le génie humain, se sont embourbés dans un désastre collectif. Suicide d'un peuple qui, pourtant, avait vu le vent tourner, soufflant d'une Europe à son apogée. Un ancien Jésuite défroqué, Jacques Trévier, ayant succombé aux charmes de cet Orient contradictoire, n'a pu que se soumettre aux volontés insatiables du monarque d'alors. On mentionne que l'Ordre des Jésuites a été aboli par le pape Clément XIV, en 1773. Ne reste plus que les irréductibles partis prêcher la bonne parole en terre fertile. Se sont soumis aux exigences souveraines, qui les maintiennent dans un luxe ostentatoire moyennant leurs compétences professionnelles. L'homme Trévier, horloger de son état civil, conseiller privilégié à la cour impériale, passionné de livres anciens, et de musique, Bach en particulier, est devenu plus chinois que les Chinois. N'est-il pas reconnu sous le nom de Chang Fu Yin ? C'est un fin limier qui déjoue les intrigues politiques et sociales avec la diplomatie qu'exige tout rôle subalterne. Ce jour-là, en présence de l'empereur, il affirme que sur l'île de Baël, existent des teintures d'une qualité qui défie les leurs. C'est au cours de ses lectures qu'il a pris connaissance de l'île de Baël, quelque part dans l'océan Indien.
Ici commence l'histoire de Jacques Trévier, insatiable voyageur qui, ordonné par l'empereur, doit se rendre sur cette île, ramener un teinturier qui possède les secrets du noir et de ses nuances. Durant son périple, il circule sur un lac immense. Illimité. Apparaissent les jardins du Palais d'été des empereurs de l'empire du Soleil, qui se révèlent une splendeur insolite. Si la Chine s'est endormie alors qu'elle a tout inventé — la boussole, le papier, l'encre, le sismographe, on en passe —, ses superstitions inconcevables agissent sur l'empereur comme une tentation diabolique. En ce cas précis, il doit trouver une solution pour éliminer les maux qui gangrènent son pays. Refusant d'ouvrir ses portes aux Occidentaux et, las de son pouvoir, l'empereur s'est réfugié dans la beauté d'une nature inchangée depuis le début des temps. Ceci n'est pas vraiment dit mais le récit, souvent dépeint en demi-tons colorés, toujours poétiques, suggère la présence impériale, sous le couvert de déguisements improbables. Mais Trévier doit poursuivre sa route, parvenir sur l'île salvatrice. L'accompagne Sima Qian, maître teinturier de jaune de l'empereur, qui lui décrira les propriétés de la teinture noire. Moment réflexif qui plongera brièvement le lecteur dans l'enfance et l'adolescence de Jacques Trévier, enfant qui n'étant fait pour rien de précis, n'aura d'autre recours que de devenir un saint. Persuasion qui durera peu lorsqu'il aura lu ce qui se passe ailleurs, surtout sur le sol chinois. Fera de lui ce qu'il est. Un mandarin érudit qui dissimule derrière la quiétude de ses yeux bleus, une immense colère jamais assouvie.
Pendant que les jeunes années de Trévier effleurent sa mémoire, un événement surviendra qui lui fera retrouver un compagnon d'antan, opiomane, qui manie avec dextérité le pinceau de calligraphie, qui se mêle à l'eau jusqu'à son effacement. Comment pourrait-il en être autrement dans ce pays où le silence s'avère l'essentiel d'une conversation ? Et toujours une jonque qui glisse sur l'océan Indien. Jusqu'au cœur de Baël. Séduit, ému par cette petite nation qu'il aborde, Trévier se laisse aller entre les mains de baigneuses qui vitement disparaissent. Entre en scène une femme aux seins nus, qui va bouleverser sa vie. Elle possède la beauté incomparable d'une femme noire, mais sa peau est blanche, très blanche. Albinos. Elle se révèle la teinturière unique du noir. Coup de foudre entre Trévier et elle, à qui il attribue tous les noms des fleurs. Toutes leurs couleurs avant de la nommer Flore. Cette femme au passé étonnant, qu'il doit ramener à la cour impériale, s'avère impuissante à reproduire la couleur noire hors de son île. Nous sommes en 1860, l'histoire rattrape le lecteur quand il lira avec épouvante le sac du Palais d'été et de ses jardins. Ses conséquences sur les agissements de l'empereur, sur Flore, enfermée dans les quartiers impériaux. Tout déboule sans qu'il soit possible de changer le destin du pays du Milieu, confiné dans son impossibilité à créer quoi que ce soit. La Chine que connait Trévier devient souvenir, plus rien n'existe. Celui-ci bascule dans une affliction immuable, en même temps que l'Angleterre débarque dans un conte de fées. Instaurant une démocratie éphémère au pays des dragons. La suite de l'histoire de Jacques Trévier nous le montre vieillard brisé, planqué dans un paradis terrestre, oublié des envahisseurs. La fin de sa vie rassemble la beauté ancestrale de la Chine, impossible à décrire parce que trop intense.
Roman éloquent, bouleversant, tout en poésie, écriture digne de l'impérieuse ampleur de ce territoire qui, pour son malheur, est resté infiniment replié sur lui-même, dédaignant observer ce qui se déroulait à l'Occident. Gilles Jobidon est revenu, avec humour et passion, et grâce, à ce qui lui convient le mieux, la prose poétique de ses débuts d'écrivain, comme si les longs discours romanesques desservaient son talent d'orateur posé sur des histoires à n'en plus finir... Pourtant, derrière tant de poétique narration, l'écrivain ne perd jamais de vue le monde moderne que la Chine n'a pas vu venir à la fin du XIXe siècle, déniant une civilisation qui a saccagé son passé grandiose mais pétrifié. L'opium a ses parfums qui endorment ceux qui ne savent plus comment réparer l'engrenage rouillé d'une horlogerie implacablement décadente, ses aiguilles figées sur des heures chancies.
Le Tranquille affligé, Gilles Jobidon
Leméac Éditeur, Montréal, 2018, 166 pages
On a parfois l'impression, après que les hommes ont accompli ce qui devait l'être, que Dieu intervient pour mettre un terme à leurs inventions, qui feront faire un bond magistral à l'humanité. Après lecture du magnifique récit de Gilles Jobidon, on a éprouvé une profonde admiration malaisée pour la Chine du XIXe siècle, qui n'a su protéger ses arrières quand il en était encore temps. Toutes les grandes civilisations ont connu ces époques de saturation qui les ont conduites à la catastrophe. Des hommes soi-disant plus évolués, se référant d'un Dieu autrement plus redoutable que le génie humain, se sont embourbés dans un désastre collectif. Suicide d'un peuple qui, pourtant, avait vu le vent tourner, soufflant d'une Europe à son apogée. Un ancien Jésuite défroqué, Jacques Trévier, ayant succombé aux charmes de cet Orient contradictoire, n'a pu que se soumettre aux volontés insatiables du monarque d'alors. On mentionne que l'Ordre des Jésuites a été aboli par le pape Clément XIV, en 1773. Ne reste plus que les irréductibles partis prêcher la bonne parole en terre fertile. Se sont soumis aux exigences souveraines, qui les maintiennent dans un luxe ostentatoire moyennant leurs compétences professionnelles. L'homme Trévier, horloger de son état civil, conseiller privilégié à la cour impériale, passionné de livres anciens, et de musique, Bach en particulier, est devenu plus chinois que les Chinois. N'est-il pas reconnu sous le nom de Chang Fu Yin ? C'est un fin limier qui déjoue les intrigues politiques et sociales avec la diplomatie qu'exige tout rôle subalterne. Ce jour-là, en présence de l'empereur, il affirme que sur l'île de Baël, existent des teintures d'une qualité qui défie les leurs. C'est au cours de ses lectures qu'il a pris connaissance de l'île de Baël, quelque part dans l'océan Indien.
Ici commence l'histoire de Jacques Trévier, insatiable voyageur qui, ordonné par l'empereur, doit se rendre sur cette île, ramener un teinturier qui possède les secrets du noir et de ses nuances. Durant son périple, il circule sur un lac immense. Illimité. Apparaissent les jardins du Palais d'été des empereurs de l'empire du Soleil, qui se révèlent une splendeur insolite. Si la Chine s'est endormie alors qu'elle a tout inventé — la boussole, le papier, l'encre, le sismographe, on en passe —, ses superstitions inconcevables agissent sur l'empereur comme une tentation diabolique. En ce cas précis, il doit trouver une solution pour éliminer les maux qui gangrènent son pays. Refusant d'ouvrir ses portes aux Occidentaux et, las de son pouvoir, l'empereur s'est réfugié dans la beauté d'une nature inchangée depuis le début des temps. Ceci n'est pas vraiment dit mais le récit, souvent dépeint en demi-tons colorés, toujours poétiques, suggère la présence impériale, sous le couvert de déguisements improbables. Mais Trévier doit poursuivre sa route, parvenir sur l'île salvatrice. L'accompagne Sima Qian, maître teinturier de jaune de l'empereur, qui lui décrira les propriétés de la teinture noire. Moment réflexif qui plongera brièvement le lecteur dans l'enfance et l'adolescence de Jacques Trévier, enfant qui n'étant fait pour rien de précis, n'aura d'autre recours que de devenir un saint. Persuasion qui durera peu lorsqu'il aura lu ce qui se passe ailleurs, surtout sur le sol chinois. Fera de lui ce qu'il est. Un mandarin érudit qui dissimule derrière la quiétude de ses yeux bleus, une immense colère jamais assouvie.
Pendant que les jeunes années de Trévier effleurent sa mémoire, un événement surviendra qui lui fera retrouver un compagnon d'antan, opiomane, qui manie avec dextérité le pinceau de calligraphie, qui se mêle à l'eau jusqu'à son effacement. Comment pourrait-il en être autrement dans ce pays où le silence s'avère l'essentiel d'une conversation ? Et toujours une jonque qui glisse sur l'océan Indien. Jusqu'au cœur de Baël. Séduit, ému par cette petite nation qu'il aborde, Trévier se laisse aller entre les mains de baigneuses qui vitement disparaissent. Entre en scène une femme aux seins nus, qui va bouleverser sa vie. Elle possède la beauté incomparable d'une femme noire, mais sa peau est blanche, très blanche. Albinos. Elle se révèle la teinturière unique du noir. Coup de foudre entre Trévier et elle, à qui il attribue tous les noms des fleurs. Toutes leurs couleurs avant de la nommer Flore. Cette femme au passé étonnant, qu'il doit ramener à la cour impériale, s'avère impuissante à reproduire la couleur noire hors de son île. Nous sommes en 1860, l'histoire rattrape le lecteur quand il lira avec épouvante le sac du Palais d'été et de ses jardins. Ses conséquences sur les agissements de l'empereur, sur Flore, enfermée dans les quartiers impériaux. Tout déboule sans qu'il soit possible de changer le destin du pays du Milieu, confiné dans son impossibilité à créer quoi que ce soit. La Chine que connait Trévier devient souvenir, plus rien n'existe. Celui-ci bascule dans une affliction immuable, en même temps que l'Angleterre débarque dans un conte de fées. Instaurant une démocratie éphémère au pays des dragons. La suite de l'histoire de Jacques Trévier nous le montre vieillard brisé, planqué dans un paradis terrestre, oublié des envahisseurs. La fin de sa vie rassemble la beauté ancestrale de la Chine, impossible à décrire parce que trop intense.
Roman éloquent, bouleversant, tout en poésie, écriture digne de l'impérieuse ampleur de ce territoire qui, pour son malheur, est resté infiniment replié sur lui-même, dédaignant observer ce qui se déroulait à l'Occident. Gilles Jobidon est revenu, avec humour et passion, et grâce, à ce qui lui convient le mieux, la prose poétique de ses débuts d'écrivain, comme si les longs discours romanesques desservaient son talent d'orateur posé sur des histoires à n'en plus finir... Pourtant, derrière tant de poétique narration, l'écrivain ne perd jamais de vue le monde moderne que la Chine n'a pas vu venir à la fin du XIXe siècle, déniant une civilisation qui a saccagé son passé grandiose mais pétrifié. L'opium a ses parfums qui endorment ceux qui ne savent plus comment réparer l'engrenage rouillé d'une horlogerie implacablement décadente, ses aiguilles figées sur des heures chancies.
Le Tranquille affligé, Gilles Jobidon
Leméac Éditeur, Montréal, 2018, 166 pages
lundi 5 novembre 2018
Lire au-delà des apparences *** 1/2
D. nous a fait sourire. À la suite d'une déception amoureuse, elle affirme que les promesses d'un homme valent celles des candidats électoraux. La comparaison est prosaïque mais, ayant eu dans nos relations ce type d'énergumène, qu'on s'est empressée d'éliminer de notre vie, comment donner tort à cette amie qui s'est jurée de devenir comme saint Thomas. Croire un homme sur ses actes et non sur ses paroles. On parle du roman de Felicia Mihali, Une deuxième chance pour Adam.
Des livres nous surprennent. Nous les lisons pour ce qu'ils nous font découvrir, parfois peu de choses, comme le récit habile de cette écrivaine. On perçoit à peine les indices qui nous crèvent les yeux pour y déceler quelque anormalité. Est-ce le quotidien qui submerge notre façon de lire, de ne pas nous attendre à une histoire édifiante ? Quoi de plus banale qu'une femme — la narratrice — qui nous dépeint son existence avec son mari, ses cours dans une école pour adolescents difficiles, des rencontres occasionnelles avec ses amis ? Sauf que le mari, Adam, cinquante ans, a été victime des années plus tôt, d'un accident vasculaire cérébral. Si physiquement il fonctionne plutôt bien, ses facultés intellectuelles sont devenues celles d'un enfant d'une dizaine d'années. Il subit donc l'entière dépendance de son épouse.
Quand le récit commence, la narratrice promène le chien de sa fille, Sara, qui a pris des vacances pour fêter Noël ailleurs avec son amoureux. La narratrice et son mari ne sont jamais partis pour les fêtes d'hiver. Ils se cantonnent devant la télévision. Seuls, Sara et son compagnon partagent leur repas de Noël. Le ton est donné pour faire la connaissance d'un couple qui ne vit pas tout à fait comme les autres, l'état mental d'Adam obligeant son épouse à bien des attentions à son égard. Elle le surveille comme une chatte ses petits, nous devinons qu'elle aime fortement cet homme qui, aujourd'hui, l'emporte vers des jours plus heureux, insouciants. Cela n'est plus concevable maintenant qu'Adam ne survit que sous la coupe bienveillante de son épouse-gardienne. Ce jour-là, elle amène son mari au centre commercial pour acheter les cadeaux de fin d'année. Elle le laisse sur un banc, près d'un énorme palmier en plastique. Geste animal qui nous a fait penser au propriétaire d'une bête de compagnie, attachée devant la porte d'un lieu public, attendant que son maître ait fini de faire ses emplettes. Malaise et compréhension. Les moindres gestes d'Adam sont analysés, ses paroles disséquées par une femme souhaitant que son mari retrouve un niveau cérébral plus normal. Nous la comprenons. Mais un soir, la narratrice reçoit un appel téléphonique d'un ancien couple d'amis, Peter et Lara, qu'ils n'ont pas revus depuis vingt ans. Ceux-ci leur proposent de souper ensemble. Repère malaisé de la part d'elle et d'Adam de qui elle craint la réaction. Chacun enfermé dans ses pensées, les deux regardent la télévision.
Félicia Mihali profite de cet incident pour nous décrire des coutumes roumaines, comme l'anniversaire de Marta, une amie commune. Cérémonie qui se fête au restaurant durant une soirée très froide de l'hiver. Adam est de la partie. Elle, le surveille comme une mère son enfant. Tout le monde connait l'état de l'homme, chacun ne pouvant s'empêcher de l'observer, tel un handicapé attire le regard malgré soi. Pourtant « depuis son attaque, Adam a l'air éternellement heureux. » Phrase qui en dit long sur les cachotteries de l'écrivaine, qu'on ne détectera pas à une première lecture. Aveu rusé duquel il faudrait soupçonner une anomalie dans le comportement de cet homme soulagé, semble-t-il, de bien des vicissitudes freinées par sa femme, qui lui est toute dévouée. Intermède volontairement obscur. La narratrice nous emmène aussi dans son école, elle fait cas d'élèves rébarbatifs dont les parents, souvent les mères, dépassés par le comportement rebelle de leur progéniture, vivent dans le déni de leurs méfaits. De retour chez elle, la narratrice tient Adam au courant de ses péripéties scolaires, débattant aussi de sujets sensibles, comme le port du voile dans un pays laïque. Le communisme, l'admiration d'Adam pour Fidel Castro. Les raisons pour lesquelles tant de Roumains ont fui leur pays.
L'hiver déroule sa froidure, peu à peu se profilent les premières lueurs printanières. Réflexions sur les préférences alimentaires d'Adam avant et pendant sa maladie. Les difficultés, sinon la solitude, de la narratrice avec le cerveau atrophié de son mari. Une fois encore, les jours passent, comme les nôtres, fixés sur diverses et bénignes occupations. Faut-il avoir un grand malade chez soi pour donner tant d'importance à des détails qui n'en valent pas toujours la peine, ou bien notre regard est-il lui-même si étiolé qu'il distingue mal les contours de tant d'heures affairées ? Leur séjour de trois jours dans l'appartement de leur fille, sur Ridgewood. Dépaysement illusoire, comme pour chasser des mouches imaginaires, qui bourdonnent dans leur esprit fatigué. Au retour chez eux, son amour fou pour le corps d'Adam, qu'elle avoue sans retenue. Nous entrons dans le vif du sujet qui, à la première lecture, nous avait échappé. Dernière grande étape du parcours roumain : les obsèques du mari de Dora qui s'est tué dans un accident de moto. À la suite de cette macabre cérémonie, un appel téléphonique de Peter déclenchera un drame étouffé depuis une vingtaine d'années. La narratrice bondit dans un passé que le lecteur ne soupçonnait pas. Que nous lui laisserons découvrir.
C'est un roman qui n'en est pas tout à fait un. Si certaines séquences nous ont semblé parfois bavardes, certaines même inutiles, la fiction l'emporte quand nous sera dévoilé le drame dont a été victime la narratrice. Ce drame est-il responsable de la maladie d'Adam, on ne peut y répondre, le cerveau renfermant des circuits fermés impossibles à décadenasser. Récit qui nous a fait penser à une longue novella, la chute subtilement bien menée par Félicia Mihali, écrivaine expérimentée dont on a lu et apprécié la majorité des ouvrages. À lire dans un décor identique à celui décrit par la romancière. Des livres étant propices à chaque saison, le lecteur suivra-t-il mieux le périple accidenté d'un homme et d'une femme livrés à leurs souvenirs démantelés par les exigences d'une existence dissemblable des autres ?
On a aimé le double emploi du titre du roman, celui-ci ayant été publié une première fois en anglais, en 2014, par Linda Leith Publishing.
Une deuxième chance pour Adam, Felicia Mihali
Éditions Hashtag, Montréal, 2018, 167 pages
Des livres nous surprennent. Nous les lisons pour ce qu'ils nous font découvrir, parfois peu de choses, comme le récit habile de cette écrivaine. On perçoit à peine les indices qui nous crèvent les yeux pour y déceler quelque anormalité. Est-ce le quotidien qui submerge notre façon de lire, de ne pas nous attendre à une histoire édifiante ? Quoi de plus banale qu'une femme — la narratrice — qui nous dépeint son existence avec son mari, ses cours dans une école pour adolescents difficiles, des rencontres occasionnelles avec ses amis ? Sauf que le mari, Adam, cinquante ans, a été victime des années plus tôt, d'un accident vasculaire cérébral. Si physiquement il fonctionne plutôt bien, ses facultés intellectuelles sont devenues celles d'un enfant d'une dizaine d'années. Il subit donc l'entière dépendance de son épouse.
Quand le récit commence, la narratrice promène le chien de sa fille, Sara, qui a pris des vacances pour fêter Noël ailleurs avec son amoureux. La narratrice et son mari ne sont jamais partis pour les fêtes d'hiver. Ils se cantonnent devant la télévision. Seuls, Sara et son compagnon partagent leur repas de Noël. Le ton est donné pour faire la connaissance d'un couple qui ne vit pas tout à fait comme les autres, l'état mental d'Adam obligeant son épouse à bien des attentions à son égard. Elle le surveille comme une chatte ses petits, nous devinons qu'elle aime fortement cet homme qui, aujourd'hui, l'emporte vers des jours plus heureux, insouciants. Cela n'est plus concevable maintenant qu'Adam ne survit que sous la coupe bienveillante de son épouse-gardienne. Ce jour-là, elle amène son mari au centre commercial pour acheter les cadeaux de fin d'année. Elle le laisse sur un banc, près d'un énorme palmier en plastique. Geste animal qui nous a fait penser au propriétaire d'une bête de compagnie, attachée devant la porte d'un lieu public, attendant que son maître ait fini de faire ses emplettes. Malaise et compréhension. Les moindres gestes d'Adam sont analysés, ses paroles disséquées par une femme souhaitant que son mari retrouve un niveau cérébral plus normal. Nous la comprenons. Mais un soir, la narratrice reçoit un appel téléphonique d'un ancien couple d'amis, Peter et Lara, qu'ils n'ont pas revus depuis vingt ans. Ceux-ci leur proposent de souper ensemble. Repère malaisé de la part d'elle et d'Adam de qui elle craint la réaction. Chacun enfermé dans ses pensées, les deux regardent la télévision.
Félicia Mihali profite de cet incident pour nous décrire des coutumes roumaines, comme l'anniversaire de Marta, une amie commune. Cérémonie qui se fête au restaurant durant une soirée très froide de l'hiver. Adam est de la partie. Elle, le surveille comme une mère son enfant. Tout le monde connait l'état de l'homme, chacun ne pouvant s'empêcher de l'observer, tel un handicapé attire le regard malgré soi. Pourtant « depuis son attaque, Adam a l'air éternellement heureux. » Phrase qui en dit long sur les cachotteries de l'écrivaine, qu'on ne détectera pas à une première lecture. Aveu rusé duquel il faudrait soupçonner une anomalie dans le comportement de cet homme soulagé, semble-t-il, de bien des vicissitudes freinées par sa femme, qui lui est toute dévouée. Intermède volontairement obscur. La narratrice nous emmène aussi dans son école, elle fait cas d'élèves rébarbatifs dont les parents, souvent les mères, dépassés par le comportement rebelle de leur progéniture, vivent dans le déni de leurs méfaits. De retour chez elle, la narratrice tient Adam au courant de ses péripéties scolaires, débattant aussi de sujets sensibles, comme le port du voile dans un pays laïque. Le communisme, l'admiration d'Adam pour Fidel Castro. Les raisons pour lesquelles tant de Roumains ont fui leur pays.
L'hiver déroule sa froidure, peu à peu se profilent les premières lueurs printanières. Réflexions sur les préférences alimentaires d'Adam avant et pendant sa maladie. Les difficultés, sinon la solitude, de la narratrice avec le cerveau atrophié de son mari. Une fois encore, les jours passent, comme les nôtres, fixés sur diverses et bénignes occupations. Faut-il avoir un grand malade chez soi pour donner tant d'importance à des détails qui n'en valent pas toujours la peine, ou bien notre regard est-il lui-même si étiolé qu'il distingue mal les contours de tant d'heures affairées ? Leur séjour de trois jours dans l'appartement de leur fille, sur Ridgewood. Dépaysement illusoire, comme pour chasser des mouches imaginaires, qui bourdonnent dans leur esprit fatigué. Au retour chez eux, son amour fou pour le corps d'Adam, qu'elle avoue sans retenue. Nous entrons dans le vif du sujet qui, à la première lecture, nous avait échappé. Dernière grande étape du parcours roumain : les obsèques du mari de Dora qui s'est tué dans un accident de moto. À la suite de cette macabre cérémonie, un appel téléphonique de Peter déclenchera un drame étouffé depuis une vingtaine d'années. La narratrice bondit dans un passé que le lecteur ne soupçonnait pas. Que nous lui laisserons découvrir.
C'est un roman qui n'en est pas tout à fait un. Si certaines séquences nous ont semblé parfois bavardes, certaines même inutiles, la fiction l'emporte quand nous sera dévoilé le drame dont a été victime la narratrice. Ce drame est-il responsable de la maladie d'Adam, on ne peut y répondre, le cerveau renfermant des circuits fermés impossibles à décadenasser. Récit qui nous a fait penser à une longue novella, la chute subtilement bien menée par Félicia Mihali, écrivaine expérimentée dont on a lu et apprécié la majorité des ouvrages. À lire dans un décor identique à celui décrit par la romancière. Des livres étant propices à chaque saison, le lecteur suivra-t-il mieux le périple accidenté d'un homme et d'une femme livrés à leurs souvenirs démantelés par les exigences d'une existence dissemblable des autres ?
On a aimé le double emploi du titre du roman, celui-ci ayant été publié une première fois en anglais, en 2014, par Linda Leith Publishing.
Une deuxième chance pour Adam, Felicia Mihali
Éditions Hashtag, Montréal, 2018, 167 pages
lundi 29 octobre 2018
Nos semblables et nous-mêmes *** 1/2
Des deuils, sans nous en rendre compte, nous en subissons tous les jours. Des deuils imperceptibles, comme celui d'une feuille qui tombe, se craquelle, d'une fleur qui se fane, d'un insecte que nous écrasons du pied. Deuil plus ostentatoire, celui d'un amour qui s'étiole. Le cœur se brise, se rompt un peu plus chaque jour, tel Chamfort le préconise. Ainsi, le cœur malmené jusqu'à son dernier souffle. On a lu le livre de Charles-Philippe Laperrière, Gens du milieu.
Trente courts textes qui nous ont surprise, tant par leur teneur hautement psychologique que par une écriture, elle aussi, hautement soignée qui, à mesure que nous entrons dans le livre, se modèle, souple et légère, aux propos de protagonistes qui se supportent difficilement. N'en sommes-nous pas tous là, à nous évaluer un jour, une nuit, la fatigue de vivre nous rappelant à notre condition éphémère d'humain ? Trente textes brefs qui font frémir par leur capacité de lucidité ironique. Tout est dit, dans un style foisonnant, s'ajustant à la personnalité des uns et des autres. Enfermement en soi-même, certes, à partir du titre qui ne tolère aucune concession, une possible échappatoire se délimitant à un prénom et à une profession. Offrant un espace restreint, parfois étouffant, le point de vue de l'écrivain s'avérant cérébral.
Dès le premier texte, s'impose un émissaire, faisant aller le lecteur entre les occupations professionnelles de deux personnages. Thomas est comptable, des impressions suffisent à le situer en quelques lignes. Puis, surgit Isabelle, son épouse, Isabelle, psychologue, « cultivée et sensible », amoureuse de son mari, certes, mais qu'elle connaît mal et peu. Un échec dont elle ne se remettra pas quand le pire surviendra un « samedi splendide d'avril ». On est tentée d'écrire que ces récits se parent de la démarche succincte de la nouvelle même si l'écrivain les sous-titre " légendes vivantes ", comme pour donner un soupçon d'importance à des faits que nous accomplissons, de la naissance à la mort. Un individu légendaire n'a-t-il pas commis un ou plusieurs actes exceptionnels durant son périple terrestre ? Nova qui s'inscrit en bout de ligne, dans la pierre. Dans la mémoire. Ce que ressent Gabrielle, future attachée de presse, quand elle surgit au monde prématurément. Toutes ses sensations nous sont révélées à travers la voix réflexive du narrateur-émissaire, omniprésent. À quoi sert d'être une légende supposément morte alors que la vie nous taraude de ses péripéties, d'événements impromptus, pour tracer nos pas dans leurs empreintes ? Réjean, président-directeur général, homme dangereux, captif de son pouvoir, n'endure même pas son ombre, il en profite pour soudoyer ses secrétaires, dont Manon, qui le redoute. Misogyne invétéré, Réjean, en compagnie de l'émissaire parcourant l'ouvrage, se verra mourir, en quelques secondes, d'une manière tapageuse et voyeuse. Alain, partisan conservateur, crache le peu d'estime qu'il voue à ses compatriotes. Différemment, mais un brin similaire à Réjean, Alain méprise les initiatives novatrices tant sociales que politiques. Sa suffisance radicalisée lui permet de s'opposer à tout ce qui est vital, comme l'avortement et l'euthanasie. Omnia, dix-sept ans, collégienne, ou l'art de dépeindre les émois juvéniles, les illusions, sans trop en avoir, le réalisme innocent des premiers regards masculins, même s'ils ne sont pas plus expérimentés que la jeune fille qui les suscite. Ont tous l'âge de Rimbaud, et c'est touchant. Rosalie, romancière, tourmentée plutôt que philosophe, clôt le recueil au relent de haine et d'amour, sentiments impossibles à départager parce que poussés à leur paroxysme instinctif. Tout est double, nous faisons semblant de l'ignorer ou, le sachant, nous préférons dénier cette probabilité. Ce serait troublant et fatigant de démêler les manœuvres de ces hommes et femmes contemporains, détenteurs de professions appréciables, rarement mal éduqués, prisonniers de la monotonie de leurs habitudes. Ces êtres ne formulent aucune originalité dans leurs entreprises. Que de l'ordinaire dans leurs comportements et agissements.
Autant dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais un pas grand-chose qui fascine, l'impact entre les individus et leurs velléités s'avérant d'une intensité violente, superbement mise en une sourde évidence par le narrateur-émissaire, nous rappelant certains ouvrages de Patrick Modiano, abritant des protagonistes qui paraissent et disparaissent, le temps d'une averse sous le ciel brouillassé d'une banlieue parisienne... Si parfois l'écriture, savamment dosée de vocables peu usités, demande quelque exigence de compréhension, on a admiré l'art de l'écrivain à synthétiser des existences symbolisant la déambulation de quidams, qui se manifestent à vive allure, ne font que passer. On a aimé que des mondes faillibles, loin d'histoires préméditées, aient été bousculés, dérangés, nous faisant ressentir la fragilité de nos ambitions, les emportant vers de légitimes désirs, nous permettant de vivre décemment. Pour certains, cela est possible, pour d'autres pas, la mort se faisant justicière, signant un décret qui nous échappe, auquel nous pensons si peu quand nous rêvons, sans scrupules, d'un lendemain meilleur. Notre but n'est-il pas de conformer notre petit monde à notre convenance, sans y parvenir tout à fait ?
Gens du milieu, Charles-Philippe Laperrière
Le Quartanier éditeur, Montréal, 2018, 184 pages
Trente courts textes qui nous ont surprise, tant par leur teneur hautement psychologique que par une écriture, elle aussi, hautement soignée qui, à mesure que nous entrons dans le livre, se modèle, souple et légère, aux propos de protagonistes qui se supportent difficilement. N'en sommes-nous pas tous là, à nous évaluer un jour, une nuit, la fatigue de vivre nous rappelant à notre condition éphémère d'humain ? Trente textes brefs qui font frémir par leur capacité de lucidité ironique. Tout est dit, dans un style foisonnant, s'ajustant à la personnalité des uns et des autres. Enfermement en soi-même, certes, à partir du titre qui ne tolère aucune concession, une possible échappatoire se délimitant à un prénom et à une profession. Offrant un espace restreint, parfois étouffant, le point de vue de l'écrivain s'avérant cérébral.
Dès le premier texte, s'impose un émissaire, faisant aller le lecteur entre les occupations professionnelles de deux personnages. Thomas est comptable, des impressions suffisent à le situer en quelques lignes. Puis, surgit Isabelle, son épouse, Isabelle, psychologue, « cultivée et sensible », amoureuse de son mari, certes, mais qu'elle connaît mal et peu. Un échec dont elle ne se remettra pas quand le pire surviendra un « samedi splendide d'avril ». On est tentée d'écrire que ces récits se parent de la démarche succincte de la nouvelle même si l'écrivain les sous-titre " légendes vivantes ", comme pour donner un soupçon d'importance à des faits que nous accomplissons, de la naissance à la mort. Un individu légendaire n'a-t-il pas commis un ou plusieurs actes exceptionnels durant son périple terrestre ? Nova qui s'inscrit en bout de ligne, dans la pierre. Dans la mémoire. Ce que ressent Gabrielle, future attachée de presse, quand elle surgit au monde prématurément. Toutes ses sensations nous sont révélées à travers la voix réflexive du narrateur-émissaire, omniprésent. À quoi sert d'être une légende supposément morte alors que la vie nous taraude de ses péripéties, d'événements impromptus, pour tracer nos pas dans leurs empreintes ? Réjean, président-directeur général, homme dangereux, captif de son pouvoir, n'endure même pas son ombre, il en profite pour soudoyer ses secrétaires, dont Manon, qui le redoute. Misogyne invétéré, Réjean, en compagnie de l'émissaire parcourant l'ouvrage, se verra mourir, en quelques secondes, d'une manière tapageuse et voyeuse. Alain, partisan conservateur, crache le peu d'estime qu'il voue à ses compatriotes. Différemment, mais un brin similaire à Réjean, Alain méprise les initiatives novatrices tant sociales que politiques. Sa suffisance radicalisée lui permet de s'opposer à tout ce qui est vital, comme l'avortement et l'euthanasie. Omnia, dix-sept ans, collégienne, ou l'art de dépeindre les émois juvéniles, les illusions, sans trop en avoir, le réalisme innocent des premiers regards masculins, même s'ils ne sont pas plus expérimentés que la jeune fille qui les suscite. Ont tous l'âge de Rimbaud, et c'est touchant. Rosalie, romancière, tourmentée plutôt que philosophe, clôt le recueil au relent de haine et d'amour, sentiments impossibles à départager parce que poussés à leur paroxysme instinctif. Tout est double, nous faisons semblant de l'ignorer ou, le sachant, nous préférons dénier cette probabilité. Ce serait troublant et fatigant de démêler les manœuvres de ces hommes et femmes contemporains, détenteurs de professions appréciables, rarement mal éduqués, prisonniers de la monotonie de leurs habitudes. Ces êtres ne formulent aucune originalité dans leurs entreprises. Que de l'ordinaire dans leurs comportements et agissements.
Autant dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais un pas grand-chose qui fascine, l'impact entre les individus et leurs velléités s'avérant d'une intensité violente, superbement mise en une sourde évidence par le narrateur-émissaire, nous rappelant certains ouvrages de Patrick Modiano, abritant des protagonistes qui paraissent et disparaissent, le temps d'une averse sous le ciel brouillassé d'une banlieue parisienne... Si parfois l'écriture, savamment dosée de vocables peu usités, demande quelque exigence de compréhension, on a admiré l'art de l'écrivain à synthétiser des existences symbolisant la déambulation de quidams, qui se manifestent à vive allure, ne font que passer. On a aimé que des mondes faillibles, loin d'histoires préméditées, aient été bousculés, dérangés, nous faisant ressentir la fragilité de nos ambitions, les emportant vers de légitimes désirs, nous permettant de vivre décemment. Pour certains, cela est possible, pour d'autres pas, la mort se faisant justicière, signant un décret qui nous échappe, auquel nous pensons si peu quand nous rêvons, sans scrupules, d'un lendemain meilleur. Notre but n'est-il pas de conformer notre petit monde à notre convenance, sans y parvenir tout à fait ?
Gens du milieu, Charles-Philippe Laperrière
Le Quartanier éditeur, Montréal, 2018, 184 pages
lundi 22 octobre 2018
Rupture amoureuse au métro Papineau ***
On pense à de menus travaux de fin d'été, la nouvelle saison plus fraîche prenant ses aises dans les jours qui suivront le délire estival. C'est toujours ainsi que cela se passe, les recommencements qui nous enchantent, les fins qui nous attristent. De la naissance à la mort, les sourires et les larmes font office de notre passage intempestif sur terre. On parle du roman de Jean-Guy Forget, After.
Un peu par hasard, on plonge dans des livres qui ne sont pas de tout repos. Des histoires classiques de fin d'amour, de nostalgie, de regrets, de réminiscences. C'est la manière ici de dire ce qui compte. L'écriture s'amalgame aux dislocations du cœur, de la tête, sans jamais se départir de la densité de sentiments éprouvés pour la muse du moment. Les femmes ne sont-elles pas à tous âges des muses quand elles inspirent de tels inassouvissements ? C'est ce qui arrive au jeune narrateur de ce premier roman. L'amour contrarié pour une fille de son âge qui, pour des raisons de personnalité divergente, l'entraine dans les souvenirs inachevés d'amoureuses desquelles il ne parvient pas à se libérer. Ce qui occasionne des rencontres insolites. Cette démarche incendiaire se situe dans le Mile-End, d'un party à un autre, d'un visage féminin à un autre, dans l'antre désenchanté de soirées et de nuits suractivées par l'alcool et la drogue. Le sexe. C'est sur ce ton de désœuvrement que l'auteur se laisse aller à un langage autant disjoncté que ses souvenirs envahis d'une réalité improbable. Il y a la mère qu'il aime plus que toutes les femmes éparpillées dans sa tête. Son narcissisme qui le soutient pour mener à bien ses allées et venues dans la ville, balades qui ricochent sur des noms coutumiers, sur des normes inusitées. Jeune homme aux apparences placides, conditionné par la certitude craintive de croiser, tôt ou tard, des femmes qu'il a aimées, ne désirant jamais les quitter. Il s'adresse toujours à celle qui alimente ce récit disparate, prisonnier de ses spontanéités rompues de points fixes. Ce besoin de repères dont il use pour fonctionner. Une ruelle, une chambre. Son rapport avec lui-même, ce qu'il nomme sa masculinité, préoccupé qu'il est par son authenticité, au point de narrer son histoire, après qu'elle a été terminée, sans l'être jamais tout à fait, au métro Papineau. Point fixe qu'il mentionnera, tel un leitmotiv s'insère dans notre mémoire castrée par trop d'émotions ambivalentes. Désastre intentionnel qu'il entretient dans une sorte de cacophonie qui brouille ses velléités de cheminer vers autre chose de plus prégnant que l'échec successif de ses amours agonisantes.
Employant un mélange de termes français et anglais qui apportent au récit un ton de trébuchement, l'auteur ne fait que renforcer le désarroi impulsif de son personnage, signifiant au lecteur que s'exprimer par des moyens déboités symbolise ce que vivent certains jeunes dans la vie réelle, vie mêlée au rêve. Se répercutent alors des sons musicaux qui ont révulsé les oreilles quand elle s'est imposée hors de normes apprises. Il n'est pas question d'apprivoiser qui que ce soit, l'amour n'a de raison d'être que s'il est mal vécu. Nous ne sommes pas loin des romantiques du XIXe siècle. Cependant, Jean-Guy Forget devra faire preuve de plus de rationalité pour plaire à une majorité de lecteurs et lectrices habitués à la complaisance d'histoires qui se meurent, aboutissent non à une fin tragique mais à un after prenant tout son sens dans les habitudes rassurantes —gestes et paroles — de la vie quotidienne. Malgré ses embûches, ses travers, ses émotions mal cicatrisées, privilège attendrissant d'une génération survoltant sa vingtaine d'années dans des relations passionnelles. Instabilité de l'être humain qui se retrouve dépouillé de son entièreté face à l'écriture quand il a la chance de savoir, de pouvoir s'exprimer loin du métro de la rupture.
Un roman dérangeant, on en lit plusieurs ces derniers temps, qui nous a à peine étonnée. On est témoin d'une relève qui ne veut pas être dupée ni par des lecteurs straight, ni par ceux et celles qui s'offusquent d'une éloquence désemparée, affichée dans un langage débridé, pour employer un terme cher à Arthur Rimbaud.
After, Jean-Guy Forget
Éditions Hamac, Québec, 2018, 175 pages
Un peu par hasard, on plonge dans des livres qui ne sont pas de tout repos. Des histoires classiques de fin d'amour, de nostalgie, de regrets, de réminiscences. C'est la manière ici de dire ce qui compte. L'écriture s'amalgame aux dislocations du cœur, de la tête, sans jamais se départir de la densité de sentiments éprouvés pour la muse du moment. Les femmes ne sont-elles pas à tous âges des muses quand elles inspirent de tels inassouvissements ? C'est ce qui arrive au jeune narrateur de ce premier roman. L'amour contrarié pour une fille de son âge qui, pour des raisons de personnalité divergente, l'entraine dans les souvenirs inachevés d'amoureuses desquelles il ne parvient pas à se libérer. Ce qui occasionne des rencontres insolites. Cette démarche incendiaire se situe dans le Mile-End, d'un party à un autre, d'un visage féminin à un autre, dans l'antre désenchanté de soirées et de nuits suractivées par l'alcool et la drogue. Le sexe. C'est sur ce ton de désœuvrement que l'auteur se laisse aller à un langage autant disjoncté que ses souvenirs envahis d'une réalité improbable. Il y a la mère qu'il aime plus que toutes les femmes éparpillées dans sa tête. Son narcissisme qui le soutient pour mener à bien ses allées et venues dans la ville, balades qui ricochent sur des noms coutumiers, sur des normes inusitées. Jeune homme aux apparences placides, conditionné par la certitude craintive de croiser, tôt ou tard, des femmes qu'il a aimées, ne désirant jamais les quitter. Il s'adresse toujours à celle qui alimente ce récit disparate, prisonnier de ses spontanéités rompues de points fixes. Ce besoin de repères dont il use pour fonctionner. Une ruelle, une chambre. Son rapport avec lui-même, ce qu'il nomme sa masculinité, préoccupé qu'il est par son authenticité, au point de narrer son histoire, après qu'elle a été terminée, sans l'être jamais tout à fait, au métro Papineau. Point fixe qu'il mentionnera, tel un leitmotiv s'insère dans notre mémoire castrée par trop d'émotions ambivalentes. Désastre intentionnel qu'il entretient dans une sorte de cacophonie qui brouille ses velléités de cheminer vers autre chose de plus prégnant que l'échec successif de ses amours agonisantes.
Employant un mélange de termes français et anglais qui apportent au récit un ton de trébuchement, l'auteur ne fait que renforcer le désarroi impulsif de son personnage, signifiant au lecteur que s'exprimer par des moyens déboités symbolise ce que vivent certains jeunes dans la vie réelle, vie mêlée au rêve. Se répercutent alors des sons musicaux qui ont révulsé les oreilles quand elle s'est imposée hors de normes apprises. Il n'est pas question d'apprivoiser qui que ce soit, l'amour n'a de raison d'être que s'il est mal vécu. Nous ne sommes pas loin des romantiques du XIXe siècle. Cependant, Jean-Guy Forget devra faire preuve de plus de rationalité pour plaire à une majorité de lecteurs et lectrices habitués à la complaisance d'histoires qui se meurent, aboutissent non à une fin tragique mais à un after prenant tout son sens dans les habitudes rassurantes —gestes et paroles — de la vie quotidienne. Malgré ses embûches, ses travers, ses émotions mal cicatrisées, privilège attendrissant d'une génération survoltant sa vingtaine d'années dans des relations passionnelles. Instabilité de l'être humain qui se retrouve dépouillé de son entièreté face à l'écriture quand il a la chance de savoir, de pouvoir s'exprimer loin du métro de la rupture.
Un roman dérangeant, on en lit plusieurs ces derniers temps, qui nous a à peine étonnée. On est témoin d'une relève qui ne veut pas être dupée ni par des lecteurs straight, ni par ceux et celles qui s'offusquent d'une éloquence désemparée, affichée dans un langage débridé, pour employer un terme cher à Arthur Rimbaud.
After, Jean-Guy Forget
Éditions Hamac, Québec, 2018, 175 pages
lundi 15 octobre 2018
L'apprentissage de la vie sur fond de tendresse *** 1/2
Des catastrophes naturelles, il y en a de nombreuses. Notre planète se fâche contre les humains qui lui font subir mille offenses. De tout temps, il en a été ainsi. Le déluge préhistorique fut une catastrophe qui changea la surface d'un monde à peine entrevu en cette époque lointaine, dirigé sans pitié, ni compassion, par l'omniprésence d'un dieu hypothétique. On commente le roman de Pierre Cayouette, Les amoureux du jour 2.
Arrivée dix ans plus tôt au Québec, les années quatre-vingt nous étaient un peu opaques, un peu hors de nos préoccupations. Par la suite, on a appris beaucoup de cette décennie, on a encore appris en lisant le dernier roman de Pierre Cayouette, à la fois journaliste et éditeur. On laisse de côté ses différentes occupations intellectuelles. On est là pour mentionner l'apport bénéfique d'une histoire qui nous a particulièrement touchée. Une étonnante humilité habite le cœur du jeune homme qui la narre, comme si être humble allait de soi. Il s'appelle Christian Ladouceur, il a dix-huit ans. Des événements historiques et personnels vont former son caractère qu'il a plutôt naïf, mais combien intègre. Innocent, en quelque sorte. Spectateur passionné du référendum qui bat son plein d'espoir, en mai 1980, il fait part au lecteur d'anecdotes qu'il savoure dans l'épicerie familiale. Observe avec un brin d'humour juvénile les clients qui, chaque jour, viennent s'approvisionner. Il admire René Lévesque, milite dans son sillage, persuadé que le rêve de ce dernier se concrétisera. Le lecteur connait la suite. Christian se souvient d'un infime moment de complicité avec sa mère qui mourra d'un cancer, léguant à son fils non la révolte mais la tolérance et la bonté. Scène émouvante quand la mère se reproche de mourir, laissant son garçon face aux turpitudes de la vie. Des séquences brossées avec une délicatesse désarmante, comme s'il était permis d'espérer l'impossible. Auréolé de sa jeunesse bouillonnante, Christian défie la banalité quotidienne en compagnie de son amoureuse, Geneviève, dépeinte d'une manière intense, toujours caressée d'une écriture en dentelle, à peine effleurée par la plume talentueuse de l'écrivain. Avec Geneviève, violoncelliste, il prendra une décision difficile, celle d'un avortement, leur jeune âge ne leur permettant pas de devenir parents. Toutes les réalités, amour et incertitudes, donc tous les contrastes existentiels, se meuvent autour de Christian qui les assume sur fond musical, comme pour imprégner le lecteur d'une vérité élémentaire : pourquoi se révolter alors que nous ne pouvons rien quand la vie se maquille de ses deux masques, comédie et tragédie ? Mélancolie qui traverse le livre, lui impartit une profondeur jusque dans les moindres accoutumances du quotidien. Que faut-il raconter au juste ? C'est là tout l'intérêt du roman, Pierre Cayouette réussissant à nous emporter non vers des dérives propres aux années vertes, si présentes dans le roman actuel, mais vers des espérances à hauteur d'homme, qui grandira loin des illusions, puisqu'il le faut. Le printemps se pare, en lui et hors de lui, — nous sommes en mai — de teintes pastel qui accentueront leur joliesse, renforçant l'amitié insolite partagée avec Jean, professeur de musique et de français à la retraite. Christian, d'abord réticent à cette amitié, prétextant leur « énorme différence d'âge », se laissera séduire, la bienveillance lucide de son interlocuteur se mettant au diapason des heures effervescentes du jeune homme. Son vieil ami se montre érudit, les grands classiques littéraires québécois n'ont plus de secret pour lui. Homme exceptionnel qui ne pouvait que plaire à ce jeune adulte qui entre timidement dans la vie alors que le vieil homme la quitte sur la pointe douloureuse des pieds.
Tout le livre est ainsi, basé sur la tendresse, décrivant une souffrance acceptée, guidant les uns et les autres au centre parfois tourbillonnant de leur vie conformiste. Comme s'il était indu que des pleurs tracent leurs marques sur des joues lisses ou ridées. Jeunesse et vieillesse se côtoient, la maladie équilibre les joies et les peines démarquant l'existence d'hommes et de femmes qui foulent le tapis mordoré, soit changeant, de péripéties impossibles à éviter. Jean qui a sa vie derrière, s'avère le miroir de Christian qui lui aussi, après la maladie et la mort, devra subir l'échec de son premier amour. Lui-même est atteint cruellement dans sa chair. Aidé de son vieil ami Jean, il s'en remettra, se consacrant à ses semblables âgés, au sport, à la musique. Si tout n'est que séparation, souhaitée ou pas, il faut continuer, le cœur en bandoulière. Cette fiction divisée en deux parties, oscille entre l'endroit et l'envers d'une médaille humaine, celle d'un dynamisme fébrile, teintée de ses habituelles contrefaçons, et celle plus sombre de l'existence, frappée de ses inconvénients, de ses tourments, de son manège de désagréments.
Une part d'ombre et de lumière sillonne ces pages imprégnées d'une saveur poétique à mesure que Christian prend la main du lecteur pour mieux le diriger vers ce qui en vaut la peine. Si la toile de fond s'agite autour du premier référendum, elle n'embrouille jamais la démarche des protagonistes qui vont et viennent, chacun et chacune ne pouvant rien contre les aléas qui influencent leurs actions. L'écrivain, Pierre Cayouette, est un sage qui fuit la violence. Griffer, se rebiffer, s'avèrent des moyens aléatoires pour transcender le moindre élan d'exaltation dont nous avons besoin pour surmonter les crises événementielles qui nous mordent sans crier gare. C'est un roman courageux, nécessaire, que nous offre l'écrivain, porté par le discours de René Lévesque, par la poésie d'Anne Hébert, de Gaston Miron. Et la tendresse, nichée au cœur d'une écriture exécutant ses arpèges, nous convainc que cette vertu, de plus en plus rare et recherchée, existe encore.
Les amoureux du jour 2, Pierre Cayouette
Collection « Écarts »,
Éditions Druide, Montréal, 2018, 136 pages
Arrivée dix ans plus tôt au Québec, les années quatre-vingt nous étaient un peu opaques, un peu hors de nos préoccupations. Par la suite, on a appris beaucoup de cette décennie, on a encore appris en lisant le dernier roman de Pierre Cayouette, à la fois journaliste et éditeur. On laisse de côté ses différentes occupations intellectuelles. On est là pour mentionner l'apport bénéfique d'une histoire qui nous a particulièrement touchée. Une étonnante humilité habite le cœur du jeune homme qui la narre, comme si être humble allait de soi. Il s'appelle Christian Ladouceur, il a dix-huit ans. Des événements historiques et personnels vont former son caractère qu'il a plutôt naïf, mais combien intègre. Innocent, en quelque sorte. Spectateur passionné du référendum qui bat son plein d'espoir, en mai 1980, il fait part au lecteur d'anecdotes qu'il savoure dans l'épicerie familiale. Observe avec un brin d'humour juvénile les clients qui, chaque jour, viennent s'approvisionner. Il admire René Lévesque, milite dans son sillage, persuadé que le rêve de ce dernier se concrétisera. Le lecteur connait la suite. Christian se souvient d'un infime moment de complicité avec sa mère qui mourra d'un cancer, léguant à son fils non la révolte mais la tolérance et la bonté. Scène émouvante quand la mère se reproche de mourir, laissant son garçon face aux turpitudes de la vie. Des séquences brossées avec une délicatesse désarmante, comme s'il était permis d'espérer l'impossible. Auréolé de sa jeunesse bouillonnante, Christian défie la banalité quotidienne en compagnie de son amoureuse, Geneviève, dépeinte d'une manière intense, toujours caressée d'une écriture en dentelle, à peine effleurée par la plume talentueuse de l'écrivain. Avec Geneviève, violoncelliste, il prendra une décision difficile, celle d'un avortement, leur jeune âge ne leur permettant pas de devenir parents. Toutes les réalités, amour et incertitudes, donc tous les contrastes existentiels, se meuvent autour de Christian qui les assume sur fond musical, comme pour imprégner le lecteur d'une vérité élémentaire : pourquoi se révolter alors que nous ne pouvons rien quand la vie se maquille de ses deux masques, comédie et tragédie ? Mélancolie qui traverse le livre, lui impartit une profondeur jusque dans les moindres accoutumances du quotidien. Que faut-il raconter au juste ? C'est là tout l'intérêt du roman, Pierre Cayouette réussissant à nous emporter non vers des dérives propres aux années vertes, si présentes dans le roman actuel, mais vers des espérances à hauteur d'homme, qui grandira loin des illusions, puisqu'il le faut. Le printemps se pare, en lui et hors de lui, — nous sommes en mai — de teintes pastel qui accentueront leur joliesse, renforçant l'amitié insolite partagée avec Jean, professeur de musique et de français à la retraite. Christian, d'abord réticent à cette amitié, prétextant leur « énorme différence d'âge », se laissera séduire, la bienveillance lucide de son interlocuteur se mettant au diapason des heures effervescentes du jeune homme. Son vieil ami se montre érudit, les grands classiques littéraires québécois n'ont plus de secret pour lui. Homme exceptionnel qui ne pouvait que plaire à ce jeune adulte qui entre timidement dans la vie alors que le vieil homme la quitte sur la pointe douloureuse des pieds.
Tout le livre est ainsi, basé sur la tendresse, décrivant une souffrance acceptée, guidant les uns et les autres au centre parfois tourbillonnant de leur vie conformiste. Comme s'il était indu que des pleurs tracent leurs marques sur des joues lisses ou ridées. Jeunesse et vieillesse se côtoient, la maladie équilibre les joies et les peines démarquant l'existence d'hommes et de femmes qui foulent le tapis mordoré, soit changeant, de péripéties impossibles à éviter. Jean qui a sa vie derrière, s'avère le miroir de Christian qui lui aussi, après la maladie et la mort, devra subir l'échec de son premier amour. Lui-même est atteint cruellement dans sa chair. Aidé de son vieil ami Jean, il s'en remettra, se consacrant à ses semblables âgés, au sport, à la musique. Si tout n'est que séparation, souhaitée ou pas, il faut continuer, le cœur en bandoulière. Cette fiction divisée en deux parties, oscille entre l'endroit et l'envers d'une médaille humaine, celle d'un dynamisme fébrile, teintée de ses habituelles contrefaçons, et celle plus sombre de l'existence, frappée de ses inconvénients, de ses tourments, de son manège de désagréments.
Une part d'ombre et de lumière sillonne ces pages imprégnées d'une saveur poétique à mesure que Christian prend la main du lecteur pour mieux le diriger vers ce qui en vaut la peine. Si la toile de fond s'agite autour du premier référendum, elle n'embrouille jamais la démarche des protagonistes qui vont et viennent, chacun et chacune ne pouvant rien contre les aléas qui influencent leurs actions. L'écrivain, Pierre Cayouette, est un sage qui fuit la violence. Griffer, se rebiffer, s'avèrent des moyens aléatoires pour transcender le moindre élan d'exaltation dont nous avons besoin pour surmonter les crises événementielles qui nous mordent sans crier gare. C'est un roman courageux, nécessaire, que nous offre l'écrivain, porté par le discours de René Lévesque, par la poésie d'Anne Hébert, de Gaston Miron. Et la tendresse, nichée au cœur d'une écriture exécutant ses arpèges, nous convainc que cette vertu, de plus en plus rare et recherchée, existe encore.
Les amoureux du jour 2, Pierre Cayouette
Collection « Écarts »,
Éditions Druide, Montréal, 2018, 136 pages
mardi 9 octobre 2018
Une jeune fille magique *** 1/2
On réalise que notre existence se scinde en deux fragments, tels l'endroit et l'envers de toute médaille. Celle-ci, la nôtre, ne se perçoit qu'à travers nos actes. Nos pensées les inventent pour mieux en sonder la profondeur, en mesurer la distance qui nous sépare d'une réalité qui nous appartient. Ce qui permet à notre vie de s'équilibrer quand des incidents imprévisibles font battre notre pouls plus vite. On a lu le roman de Natalie Jean, La vie magique.
Si des romans plutôt sombres et mélancoliques sont le produit d'une certaine génération, des écrivains se démarquent de cette réalité grise et morne. C'est le cas du récit de cette écrivaine, nouvelliste appréciée, qui offre au lecteur une histoire irradiante, ensoleillée intérieurement, celle-ci se déroulant à l'automne jusqu'à ses premières neiges. Miranda a dix-sept ans, elle vit avec son père à la campagne. Sa mère est morte quand elle avait dix ans. Ce sont là de simples indices que souligne la romancière, le quotidien se greffant sur le regard lumineux que Miranda pose sur son entourage, qu'elle transcende parce qu'elle est faite comme ça. Les souvenirs de sa mère, la tendresse de son père, qui ne vit que pour sa fille, réjouissent le lecteur tant ils étincellent, comme un matin à sa première aube. Beaucoup de choses sont dites sur l'amitié qu'elle partage avec sa meilleure amie, Delfine. Son amour de la nature que, tenant la main inspirante de Natalie Jean, Miranda dépeint magistralement, enjolivée de détails poétiques, là où d'autres ne verraient pas grand-chose. Ses premiers émois pour des garçons de son âge, ses refus de se prêter à des aventures sexuelles sans lendemain. Aucune pruderie à redouter, la jeune fille veut se garder intacte pour l'homme qui la fera frémir, pour que « des ronds s'agrandissent à la surface du lac qui est devenu infini. » Elle veut être espérée, préférée. Chaque chapitre résonne des idéaux de Miranda, sans ne jamais tomber dans une mièvrerie moralisatrice. En toute candeur, elle confie au lecteur qu'elle est vierge, qu'elle « sait exactement comment ça marche ». Sa mère, d'une manière subtile, l'a initiée au mystère de l'amour et surtout au mystère du désir. Le corps, Miranda l'a découvert dans un livre de son idole : Léonard de Vinci. Comme référence, la jeune fille ne pouvait mieux tomber. Ses connaissances anatomiques, elles les partage avec ses amies de classe, ignorantes des ricochets de la puberté qui les guettent. Témoin lucide de sa jeunesse, Miranda contemple les nuages, la pluie, les jardins. Le fleuve. Les orages lui rappellent de joyeux intermèdes au chalet avec ses parents. La détestation de Noël sans sa mère, les parties de pêche avec son père. Tant de faits quotidiens qui diffèrent d'une journée à l'autre, l'adolescente oscillant entre le passé et le présent, entre l'absence d'une mère bienveillante, les attentions compatissantes d'un père débonnaire, fidèle aux sentiments amoureux qu'il a éprouvés pour son épouse. À peine abordés les drames intrinsèques à l'humanité, ravageant un monde infernal qu'elle effleure d'une révolte à peine révélée.
Miranda nous apprend qu'elle est synesthète. Cela se ressent à peine : le regard coloré qu'elle pose naturellement sur ses alentours s'avèrent des balises qui nous invitent à la suivre partout où elle se sent en accord avec sa jeune vie. Il en est de même pour les personnes qu'elle aime, son père au temps présent, sa mère au temps passé. Delfine se glisse dans les interstices qui lui permettent de se retrouver dans un temps qui grandit avec son amie, mais aussi avec des filles et garçons de leur âge. Bientôt, Miranda devra quitter la campagne effervescente pour aller étudier en ville. Pour se mesurer à un univers de béton. Monde futur qu'elle envisage à peine, elle doit profiter intensément de la pluie, des nuages, des bêtes. De la musique que son père lui a apprise. Elle, Miranda, dessine depuis son plus jeune âge. Deviendra-t-elle une artiste ? Cela ne surprendrait pas le lecteur.
Il serait tentant d'écrire que c'est une adolescence idéalisée que dépeint Natalie Jean, souhaitant que des trésors de la sienne l'aient inspirée. Effets d'une génération ou pas, parents aimants ou pas, pavés ou sentiers arpentés, il n'en demeure pas moins que cette période incertaine porte ses marques personnelles, les créent, telle une brûlure sur la peau mal cicatrisée. Parce que l'adolescence, perçue par un regard innocent, poursuit sa turbulente traversée dans de magistrales avenues asphaltées d'espérance.
Si Miranda est faite comme ça, pour notre plus grand plaisir de la fréquenter assidûment à travers les pages, de l'accompagner parmi ses joies, ses peines, Natalie Jean lui a prêté une part de son talent pour la dessiner au centre de turpitudes dans notre monde agité. Il est rare de lire un récit où la magie opère d'une manière autant saisissante, l'écrivaine et son personnage constamment en osmose. La tombée des livres de l'automne nous a plutôt divertie des confidences de jeunes femmes incomprises, comme si la littérature servait de défouloir où déverser ses frustrations. Ce n'est pas un grand livre, comme nous l'entendons, c'est un livre où exulte une tendre générosité envers ses semblables, jeunes et moins jeunes. Caméléon que Miranda, sous la plume pétillante de Natalie Jean, sécrétant des fluides étonnants dans notre monde dépourvu d'oreilles attentives. D'yeux fascinés par des arcs-en-ciel métaphoriques, nés de la nécessité de grandir.
La vie magique, Natalie Jean
Leméac Éditeur, Montréal, 2018, 173 pages
Si des romans plutôt sombres et mélancoliques sont le produit d'une certaine génération, des écrivains se démarquent de cette réalité grise et morne. C'est le cas du récit de cette écrivaine, nouvelliste appréciée, qui offre au lecteur une histoire irradiante, ensoleillée intérieurement, celle-ci se déroulant à l'automne jusqu'à ses premières neiges. Miranda a dix-sept ans, elle vit avec son père à la campagne. Sa mère est morte quand elle avait dix ans. Ce sont là de simples indices que souligne la romancière, le quotidien se greffant sur le regard lumineux que Miranda pose sur son entourage, qu'elle transcende parce qu'elle est faite comme ça. Les souvenirs de sa mère, la tendresse de son père, qui ne vit que pour sa fille, réjouissent le lecteur tant ils étincellent, comme un matin à sa première aube. Beaucoup de choses sont dites sur l'amitié qu'elle partage avec sa meilleure amie, Delfine. Son amour de la nature que, tenant la main inspirante de Natalie Jean, Miranda dépeint magistralement, enjolivée de détails poétiques, là où d'autres ne verraient pas grand-chose. Ses premiers émois pour des garçons de son âge, ses refus de se prêter à des aventures sexuelles sans lendemain. Aucune pruderie à redouter, la jeune fille veut se garder intacte pour l'homme qui la fera frémir, pour que « des ronds s'agrandissent à la surface du lac qui est devenu infini. » Elle veut être espérée, préférée. Chaque chapitre résonne des idéaux de Miranda, sans ne jamais tomber dans une mièvrerie moralisatrice. En toute candeur, elle confie au lecteur qu'elle est vierge, qu'elle « sait exactement comment ça marche ». Sa mère, d'une manière subtile, l'a initiée au mystère de l'amour et surtout au mystère du désir. Le corps, Miranda l'a découvert dans un livre de son idole : Léonard de Vinci. Comme référence, la jeune fille ne pouvait mieux tomber. Ses connaissances anatomiques, elles les partage avec ses amies de classe, ignorantes des ricochets de la puberté qui les guettent. Témoin lucide de sa jeunesse, Miranda contemple les nuages, la pluie, les jardins. Le fleuve. Les orages lui rappellent de joyeux intermèdes au chalet avec ses parents. La détestation de Noël sans sa mère, les parties de pêche avec son père. Tant de faits quotidiens qui diffèrent d'une journée à l'autre, l'adolescente oscillant entre le passé et le présent, entre l'absence d'une mère bienveillante, les attentions compatissantes d'un père débonnaire, fidèle aux sentiments amoureux qu'il a éprouvés pour son épouse. À peine abordés les drames intrinsèques à l'humanité, ravageant un monde infernal qu'elle effleure d'une révolte à peine révélée.
Miranda nous apprend qu'elle est synesthète. Cela se ressent à peine : le regard coloré qu'elle pose naturellement sur ses alentours s'avèrent des balises qui nous invitent à la suivre partout où elle se sent en accord avec sa jeune vie. Il en est de même pour les personnes qu'elle aime, son père au temps présent, sa mère au temps passé. Delfine se glisse dans les interstices qui lui permettent de se retrouver dans un temps qui grandit avec son amie, mais aussi avec des filles et garçons de leur âge. Bientôt, Miranda devra quitter la campagne effervescente pour aller étudier en ville. Pour se mesurer à un univers de béton. Monde futur qu'elle envisage à peine, elle doit profiter intensément de la pluie, des nuages, des bêtes. De la musique que son père lui a apprise. Elle, Miranda, dessine depuis son plus jeune âge. Deviendra-t-elle une artiste ? Cela ne surprendrait pas le lecteur.
Il serait tentant d'écrire que c'est une adolescence idéalisée que dépeint Natalie Jean, souhaitant que des trésors de la sienne l'aient inspirée. Effets d'une génération ou pas, parents aimants ou pas, pavés ou sentiers arpentés, il n'en demeure pas moins que cette période incertaine porte ses marques personnelles, les créent, telle une brûlure sur la peau mal cicatrisée. Parce que l'adolescence, perçue par un regard innocent, poursuit sa turbulente traversée dans de magistrales avenues asphaltées d'espérance.
Si Miranda est faite comme ça, pour notre plus grand plaisir de la fréquenter assidûment à travers les pages, de l'accompagner parmi ses joies, ses peines, Natalie Jean lui a prêté une part de son talent pour la dessiner au centre de turpitudes dans notre monde agité. Il est rare de lire un récit où la magie opère d'une manière autant saisissante, l'écrivaine et son personnage constamment en osmose. La tombée des livres de l'automne nous a plutôt divertie des confidences de jeunes femmes incomprises, comme si la littérature servait de défouloir où déverser ses frustrations. Ce n'est pas un grand livre, comme nous l'entendons, c'est un livre où exulte une tendre générosité envers ses semblables, jeunes et moins jeunes. Caméléon que Miranda, sous la plume pétillante de Natalie Jean, sécrétant des fluides étonnants dans notre monde dépourvu d'oreilles attentives. D'yeux fascinés par des arcs-en-ciel métaphoriques, nés de la nécessité de grandir.
La vie magique, Natalie Jean
Leméac Éditeur, Montréal, 2018, 173 pages
lundi 1 octobre 2018
La face cachée de nos bonnes intentions *** 1/2
Les introductions accompagnant le livre qu'on a lu et qu'on va commenter, nous ramènent à cet instant où la pensée, fulgurante, s'appesantit sur une chose précise. Bien souvent un fait divers qu'on a jugé étonnant, alors que plus tard la mémoire fait abstraction de cette sensation d'étrangeté. Comme quoi, la subjectivité joue un rôle surprenant face à l'incertitude. On commente le numéro 135 de la revue XYZ. La revue de la nouvelle.
Le thème proposé, les armes, impliquait une certaine rigueur, peut-être inconsciente, de la part des écrivains qui ont participé à cette aventure. Rigueur parfois colérique, et même vengeresse. Comme cherchant profondément en eux et en elles, l'irrationnel qui manque à tout jugement spontané quand il s'agit de prendre une décision qui clora un chapitre douloureux de notre existence. À notre habitude, des textes plus que certains nous ont touchée, faisant vibrer une corde sensible qui ne palpite pas aux faits quotidiens. Ce numéro, dirigé par Gaëtan Brulotte, provoque des agissements d'hommes et de femmes qui, en d'autres circonstances, seraient restés endormis. Nos démons intérieurs qui veillent, n'attendent qu'une occasion pour se manifester.
La nouvelle qui ouvre le recueil, signée Stéphanie Pelletier, titrée Les vandales, met en scène une femme âgée qui donne libre cours à sa hargne contre son vieux mari, replié sur un monde moribond. Elle s'emporte contre de mystérieux inopportuns qui ont vandalisé les tombes du cimetière. Il a suffi d'un acte outrageant pour que le moindre geste de son mari se disproportionne. Comme s'il était responsable du saccage des tombes que son épouse, acariâtre, s'évertuera à reconstituer. Récit troublant qui confirme que la violence ensommeillée en nous, fortifie des repères accablants pour se laisser aller à l'aveuglement de l'injustice. Un récit qui tiendra le rôle de locomotive pour accrocher le lecteur à des textes où la violence, souvent sous-jacente, y va de son effet dévastateur. On ne citera pas toutes ces fictions, nous devinerons que les armes interviennent à tous les niveaux de notre inconscience — sinon comment assassiner nos semblables de sang-froid ou est-ce l'effet d'un second état ? — que des faits de guerres, impitoyables, alimentent chaque jour. Le bacha de Michel Robert s'avère un triste exemple de ce qu'on avance. Un enfant nord-africain de dix ans sert de cible sexuelle à un vieux chef de police et à ses sbires. Abandonné de ses parents sur le bord d'une route, le garçon, affamé, se livrera à des hommes sordides. Peu importe le prix à payer, mentionne l'auteur, même si la vie en est ce prix désespéré, voire suicidaire. Texte cruel qui emporte le lecteur vers Attentats automatiques qui se propagent dans plusieurs villes mondiales en l'an de grâce 2029. Lucidité d'un nouvellier, Mario Yeault, dont le pessimisme visionnaire n'épargne personne. Des règlements de comptes, des assassinats qui se commettent pour se venger, où est l'amour qui, de temps à autre, habite l'être humain ? On dirait que la souffrance, la violence, qui émanent de ces fictions, camouflent l'humanisme dont est doté chacun et chacune d'entre nous. Ce n'est pas la nouvelle de Paul Ruban, Pacifica, qui atténuera notre façon de voir et de lire. Un homme aux apparences normales — qu'est-ce qu'au juste la normalité ? — loue une voiture. Il a en tête un schéma sordide qu'il mettra froidement à exécution. Là encore, un acte désespéré, mortellement rancunier, sème la terreur envers des quidams qui, dans un square, défendaient la cause en laquelle ils croyaient. On voudrait que tout soit raison de vivre, contrairement à ce que manigancent certains êtres en porte-à-faux avec leurs convictions corruptibles. Le dernier texte du recueil, Agonie d'une passion, relaie la tendresse aux calendes grecques. Son auteure, Marie-Claude Leclerc, fait part au lecteur de la ruse désinvolte qu'emploie la narratrice qui veut se séparer d'un amant qu'elle aime, mais qui ne semble pas partager ce sentiment amoureux. L'amour s'use, seul le désir excite les corps séduisants.
On ne pourrait fermer le recueil sans mentionner le lauréat du concours annuel de nouvelles de cette année. Si sa nouvelle s'érige habilement sous la bannière créatrice de l'œuvre d'Yves Thériault, le ton demeure étonnamment individuel, innovant une manière tout à fait personnelle de dépeindre un lien affectif unissant un homme âgé à un adolescent amérindien. Le vieil homme initiera le jeune narrateur au noble métier de pêcheur. Un brin de philosophie traverse ce récit dont les non-dits côtoient les sages paroles du Vieux. Les rituels de la vie quotidienne s'entremêlant à la marginalité des deux personnages. Confrontation en douceur de deux générations issues de culture différente. Voir loin, Frédéric Hardel. On note une émouvante fiction dans la section " Thème libre ". Une façon poétique, particulière à Caroline Guindon, de narrer l'histoire d'un vieux professeur érudit qui subjugue ses étudiants. Un titre métaphorique, La mémoire des cathédrales. À lire parmi les textes les plus subtils de ce numéro.
Avec un profond intérêt, on a lu le " Plaidoyer pour la nouvelle belge ", que critique Michel Lord. Ce sont des nouvelles belges à l'usage de tous, choisies par René Godenne. Celui-ci est un éminent spécialiste de la nouvelle française. La critique intelligente, édifiante, de Michel Lord mettra l'eau à la bouche du lecteur attiré par ce genre.
Ce numéro 135 de la revue XYZ est particulièrement riche et vigoureux. Dire original serait banal. On a aimé l'aspect sombre et franc que les nouvelliers et nouvellières ont exprimé dans leurs écrits, sans jamais se banaliser par quelque retenue compréhensive. Celle d'une pudeur discutable. Textes qui éclairent les recoins obscurs de l'âme, défont les nœuds que les événements dramatiques de ces dernières décennies suggèrent à ceux et celles qui utilisent les mots comme moyens de défense. Et même d'attaque. Une arme qui peut trancher dans le vif sans tuer personne. On félicite Gaëtan Brulotte, fervent arbitre de la nouvelle et meneur passionné de ce recueil, qu'il faudra lire maintes fois pour apprécier pleinement, des récits denses, parfois subversifs.
XYZ. La revue de la nouvelle
Numéro 135 dirigé par Gaëtan Brulotte
Montréal, 2018, 101 pages
Le thème proposé, les armes, impliquait une certaine rigueur, peut-être inconsciente, de la part des écrivains qui ont participé à cette aventure. Rigueur parfois colérique, et même vengeresse. Comme cherchant profondément en eux et en elles, l'irrationnel qui manque à tout jugement spontané quand il s'agit de prendre une décision qui clora un chapitre douloureux de notre existence. À notre habitude, des textes plus que certains nous ont touchée, faisant vibrer une corde sensible qui ne palpite pas aux faits quotidiens. Ce numéro, dirigé par Gaëtan Brulotte, provoque des agissements d'hommes et de femmes qui, en d'autres circonstances, seraient restés endormis. Nos démons intérieurs qui veillent, n'attendent qu'une occasion pour se manifester.
La nouvelle qui ouvre le recueil, signée Stéphanie Pelletier, titrée Les vandales, met en scène une femme âgée qui donne libre cours à sa hargne contre son vieux mari, replié sur un monde moribond. Elle s'emporte contre de mystérieux inopportuns qui ont vandalisé les tombes du cimetière. Il a suffi d'un acte outrageant pour que le moindre geste de son mari se disproportionne. Comme s'il était responsable du saccage des tombes que son épouse, acariâtre, s'évertuera à reconstituer. Récit troublant qui confirme que la violence ensommeillée en nous, fortifie des repères accablants pour se laisser aller à l'aveuglement de l'injustice. Un récit qui tiendra le rôle de locomotive pour accrocher le lecteur à des textes où la violence, souvent sous-jacente, y va de son effet dévastateur. On ne citera pas toutes ces fictions, nous devinerons que les armes interviennent à tous les niveaux de notre inconscience — sinon comment assassiner nos semblables de sang-froid ou est-ce l'effet d'un second état ? — que des faits de guerres, impitoyables, alimentent chaque jour. Le bacha de Michel Robert s'avère un triste exemple de ce qu'on avance. Un enfant nord-africain de dix ans sert de cible sexuelle à un vieux chef de police et à ses sbires. Abandonné de ses parents sur le bord d'une route, le garçon, affamé, se livrera à des hommes sordides. Peu importe le prix à payer, mentionne l'auteur, même si la vie en est ce prix désespéré, voire suicidaire. Texte cruel qui emporte le lecteur vers Attentats automatiques qui se propagent dans plusieurs villes mondiales en l'an de grâce 2029. Lucidité d'un nouvellier, Mario Yeault, dont le pessimisme visionnaire n'épargne personne. Des règlements de comptes, des assassinats qui se commettent pour se venger, où est l'amour qui, de temps à autre, habite l'être humain ? On dirait que la souffrance, la violence, qui émanent de ces fictions, camouflent l'humanisme dont est doté chacun et chacune d'entre nous. Ce n'est pas la nouvelle de Paul Ruban, Pacifica, qui atténuera notre façon de voir et de lire. Un homme aux apparences normales — qu'est-ce qu'au juste la normalité ? — loue une voiture. Il a en tête un schéma sordide qu'il mettra froidement à exécution. Là encore, un acte désespéré, mortellement rancunier, sème la terreur envers des quidams qui, dans un square, défendaient la cause en laquelle ils croyaient. On voudrait que tout soit raison de vivre, contrairement à ce que manigancent certains êtres en porte-à-faux avec leurs convictions corruptibles. Le dernier texte du recueil, Agonie d'une passion, relaie la tendresse aux calendes grecques. Son auteure, Marie-Claude Leclerc, fait part au lecteur de la ruse désinvolte qu'emploie la narratrice qui veut se séparer d'un amant qu'elle aime, mais qui ne semble pas partager ce sentiment amoureux. L'amour s'use, seul le désir excite les corps séduisants.
On ne pourrait fermer le recueil sans mentionner le lauréat du concours annuel de nouvelles de cette année. Si sa nouvelle s'érige habilement sous la bannière créatrice de l'œuvre d'Yves Thériault, le ton demeure étonnamment individuel, innovant une manière tout à fait personnelle de dépeindre un lien affectif unissant un homme âgé à un adolescent amérindien. Le vieil homme initiera le jeune narrateur au noble métier de pêcheur. Un brin de philosophie traverse ce récit dont les non-dits côtoient les sages paroles du Vieux. Les rituels de la vie quotidienne s'entremêlant à la marginalité des deux personnages. Confrontation en douceur de deux générations issues de culture différente. Voir loin, Frédéric Hardel. On note une émouvante fiction dans la section " Thème libre ". Une façon poétique, particulière à Caroline Guindon, de narrer l'histoire d'un vieux professeur érudit qui subjugue ses étudiants. Un titre métaphorique, La mémoire des cathédrales. À lire parmi les textes les plus subtils de ce numéro.
Avec un profond intérêt, on a lu le " Plaidoyer pour la nouvelle belge ", que critique Michel Lord. Ce sont des nouvelles belges à l'usage de tous, choisies par René Godenne. Celui-ci est un éminent spécialiste de la nouvelle française. La critique intelligente, édifiante, de Michel Lord mettra l'eau à la bouche du lecteur attiré par ce genre.
Ce numéro 135 de la revue XYZ est particulièrement riche et vigoureux. Dire original serait banal. On a aimé l'aspect sombre et franc que les nouvelliers et nouvellières ont exprimé dans leurs écrits, sans jamais se banaliser par quelque retenue compréhensive. Celle d'une pudeur discutable. Textes qui éclairent les recoins obscurs de l'âme, défont les nœuds que les événements dramatiques de ces dernières décennies suggèrent à ceux et celles qui utilisent les mots comme moyens de défense. Et même d'attaque. Une arme qui peut trancher dans le vif sans tuer personne. On félicite Gaëtan Brulotte, fervent arbitre de la nouvelle et meneur passionné de ce recueil, qu'il faudra lire maintes fois pour apprécier pleinement, des récits denses, parfois subversifs.
XYZ. La revue de la nouvelle
Numéro 135 dirigé par Gaëtan Brulotte
Montréal, 2018, 101 pages
lundi 17 septembre 2018
Un musicien face à ses démons extérieurs *** 1/2
On n'a rien lu, on n'a rien écrit ces jours derniers. On a reniflé d'imperceptibles odeurs printanières, comme si cela se pouvait alors que la neige revêt encore les pelouses et les trottoirs. Aucune importance, on se dit que lorsqu'on utilisera ces quelques lignes, les méfaits hivernaux auront disparu, on sera sur le point de commenter un livre duquel pour le moment on ignore tout de sa teneur. On a choisi le roman de Daniel Lytwynuk, Alex Toth ( erratum ).
Étonnant premier livre d'un auteur d'âge mûr. Ce qui ne nous surprend pas, les connaissances musicales ne pouvant être acquises dès l'enfance de l'art et de l'homme. Alex Toth est cet homme qui fera les frais d'une aventure existentielle et professionnelle, ne fera rien pour y échapper. Bien au contraire. Sa vie, réglée comme du papier à musique, sans jeu de mots, est teintée d'habitudes et d'ennui. Sa renommée mondiale de concertiste d'œuvres romantiques lui interdit tout faux pas et, quand il osera se rebiffer contre ce monde trop ordonné, il sera sommé par sa compagne depuis deux décennies, par son agent musical, de rentrer dans l'ordre du monde symphonique, de déserter celui de la cacophonie. L'inspiratrice de cette rebuffade artistique est une galeriste de vingt-cinq ans, Gwendoline Op de Beeck, que le pianiste a rencontré chez elle. Dans son atelier se situant dans le Vieux-Montréal. Invitation sur carton publicitaire que son agent lui a remis après son dernier concert. Le coudoiement entre le pianiste et la peintre sera cocasse. Ne lui demandera-t-elle pas de lui raser les jambes ? Mais derrière cette situation saugrenue, à saveur ingénue, Gwendoline regorge de ressources musicales, qui dérouteront le concertiste, discipliné à une musique classique que ses spectateurs apprécient, sans se poser de questions. Quand il ajoutera une pièce contemporaine à son prochain concert, il ne se doute pas jusqu'où l'entrainera Gwendoline dans les choix arbitraires auxquels elle l'astreint. Jeune femme mystérieuse, diplômée en histoire de l'art et en arts multidisciplinaires, qui sort peu de son chez-soi, qui peint tranquillement, ceinte d'une culture musicale contemporaine peu commune. Son intrusion intempestive dans la vie du concertiste ne se fera pas sans rejet ni brisures, lui qui s'est laissé vivre douillettement dans la sécurité apaisante de sa conjointe mondaine, Zena, assuré du dévouement professionnel de son agent, Victor. Son fidèle public ne le suit plus, ses amis, il en a peu, évitent le farfelu désinvolte qu'il est devenu, bien que quelques-uns restassent attentifs et généreux aux élucubrations fantasques de l'interprète.
Ce qui surprend dans cette histoire, est la pragmatique relation qui s'établit entre cet homme et cette femme, qui ont des convergences communes, celles de l'art musical et pictural, échangeant des points de vue artistiques, ce qu'admettra sans faillir le musicien, attiré vers Gwendoline mais rarement d'une manière sexuelle, malgré quelques indices métaphoriques. Au début du récit, n'a-t-il pas consulté un urologue, recommandé par son ami Normand ? N'est-il pas anachronique, lui qui note ses rendez-vous dans un petit carnet, aimant « les crayons, l'odeur des encres et le geste de salir les pages. » ? De ces succincts détails, le lecteur comprend mieux son comportement vis-à-vis d'une jeune femme séduisante qui, l'admirant, lui impose des œuvres iconoclastes, peu prisées d'un public conventionnel. Henry Cowell. Trois compositrices du début du XXe siècle, à qui il consacrera un concert, balayant son programme initial d'un revers de la main, au grand dam de Zena et de Victor. Plus tard, John Foulds, George Crumb seront les compositeurs sublimant un concert quelque peu hétéroclite, qui fera scandale dans l'univers figé de la musique classique. Gwendoline incite le pianiste à se surpasser, à inviter son public « dans » la musique. Utopie ou frustration d'une jeune femme qui se joue d'un homme désenchanté ? L'écrivain, Daniel Lytwynuk, ne manque pas d'humour, laissant le lecteur désarçonné lorsque Gwendoline, devenue la directrice scénique d'Alex Toth, enfouit à l'intérieur du piano sept cents sauterelles, rythmant leurs notes à celles du pianiste paniqué, impuissant à contrôler les bondissements des insectes, Gwendoline n'informant jamais le musicien de ses intentions artistiques. La réaction de Zena et de Victor s'avère catastrophique, comment pourraient-ils accepter la démarche discutable d'un artiste qui, à quarante-deux ans, se range au désir d'une femme de vingt-cinq ans, déconstruisant sa carrière, acquise de peine et de misère, lui rappelle furieusement Zena. À mesure que l'incompréhension les sépare, nous percevons la tendresse qu'Alex Toth ressent pour sa compagne, qui déserte leur couple et leur appartement. Le dernier concert sera éprouvant, il s'agit d'une pièce d'Erwin Schulhoff, compositeur classique mais aussi de jazz, exécuté par les nazis dans le camp de concentration de Wülzburg. Fidèle à ce qu'elle représente, Gwendoline a fait preuve d'une initiative surprenante, cette fois lugubre, en créant l'événement, allégorisant une mise en scène terrifiante. Dernier spectacle délirant mais aussi, émouvant, quand monte sur la scène un vieux monsieur juif allemand qui a fui le nazisme. Le vieil homme a été bouleversé par le concert allégorique donné par le célèbre Alex Toth...
Concerts auxquels n'a jamais assisté Gwendoline Op de Beeck, faisant confiance à l'interprète de génie qu'elle soumet à ses considérations philosophiques sur l'art, dissimulant ainsi son dilettantisme. N'ira-t-elle pas jusqu'à inciter son chat, Picabia, à traverser la scène lors du premier concert Chopin du pianiste, insinuant dans ses répliques souvent circonspectes, que tout n'est qu'illusion, fragilité, bénignité, ce que le lecteur apprendra à la fin du récit. Librement venu dans la vie de la jeune femme, comment fera-t-il pour trouver une issue de secours, Gwendoline lui apportant enfin une réponse à travers les tableaux qu'elle peint de jour et de nuit ? Critères ésotériques, persuasifs de la peintre qui ont encouragé le musicien chaque fois qu'il lisait sur le piano un aphorisme écrit de la main de sa directrice artistique. Est-ce un erratum musical qu'il a commis, une erreur humaine qui fait de ce roman un récit inclassable, dérangeant, qui interroge le lecteur sur la précarité de ses valeurs esthétiques quand, dans son existence, survient une jeune personne bousculant, sans états d'âme, des acquis difficilement gagnés mais, parfois, si réconfortants à perdre !
Alex Toth ( erratum ), Daniel Lytwynuk
Collection « Première impression »
Éditions Québec Amérique, Montréal, 2018, 176 pages
Étonnant premier livre d'un auteur d'âge mûr. Ce qui ne nous surprend pas, les connaissances musicales ne pouvant être acquises dès l'enfance de l'art et de l'homme. Alex Toth est cet homme qui fera les frais d'une aventure existentielle et professionnelle, ne fera rien pour y échapper. Bien au contraire. Sa vie, réglée comme du papier à musique, sans jeu de mots, est teintée d'habitudes et d'ennui. Sa renommée mondiale de concertiste d'œuvres romantiques lui interdit tout faux pas et, quand il osera se rebiffer contre ce monde trop ordonné, il sera sommé par sa compagne depuis deux décennies, par son agent musical, de rentrer dans l'ordre du monde symphonique, de déserter celui de la cacophonie. L'inspiratrice de cette rebuffade artistique est une galeriste de vingt-cinq ans, Gwendoline Op de Beeck, que le pianiste a rencontré chez elle. Dans son atelier se situant dans le Vieux-Montréal. Invitation sur carton publicitaire que son agent lui a remis après son dernier concert. Le coudoiement entre le pianiste et la peintre sera cocasse. Ne lui demandera-t-elle pas de lui raser les jambes ? Mais derrière cette situation saugrenue, à saveur ingénue, Gwendoline regorge de ressources musicales, qui dérouteront le concertiste, discipliné à une musique classique que ses spectateurs apprécient, sans se poser de questions. Quand il ajoutera une pièce contemporaine à son prochain concert, il ne se doute pas jusqu'où l'entrainera Gwendoline dans les choix arbitraires auxquels elle l'astreint. Jeune femme mystérieuse, diplômée en histoire de l'art et en arts multidisciplinaires, qui sort peu de son chez-soi, qui peint tranquillement, ceinte d'une culture musicale contemporaine peu commune. Son intrusion intempestive dans la vie du concertiste ne se fera pas sans rejet ni brisures, lui qui s'est laissé vivre douillettement dans la sécurité apaisante de sa conjointe mondaine, Zena, assuré du dévouement professionnel de son agent, Victor. Son fidèle public ne le suit plus, ses amis, il en a peu, évitent le farfelu désinvolte qu'il est devenu, bien que quelques-uns restassent attentifs et généreux aux élucubrations fantasques de l'interprète.
Ce qui surprend dans cette histoire, est la pragmatique relation qui s'établit entre cet homme et cette femme, qui ont des convergences communes, celles de l'art musical et pictural, échangeant des points de vue artistiques, ce qu'admettra sans faillir le musicien, attiré vers Gwendoline mais rarement d'une manière sexuelle, malgré quelques indices métaphoriques. Au début du récit, n'a-t-il pas consulté un urologue, recommandé par son ami Normand ? N'est-il pas anachronique, lui qui note ses rendez-vous dans un petit carnet, aimant « les crayons, l'odeur des encres et le geste de salir les pages. » ? De ces succincts détails, le lecteur comprend mieux son comportement vis-à-vis d'une jeune femme séduisante qui, l'admirant, lui impose des œuvres iconoclastes, peu prisées d'un public conventionnel. Henry Cowell. Trois compositrices du début du XXe siècle, à qui il consacrera un concert, balayant son programme initial d'un revers de la main, au grand dam de Zena et de Victor. Plus tard, John Foulds, George Crumb seront les compositeurs sublimant un concert quelque peu hétéroclite, qui fera scandale dans l'univers figé de la musique classique. Gwendoline incite le pianiste à se surpasser, à inviter son public « dans » la musique. Utopie ou frustration d'une jeune femme qui se joue d'un homme désenchanté ? L'écrivain, Daniel Lytwynuk, ne manque pas d'humour, laissant le lecteur désarçonné lorsque Gwendoline, devenue la directrice scénique d'Alex Toth, enfouit à l'intérieur du piano sept cents sauterelles, rythmant leurs notes à celles du pianiste paniqué, impuissant à contrôler les bondissements des insectes, Gwendoline n'informant jamais le musicien de ses intentions artistiques. La réaction de Zena et de Victor s'avère catastrophique, comment pourraient-ils accepter la démarche discutable d'un artiste qui, à quarante-deux ans, se range au désir d'une femme de vingt-cinq ans, déconstruisant sa carrière, acquise de peine et de misère, lui rappelle furieusement Zena. À mesure que l'incompréhension les sépare, nous percevons la tendresse qu'Alex Toth ressent pour sa compagne, qui déserte leur couple et leur appartement. Le dernier concert sera éprouvant, il s'agit d'une pièce d'Erwin Schulhoff, compositeur classique mais aussi de jazz, exécuté par les nazis dans le camp de concentration de Wülzburg. Fidèle à ce qu'elle représente, Gwendoline a fait preuve d'une initiative surprenante, cette fois lugubre, en créant l'événement, allégorisant une mise en scène terrifiante. Dernier spectacle délirant mais aussi, émouvant, quand monte sur la scène un vieux monsieur juif allemand qui a fui le nazisme. Le vieil homme a été bouleversé par le concert allégorique donné par le célèbre Alex Toth...
Concerts auxquels n'a jamais assisté Gwendoline Op de Beeck, faisant confiance à l'interprète de génie qu'elle soumet à ses considérations philosophiques sur l'art, dissimulant ainsi son dilettantisme. N'ira-t-elle pas jusqu'à inciter son chat, Picabia, à traverser la scène lors du premier concert Chopin du pianiste, insinuant dans ses répliques souvent circonspectes, que tout n'est qu'illusion, fragilité, bénignité, ce que le lecteur apprendra à la fin du récit. Librement venu dans la vie de la jeune femme, comment fera-t-il pour trouver une issue de secours, Gwendoline lui apportant enfin une réponse à travers les tableaux qu'elle peint de jour et de nuit ? Critères ésotériques, persuasifs de la peintre qui ont encouragé le musicien chaque fois qu'il lisait sur le piano un aphorisme écrit de la main de sa directrice artistique. Est-ce un erratum musical qu'il a commis, une erreur humaine qui fait de ce roman un récit inclassable, dérangeant, qui interroge le lecteur sur la précarité de ses valeurs esthétiques quand, dans son existence, survient une jeune personne bousculant, sans états d'âme, des acquis difficilement gagnés mais, parfois, si réconfortants à perdre !
Alex Toth ( erratum ), Daniel Lytwynuk
Collection « Première impression »
Éditions Québec Amérique, Montréal, 2018, 176 pages
lundi 10 septembre 2018
Jeunesse truquée et tribulations sexuelles *** 1/2
La chaleur est un élément favorable au silence, à la méditation. Le regard, rêveur, s'attarde sur les paysages, parfois sur les objets. Comme si les gestes plus dénoués de l'hiver ralentissaient leur rythme effréné. Où est la vraie vie, celle qui gouverne le monde, sans distinction aucune de signes distinctifs ou d'interrogations insipides ? On commente le roman de Virginie Francoeur, JELLY BEAN.
Étrange fiction dérangeante dès la première lecture. On sourit, on s'étonne, on s'interroge, persuadée qu'on ne saura donner une quelconque opinion sur cette histoire fracturée d'épineux travers. Puis, peu à peu, une réalité se décante, on ne peut faire autrement que de relire des pages qui nous ont échappées, ne comprenant pas grand-chose à ce milieu interlope, déconnecté de notre univers assurément fréquentable. Ophélie, la narratrice, se pose en spectatrice consentante, elle distribue sa jeunesse à qui désire la cueillir, sans jamais se compromettre, parvenue au faîte d'évènements fracassant le récit. Fille unique de parents intellectuels, née à Outremont, quartier bourgeois duquel elle veut s'évader. Éducation catholique dans un pensionnat pour filles. Sa mère s'est séparée du père, lasse de ses infortunes matérielles. Ophélie vit avec ce père insouciant, plus que libéral. Occupé à rétablir ses faillites, ce dernier ignore les frasques de sa fille tant aimée. À l'âge adolescent, Ophélie a jeté son dévolu sur l'une de ses ravissantes copines d'école. Sandra. Dévolu admiratif qui va l'entraîner dans des aventures desquelles elle abandonnera quelques morceaux de son corps, de son innocence. Se désillusionnant d'hommes qui traitent les femmes comme des objets luxueux désirables, rien de moins. Pour mieux suivre Sandra, Ophélie est devenue serveuse dans un bar de danseuses nues, lieu miteux où les rivalités entre filles sont peut-être la véritable stimulation à se contorsionner autour d'un poteau. Les corps s'exacerbent quand l'argent et l'alcool coulent à flots. Quand la drogue louvoie en circuit à peine fermé. C'est dans cette atmosphère viciée à tous les degrés qu'Ophélie a rejoint Sandra, déjà la chair abimée par des nuits avilissantes, bafouée par des hommes qui, leur libido rassasiée, retrouvent femme et enfants meublant tristement un bungalow dans quelque banlieue anonyme, leurs rêves inqualifiables suffisant à combler d'avides fantasmes sexuels.
L'histoire qu'a concocté habilement Virginie Francoeur est-elle prétexte à décrire les exacerbations d'un monde de femmes et d'hommes qui n'étreignent que le vide ? Richesse clinquante acquise auprès d'amants qui trament des affaires louches dans des pays asiatiques, de préférence. Le folklore oriental possède encore ses attraits, bien qu'il se restreigne à quelques poignées d'hommes détachés de toute substance humaine. Si Sandra représente un aspect d'une société misérable, — sa mère n'est-elle pas barmaid de brasserie ? —, son amie Djamila, jeune femme exubérante, « genre jaillissant d'une oasis de rêve », s'apparente à une famille musulmane bourgeoise de ville Mont-Royal. Bien que rigoureusement fidèle aux traditions religieuses, elle collectionne des partenaires juifs et arabes, richissimes et âgés, s'étourdit entre des loisirs somptueux et des amants à peine visibles. Djamila, donc, révèle un aspect crapuleux d'une coterie asociale, ne s'appuyant que sur le factice de situations dites professionnelles, ces hommes ne laissant transparaitre aucun indice suspect face à leurs maitresses, achetant leur chair à coups de gains véreux, camouflés dans des boules de Noël, sulfureuses. Sandra et Djamila s'avèrent aux antipodes l'une de l'autre, se jurent une fidélité à tout crin. Ce sera Ophélie qui, à plusieurs reprises, subjuguée par les folies dépensières de Djamila, déplorant la déchéance physique de Sandra, se rendra compte que quelque chose ne tourne pas rond dans leur trio livré à une répétitive débauche nocturne. Malaise qu'elle confiera à Sandra qui la rassurera, l'invitant à profiter impunément du moment présent. Ophélie n'est pas dupe, il y a dans le regard de son amie « une ombre de détresse, un vaste nuage noir insaisissable ».
Tout au long de ce périple sans issue, Ophélie se remémore amèrement la jeunesse insouciante, intellectuelle, qui a été la sienne jusqu'au départ de sa mère. Elle avait onze ans. Nous comprendrons pour quelles raisons affectives elle a éprouvé un sentiment sororal, indéfectible, pour Sandra : elle a été séduite par ses longs cheveux blonds, son air boudeur à la Bardot. « Quatorze ans et l'air de vingt. » Il lui faudra traverser une sorte d'enfer, risquant d'y laisser la vie, pour essayer de s'en échapper, et y parvenir. Un sort plus tragique happera Sandra dans ses crocs mortels. Djamila fuira aux confins de pays orientaux pour se soustraire à la colère vengeresse d'un vieil amant juif, la belle ayant abusé de sa générosité démesurée. Si on ébauche à peine cette fiction — en est-elle une ? —, c'est qu'on y a décelé une fable profonde qui méritait mieux que de s'arrêter aux apparences. Et les apparences ne manquent pas, ces trois femmes se réduisant à croquer des petites pilules — mini jelly beans — pour traquer l'euphorie de l'existence. « Du paradis-comprimés à volonté. » Ce n'est pas le roman d'une génération, comme cela a été mentionné, c'est le récit d'une écrivaine qui désirait nous démontrer d'une plume avertie, sans fioritures improvisées, que la luxure et la pauvreté sont parfois liées ensemble, soumettent des femmes aux pires misères, à de sordides tentations. Ophélie elle-même en subira les conséquences en tombant amoureuse du nouveau portier du bar. En étant la victime de douanières trop entreprenantes. Victime aussi d'une overdose qui propulse le lecteur dans un univers perçu au bout de lorgnettes accessoires. La réalité n'exhibe-t-elle pas parfois un envers sordide ? On a l'impression saisissante qu'Ophélie joue le rôle d'une journaliste qui mènerait une enquête sur les péripéties d'hommes et de femmes cherchant autre chose — mais quoi ? —, n'accédant qu'au plaisir éphémère, excessif des sens, visant d'inatteignables culminances. La compassion et la tendresse, sentiments qui ne veulent pas être nommés, parcourent chaque page. Le regret, innommé aussi, de ne pas s'être ancrées dans une existence plus consistante. Quelquefois murmuré par la voix d'Ophélie quand elle pleure sur son ourson saccagé. Et bien d'autres non-dits qui rebondissent à travers les agissements compulsifs de trois femmes inséparables. Si peu en rapport avec elles-mêmes, avec les autres, qui encombrent leur route jalonnée de manques et de refoulements.
Premier roman fort réussi d'une jeune écrivaine intelligente, observant ses semblables avec un brin d'amertume ironique. Utilisant un style acerbe et corrosif, des termes crus, pour intensifier des propos langagiers percutants, souvent à hauteur de la désespérance de Sandra, pour fouailler la perversité de Djamila, dénoncer la crédulité lucide d'Ophélie. Roman qui, témoignant de la vie de trois femmes à la recherche d'elles-mêmes, superbement dépeintes par Virginie Francoeur, se lit une première fois avec le sourire aux lèvres, nécessitant de s'y pencher à nouveau, le sourire en moins. Ce qu'on a fait sans hésiter pour savourer la " substantifique moelle " de ce récit atypique. Reconnaissant le talent d'une écrivaine surprenante, elle-même marginale, tant son parcours littéraire, déjà, impressionne.
JELLY BEAN, Virginie Francoeur
Éditions Druide, collection Écarts
Montréal, 2018, 184 pages
Étrange fiction dérangeante dès la première lecture. On sourit, on s'étonne, on s'interroge, persuadée qu'on ne saura donner une quelconque opinion sur cette histoire fracturée d'épineux travers. Puis, peu à peu, une réalité se décante, on ne peut faire autrement que de relire des pages qui nous ont échappées, ne comprenant pas grand-chose à ce milieu interlope, déconnecté de notre univers assurément fréquentable. Ophélie, la narratrice, se pose en spectatrice consentante, elle distribue sa jeunesse à qui désire la cueillir, sans jamais se compromettre, parvenue au faîte d'évènements fracassant le récit. Fille unique de parents intellectuels, née à Outremont, quartier bourgeois duquel elle veut s'évader. Éducation catholique dans un pensionnat pour filles. Sa mère s'est séparée du père, lasse de ses infortunes matérielles. Ophélie vit avec ce père insouciant, plus que libéral. Occupé à rétablir ses faillites, ce dernier ignore les frasques de sa fille tant aimée. À l'âge adolescent, Ophélie a jeté son dévolu sur l'une de ses ravissantes copines d'école. Sandra. Dévolu admiratif qui va l'entraîner dans des aventures desquelles elle abandonnera quelques morceaux de son corps, de son innocence. Se désillusionnant d'hommes qui traitent les femmes comme des objets luxueux désirables, rien de moins. Pour mieux suivre Sandra, Ophélie est devenue serveuse dans un bar de danseuses nues, lieu miteux où les rivalités entre filles sont peut-être la véritable stimulation à se contorsionner autour d'un poteau. Les corps s'exacerbent quand l'argent et l'alcool coulent à flots. Quand la drogue louvoie en circuit à peine fermé. C'est dans cette atmosphère viciée à tous les degrés qu'Ophélie a rejoint Sandra, déjà la chair abimée par des nuits avilissantes, bafouée par des hommes qui, leur libido rassasiée, retrouvent femme et enfants meublant tristement un bungalow dans quelque banlieue anonyme, leurs rêves inqualifiables suffisant à combler d'avides fantasmes sexuels.
L'histoire qu'a concocté habilement Virginie Francoeur est-elle prétexte à décrire les exacerbations d'un monde de femmes et d'hommes qui n'étreignent que le vide ? Richesse clinquante acquise auprès d'amants qui trament des affaires louches dans des pays asiatiques, de préférence. Le folklore oriental possède encore ses attraits, bien qu'il se restreigne à quelques poignées d'hommes détachés de toute substance humaine. Si Sandra représente un aspect d'une société misérable, — sa mère n'est-elle pas barmaid de brasserie ? —, son amie Djamila, jeune femme exubérante, « genre jaillissant d'une oasis de rêve », s'apparente à une famille musulmane bourgeoise de ville Mont-Royal. Bien que rigoureusement fidèle aux traditions religieuses, elle collectionne des partenaires juifs et arabes, richissimes et âgés, s'étourdit entre des loisirs somptueux et des amants à peine visibles. Djamila, donc, révèle un aspect crapuleux d'une coterie asociale, ne s'appuyant que sur le factice de situations dites professionnelles, ces hommes ne laissant transparaitre aucun indice suspect face à leurs maitresses, achetant leur chair à coups de gains véreux, camouflés dans des boules de Noël, sulfureuses. Sandra et Djamila s'avèrent aux antipodes l'une de l'autre, se jurent une fidélité à tout crin. Ce sera Ophélie qui, à plusieurs reprises, subjuguée par les folies dépensières de Djamila, déplorant la déchéance physique de Sandra, se rendra compte que quelque chose ne tourne pas rond dans leur trio livré à une répétitive débauche nocturne. Malaise qu'elle confiera à Sandra qui la rassurera, l'invitant à profiter impunément du moment présent. Ophélie n'est pas dupe, il y a dans le regard de son amie « une ombre de détresse, un vaste nuage noir insaisissable ».
Tout au long de ce périple sans issue, Ophélie se remémore amèrement la jeunesse insouciante, intellectuelle, qui a été la sienne jusqu'au départ de sa mère. Elle avait onze ans. Nous comprendrons pour quelles raisons affectives elle a éprouvé un sentiment sororal, indéfectible, pour Sandra : elle a été séduite par ses longs cheveux blonds, son air boudeur à la Bardot. « Quatorze ans et l'air de vingt. » Il lui faudra traverser une sorte d'enfer, risquant d'y laisser la vie, pour essayer de s'en échapper, et y parvenir. Un sort plus tragique happera Sandra dans ses crocs mortels. Djamila fuira aux confins de pays orientaux pour se soustraire à la colère vengeresse d'un vieil amant juif, la belle ayant abusé de sa générosité démesurée. Si on ébauche à peine cette fiction — en est-elle une ? —, c'est qu'on y a décelé une fable profonde qui méritait mieux que de s'arrêter aux apparences. Et les apparences ne manquent pas, ces trois femmes se réduisant à croquer des petites pilules — mini jelly beans — pour traquer l'euphorie de l'existence. « Du paradis-comprimés à volonté. » Ce n'est pas le roman d'une génération, comme cela a été mentionné, c'est le récit d'une écrivaine qui désirait nous démontrer d'une plume avertie, sans fioritures improvisées, que la luxure et la pauvreté sont parfois liées ensemble, soumettent des femmes aux pires misères, à de sordides tentations. Ophélie elle-même en subira les conséquences en tombant amoureuse du nouveau portier du bar. En étant la victime de douanières trop entreprenantes. Victime aussi d'une overdose qui propulse le lecteur dans un univers perçu au bout de lorgnettes accessoires. La réalité n'exhibe-t-elle pas parfois un envers sordide ? On a l'impression saisissante qu'Ophélie joue le rôle d'une journaliste qui mènerait une enquête sur les péripéties d'hommes et de femmes cherchant autre chose — mais quoi ? —, n'accédant qu'au plaisir éphémère, excessif des sens, visant d'inatteignables culminances. La compassion et la tendresse, sentiments qui ne veulent pas être nommés, parcourent chaque page. Le regret, innommé aussi, de ne pas s'être ancrées dans une existence plus consistante. Quelquefois murmuré par la voix d'Ophélie quand elle pleure sur son ourson saccagé. Et bien d'autres non-dits qui rebondissent à travers les agissements compulsifs de trois femmes inséparables. Si peu en rapport avec elles-mêmes, avec les autres, qui encombrent leur route jalonnée de manques et de refoulements.
Premier roman fort réussi d'une jeune écrivaine intelligente, observant ses semblables avec un brin d'amertume ironique. Utilisant un style acerbe et corrosif, des termes crus, pour intensifier des propos langagiers percutants, souvent à hauteur de la désespérance de Sandra, pour fouailler la perversité de Djamila, dénoncer la crédulité lucide d'Ophélie. Roman qui, témoignant de la vie de trois femmes à la recherche d'elles-mêmes, superbement dépeintes par Virginie Francoeur, se lit une première fois avec le sourire aux lèvres, nécessitant de s'y pencher à nouveau, le sourire en moins. Ce qu'on a fait sans hésiter pour savourer la " substantifique moelle " de ce récit atypique. Reconnaissant le talent d'une écrivaine surprenante, elle-même marginale, tant son parcours littéraire, déjà, impressionne.
JELLY BEAN, Virginie Francoeur
Éditions Druide, collection Écarts
Montréal, 2018, 184 pages
lundi 27 août 2018
Être soi et un autre ****
Malgré le soleil qui essaie de pourchasser les derniers détritus hivernaux, la semaine s'annonce difficile. On ne sait trop pourquoi ce verdict prémonitoire. Comme si une personne nous manquait ou même un objet, qui aurait soudainement disparu de notre décor familier. Ceci pour dénoncer la fragilité de notre soi quand la fatigue, venue on ne sait d'où, nous fait trébucher jusqu'à terre, tel un chevalier déchu de ses titres. On commente le livre de Ringuet, L'héritage et autres contes.
Ces histoires publiées une première fois à Montréal, aux éditions Variétés, en 1946, puis, aux éditions Fides en 1971, sont rééditées à la Bibliothèque Québécoise ( BQ ). De courts récits libellés " contes " mais qui, de nos jours, par la sobriété de leur teneur, leur structure aérée, leur écriture intimiste, se classeraient dans les nouvelles qu'on apprécie tellement quand elles sont rédigées selon les règles qu'impose le " petit genre ".
Neuf histoires relatent des aventures brèves, se déroulant au Québec ou ailleurs dans le monde. Entre les années 1940 et 1950. On y perçoit toutes formes de colonialisme, le monde de cette époque étant sous tutelle d'impérialisme ou d'expansionnisme. Le conte éponyme, L'héritage, narre la venue d'un homme, Albert Langelier, soupçonné d'être le fils naturel de Baptiste Langelier, dans un village québécois, Grand-Pins, aux prises avec les dictats de l'État et de l'Église d'alors. Débardeur au chômage, l'homme s'apprête à recevoir un héritage inattendu : une ferme, et une terre « maigre et se refuse à la culture ordinaire », seul le tabac y croît. Ne connaissant pas grand-chose à l'agriculture, le citadin inexpérimenté renouvelle le matériel désuet dont il a aussi hérité. Une jeune femme, Marie, surnommée La Poune, continue à faire les travaux ménagers, comme si de rien n'était. La canicule s'installe, pas une goutte d'eau ne tombe pour alimenter les plants de tabac. Albert Langelier, l'étranger, tenu responsable de cette sécheresse, choisira de retourner à Montréal, après avoir abattu son chien d'un coup de hache. Marie, « une ombre [ qui ] se détacha d'un groupe de sapins », le regarde aller. Deux contes traitent du thème de l'étranger qui débarque dans un village et perturbe le quotidien de gens habitués à leur morne tranquillité. Sept jours, conte qui emporte le lecteur dans un village aux abords sympathiques, où les gens vivent en harmonie, préoccupés de soucis restreints. Chaque jour de la semaine nous fait mieux connaître la boulangère, l'abbé, le père Saint-Jean, d'autres, autant pittoresques. Chacun y va de ses commentaires, de sa tirade hargneuse, quand s'installe à l'unique hôtel un jeune homme qui intrigue les villageois, délie leur langue et surtout trouble leur conscience, alors que lui se contente de sourire, de saluer, ravivant la coquetterie et mesquinerie des femmes, ranimant les chamailleries des hommes à propos de prochaines élections.
Ce qui surprend dans l'ensemble du recueil, ce sont ces hommes qui ont fui ce qu'ils sont, ce qu'ils possèdent, essayant d'être à la hauteur de situations où eux-mêmes représentent l'étranger tant redouté de ceux et celles qui n'ont jamais franchi de frontières. Qu'il travaille dans une filature, imaginant où le conduirait une voiture de luxe, comme celle du patron, qu'il panique quand il se réveille, rêvant d'une solution mettant fin au sommeil, qu'il soit amoureux de la Vénus de Vélasquez, la recherchant dans une femme moderne, tous ces hommes ont fui les apparences, pensant trouver mieux ailleurs. Étrangers à leur misère mentale et morale, à leur inassouvissement rancunier contre une société inadaptable, croient-ils. Ils ne sont pas le double d'eux-mêmes, mais, impulsés par une insatisfaction atavique, ils partent dans des pays où ils souhaitent se renouveler sous différents aspects. Cependant, le conte qui nous a le plus touchée, parce que véridique, se titre La sentinelle. Un chauffeur dont la voiture tombe en panne au bord de la jungle, recommande à son passager de l'attendre chez le Tonto, le fou, qui garde jalousement la machinerie détériorée, conséquence de l'échec français que fut l'élaboration du canal de Panama, projet abandonné depuis une quarantaine d'années. Les machines pourrissent « [ ensevelies ] sous le linceul vert, éternellement vert. » Ce linceul vert n'est autre que la végétation luxuriante de la forêt tropicale. Le Tonto a toujours cru, entêté dans sa folie, que le grand ingénieur Lesseps reviendrait terminer son immense entreprise. C'est un conte émouvant, angoissant, prouvant une fois encore que l'homme n'a aucun pouvoir sur la nature : elle engloutit tout ce qui se tient à sa portée. On n'est pas étonnée que le passager, repartant avec le chauffeur, ressente une envie de pleurer face à la folie d'un homme, englouti dans sa propre démence. Magnifique symbole de l'être humain explorant ses déboires déchirants.
La plupart des contes comme celui-ci stupéfient par leur modernisme, par la folie indécente qui menace les protagonistes, ces hommes à la recherche de ce qu'ils ne peuvent atteindre en étant eux-mêmes, leur rêve inaccessible les conduisant vers la perte de soi, de l'être qu'il devient, l'enveloppe initiale, telle la nature, reprenant ses droits. Dans leur nouvelle peau, ces hommes sont atteints d'une mégalomanie délirante qui les emporte vers leur propre destruction. Le temps de l'autre ne dure que lorsque le masque, usé, s'effrite, révèle la véritable identité de l'imposteur, significative dans le conte intitulé si justement, L'étranger.
C'est un livre admirable que nous propose Ringuet, auteur du célèbre roman Trente arpents. Friande de ces récits particuliers, on les a découverts avec une joie indéniable. L'écriture descriptive, précise et détaillée, le style épuré, jamais encombré de résidus romanesques, nous ouvre les portes de la nouvelle, telle qu'elle s'écrit aujourd'hui, incisive et concise. Ringuet fut le précurseur, peut-on avancer, de ce genre minimaliste, si difficile à apprivoiser. À mener à son terme persuasif et accompli.
L'héritage et autres contes, Ringuet
Bibliothèque québécoise ( BQ ), Montréal, 2018, 181 pages
Ces histoires publiées une première fois à Montréal, aux éditions Variétés, en 1946, puis, aux éditions Fides en 1971, sont rééditées à la Bibliothèque Québécoise ( BQ ). De courts récits libellés " contes " mais qui, de nos jours, par la sobriété de leur teneur, leur structure aérée, leur écriture intimiste, se classeraient dans les nouvelles qu'on apprécie tellement quand elles sont rédigées selon les règles qu'impose le " petit genre ".
Neuf histoires relatent des aventures brèves, se déroulant au Québec ou ailleurs dans le monde. Entre les années 1940 et 1950. On y perçoit toutes formes de colonialisme, le monde de cette époque étant sous tutelle d'impérialisme ou d'expansionnisme. Le conte éponyme, L'héritage, narre la venue d'un homme, Albert Langelier, soupçonné d'être le fils naturel de Baptiste Langelier, dans un village québécois, Grand-Pins, aux prises avec les dictats de l'État et de l'Église d'alors. Débardeur au chômage, l'homme s'apprête à recevoir un héritage inattendu : une ferme, et une terre « maigre et se refuse à la culture ordinaire », seul le tabac y croît. Ne connaissant pas grand-chose à l'agriculture, le citadin inexpérimenté renouvelle le matériel désuet dont il a aussi hérité. Une jeune femme, Marie, surnommée La Poune, continue à faire les travaux ménagers, comme si de rien n'était. La canicule s'installe, pas une goutte d'eau ne tombe pour alimenter les plants de tabac. Albert Langelier, l'étranger, tenu responsable de cette sécheresse, choisira de retourner à Montréal, après avoir abattu son chien d'un coup de hache. Marie, « une ombre [ qui ] se détacha d'un groupe de sapins », le regarde aller. Deux contes traitent du thème de l'étranger qui débarque dans un village et perturbe le quotidien de gens habitués à leur morne tranquillité. Sept jours, conte qui emporte le lecteur dans un village aux abords sympathiques, où les gens vivent en harmonie, préoccupés de soucis restreints. Chaque jour de la semaine nous fait mieux connaître la boulangère, l'abbé, le père Saint-Jean, d'autres, autant pittoresques. Chacun y va de ses commentaires, de sa tirade hargneuse, quand s'installe à l'unique hôtel un jeune homme qui intrigue les villageois, délie leur langue et surtout trouble leur conscience, alors que lui se contente de sourire, de saluer, ravivant la coquetterie et mesquinerie des femmes, ranimant les chamailleries des hommes à propos de prochaines élections.
Ce qui surprend dans l'ensemble du recueil, ce sont ces hommes qui ont fui ce qu'ils sont, ce qu'ils possèdent, essayant d'être à la hauteur de situations où eux-mêmes représentent l'étranger tant redouté de ceux et celles qui n'ont jamais franchi de frontières. Qu'il travaille dans une filature, imaginant où le conduirait une voiture de luxe, comme celle du patron, qu'il panique quand il se réveille, rêvant d'une solution mettant fin au sommeil, qu'il soit amoureux de la Vénus de Vélasquez, la recherchant dans une femme moderne, tous ces hommes ont fui les apparences, pensant trouver mieux ailleurs. Étrangers à leur misère mentale et morale, à leur inassouvissement rancunier contre une société inadaptable, croient-ils. Ils ne sont pas le double d'eux-mêmes, mais, impulsés par une insatisfaction atavique, ils partent dans des pays où ils souhaitent se renouveler sous différents aspects. Cependant, le conte qui nous a le plus touchée, parce que véridique, se titre La sentinelle. Un chauffeur dont la voiture tombe en panne au bord de la jungle, recommande à son passager de l'attendre chez le Tonto, le fou, qui garde jalousement la machinerie détériorée, conséquence de l'échec français que fut l'élaboration du canal de Panama, projet abandonné depuis une quarantaine d'années. Les machines pourrissent « [ ensevelies ] sous le linceul vert, éternellement vert. » Ce linceul vert n'est autre que la végétation luxuriante de la forêt tropicale. Le Tonto a toujours cru, entêté dans sa folie, que le grand ingénieur Lesseps reviendrait terminer son immense entreprise. C'est un conte émouvant, angoissant, prouvant une fois encore que l'homme n'a aucun pouvoir sur la nature : elle engloutit tout ce qui se tient à sa portée. On n'est pas étonnée que le passager, repartant avec le chauffeur, ressente une envie de pleurer face à la folie d'un homme, englouti dans sa propre démence. Magnifique symbole de l'être humain explorant ses déboires déchirants.
La plupart des contes comme celui-ci stupéfient par leur modernisme, par la folie indécente qui menace les protagonistes, ces hommes à la recherche de ce qu'ils ne peuvent atteindre en étant eux-mêmes, leur rêve inaccessible les conduisant vers la perte de soi, de l'être qu'il devient, l'enveloppe initiale, telle la nature, reprenant ses droits. Dans leur nouvelle peau, ces hommes sont atteints d'une mégalomanie délirante qui les emporte vers leur propre destruction. Le temps de l'autre ne dure que lorsque le masque, usé, s'effrite, révèle la véritable identité de l'imposteur, significative dans le conte intitulé si justement, L'étranger.
C'est un livre admirable que nous propose Ringuet, auteur du célèbre roman Trente arpents. Friande de ces récits particuliers, on les a découverts avec une joie indéniable. L'écriture descriptive, précise et détaillée, le style épuré, jamais encombré de résidus romanesques, nous ouvre les portes de la nouvelle, telle qu'elle s'écrit aujourd'hui, incisive et concise. Ringuet fut le précurseur, peut-on avancer, de ce genre minimaliste, si difficile à apprivoiser. À mener à son terme persuasif et accompli.
L'héritage et autres contes, Ringuet
Bibliothèque québécoise ( BQ ), Montréal, 2018, 181 pages
lundi 13 août 2018
Un mort vivant à Venise *** 1/2
Temps de canicule et de chaleur. On se laisse aller à l'ambiance estivale, ne désirant pas autre chose que ce répit excessif survenant avant le long hiver. On oublie que le paysage blanc n'est pas la vie mais un endormissement prolongé jusqu'à l'étiolement de soi. On aime le rythme lent de l'été, comme s'il était de bon ton de faire l'éloge de la lenteur. On a lu le troisième roman d'Éléonore Létourneau, Il n'y a pas d'erreur : je suis ici.
Si le titre de cette fiction nous a laissé dubitative, on n'a pas résisté à l'invitation de la quatrième de couverture. On a découvert une écrivaine qu'on ne connaissait pas, dont l'écriture nous a fascinée. Un petit ton désuet, tellement symbolique, convient parfaitement à l'homme, Pierre, qu'elle met en scène. Cinquantenaire, désenchanté, terriblement lucide, analytique. Une année sabbatique le met face à lui-même, à sa vie dissolue, laisse-t-il entendre, sans jamais se montrer d'une manière exhaustive. « À cinquante ans, je vous le dis, il n'y a à peu près rien que je n'aie pas fait ». Le lecteur n'a nul besoin d'encombrements superficiels, l'écrivaine l'entraînant vers l'essentiel de la vie de son personnage. Comme son mariage raté avec Elga, violoncelliste réputée, qu'il va retrouver à Venise où elle réside. N'est-elle pas son inverse en même temps que sa complémentarité ? Une vingtaine d'années ont passé. Dans l'avion qui l'emporte vers cette femme toujours aimée, il se souvient du jeune garçon qu'il a été. De ses parents qui, pour des raisons professionnelles, voyageaient d'un continent à un autre. Peu d'affection pour cet enfant qui, plus tard, défiant son père, ou l'imitant, embrassera sa profession, empruntant une voie détournée. Architecte, le père dessinait des édifices, le fils dessine des objets. L'un d'eux — un banc — le rendra célèbre. Pour quelles raisons va-t-il rejoindre Elga, il ne le sait trop, sinon que ses réminiscences évoquent en lui des « épisodes de gloire », des clichés de sa célébrité qu'Elga n'a jamais partagée. Pas mieux qu'elle n'a été impressionnée par son rang social. Insolites retrouvailles à Venise, ville qu'il a découverte trente ans plus tôt en sa compagnie.
Si l'histoire de cet homme s'avère surprenante, voire inusitée, c'est la description de Venise qui nous a subjuguée. La ville, cosmopolite, ne devient-elle pas personnage, se solidarisant avec les déboires de Pierre, atteint d'une maladie dégénérescente, de laquelle il connaitra le verdict quelques jours après avoir renoué avec Elga. Celle-ci, qui accomplit une sorte de devoir envers lui, ne manifeste aucun sentiment affectif à son égard. Jusqu'à organiser une soirée festive où Pierre ne sera pas invité. Mentionnons qu'il occupe l'appartement jouxtant celui de sa compagne. Jour et nuit, il se promène dans la ville, faisant part au lecteur de son passé grandiose, puis de sa décadence. Son architecture composite ravive son amour des pierres. Dans les rues, sur les places, il se confond à la cité, envahie par des flots de touristes. La vie de Pierre n'a-t-elle pas été semblable ? Distinguée par le succès, et soudainement plus rien. Que son corps qui se dégrade, se dissout jusqu'à la paralysie. Ne dit-il pas qu'il a pris une année sabbatique pour « préparer sa mort » ? Son existence n'ayant été qu'une mascarade, comment ne pas mettre en parallèle les fastes vénitiens au temps de son carnaval, des masques qui dissimulent les visages, les rangent dans l'anonymat ? La maladie de Pierre se révèle la consécration de ses échecs. « Plus un périmètre rétrécit, moins mon regard s'égare. » Ce qui arrivera quand, paralysé, son regard sera limité à un périmètre restreint, celui des murs, du plafond de sa chambre, percevant à peine le bas de son corps. Une seule fois, mais trop tard, Elga et Pierre se remémoreront leurs années de vie commune, qui auraient pu être différentes si la jalousie de Pierre n'avait pas rongé leurs sentiments fragilisés par leur profession publique. Orgueilleux, diminué physiquement, il n'avouera jamais à sa compagne combien il l'a aimée et admirée. Pierre n'a pas d'avenir, qu'un présent qui l'enlise dans l'étouffement et le refus de se contempler intérieurement alors qu'accomplir un mouvement aisé le préoccupe. Venise s'enfonce régulièrement dans le remous de ses eaux instables, oppressée par l'afflux de touristes. On dirait que la ville a déteint son passé grandiose sur ces intrus occasionnels, la moisissure de ses monuments, les remugles de l'eau stagnante, les ayant pélerinés jusqu'au dernier souffle de Pierre.
C'est un récit admirable, loin des modes actuelles, que nous offre Éléonore Létourneau. Ses réflexions, dans tous les sens du terme, son incursion dans les silences, ou le déni d'un homme égaré, englobant les failles dont la ville et l'être humain sont victimes, expriment une réussite d'intelligence méditative, d'observation poétique. On a pensé, durant notre lecture, à Alexandrie, brossée par Lawrence Durrell dans son célèbre Quatuor, ce qui n'est pas vain. Étonnant voyage dans le temps, aussi dans le corps et l'esprit d'un homme qui a dessiné sa vie comme il dessinait les objets. « J'ai tracé une ligne, une droite vers l'infini [ ... ] et qui, tout ce temps, pointait vers le néant. » La mort de Pierre n'est qu'accessoire, se retrouvant seul comme il le fut dès ses quatre ans, lui et Venise s'acheminant vers leur propre destruction. La cité, majestueuse, ralliant de nombreuses villes enfouies sous les flots. Les touristes qui, par leur nombre, la dévastent se souviendront d'elle et de ses trésors, mais qui se souviendra de cet homme qui la parcourait de fond en comble ? De l'artefact qui lui avait apporté une gloire éphémère ? Conscience effilochée de Pierre quand, sur le point d'atteindre l'autre rive, il entrevoit, vue de haut, la lagune tel un joli marécage. Effervescence d'un dernier sursaut de vie qui, après que de flous paysages l'ont étourdi, le fera frissonner. Et mourir.
Il n'y a pas d'erreur : je suis ici, Éléonore Létourneau
XYZ éditeur, collection Quai No 5
Montréal, 2018, 155 pages
Si le titre de cette fiction nous a laissé dubitative, on n'a pas résisté à l'invitation de la quatrième de couverture. On a découvert une écrivaine qu'on ne connaissait pas, dont l'écriture nous a fascinée. Un petit ton désuet, tellement symbolique, convient parfaitement à l'homme, Pierre, qu'elle met en scène. Cinquantenaire, désenchanté, terriblement lucide, analytique. Une année sabbatique le met face à lui-même, à sa vie dissolue, laisse-t-il entendre, sans jamais se montrer d'une manière exhaustive. « À cinquante ans, je vous le dis, il n'y a à peu près rien que je n'aie pas fait ». Le lecteur n'a nul besoin d'encombrements superficiels, l'écrivaine l'entraînant vers l'essentiel de la vie de son personnage. Comme son mariage raté avec Elga, violoncelliste réputée, qu'il va retrouver à Venise où elle réside. N'est-elle pas son inverse en même temps que sa complémentarité ? Une vingtaine d'années ont passé. Dans l'avion qui l'emporte vers cette femme toujours aimée, il se souvient du jeune garçon qu'il a été. De ses parents qui, pour des raisons professionnelles, voyageaient d'un continent à un autre. Peu d'affection pour cet enfant qui, plus tard, défiant son père, ou l'imitant, embrassera sa profession, empruntant une voie détournée. Architecte, le père dessinait des édifices, le fils dessine des objets. L'un d'eux — un banc — le rendra célèbre. Pour quelles raisons va-t-il rejoindre Elga, il ne le sait trop, sinon que ses réminiscences évoquent en lui des « épisodes de gloire », des clichés de sa célébrité qu'Elga n'a jamais partagée. Pas mieux qu'elle n'a été impressionnée par son rang social. Insolites retrouvailles à Venise, ville qu'il a découverte trente ans plus tôt en sa compagnie.
Si l'histoire de cet homme s'avère surprenante, voire inusitée, c'est la description de Venise qui nous a subjuguée. La ville, cosmopolite, ne devient-elle pas personnage, se solidarisant avec les déboires de Pierre, atteint d'une maladie dégénérescente, de laquelle il connaitra le verdict quelques jours après avoir renoué avec Elga. Celle-ci, qui accomplit une sorte de devoir envers lui, ne manifeste aucun sentiment affectif à son égard. Jusqu'à organiser une soirée festive où Pierre ne sera pas invité. Mentionnons qu'il occupe l'appartement jouxtant celui de sa compagne. Jour et nuit, il se promène dans la ville, faisant part au lecteur de son passé grandiose, puis de sa décadence. Son architecture composite ravive son amour des pierres. Dans les rues, sur les places, il se confond à la cité, envahie par des flots de touristes. La vie de Pierre n'a-t-elle pas été semblable ? Distinguée par le succès, et soudainement plus rien. Que son corps qui se dégrade, se dissout jusqu'à la paralysie. Ne dit-il pas qu'il a pris une année sabbatique pour « préparer sa mort » ? Son existence n'ayant été qu'une mascarade, comment ne pas mettre en parallèle les fastes vénitiens au temps de son carnaval, des masques qui dissimulent les visages, les rangent dans l'anonymat ? La maladie de Pierre se révèle la consécration de ses échecs. « Plus un périmètre rétrécit, moins mon regard s'égare. » Ce qui arrivera quand, paralysé, son regard sera limité à un périmètre restreint, celui des murs, du plafond de sa chambre, percevant à peine le bas de son corps. Une seule fois, mais trop tard, Elga et Pierre se remémoreront leurs années de vie commune, qui auraient pu être différentes si la jalousie de Pierre n'avait pas rongé leurs sentiments fragilisés par leur profession publique. Orgueilleux, diminué physiquement, il n'avouera jamais à sa compagne combien il l'a aimée et admirée. Pierre n'a pas d'avenir, qu'un présent qui l'enlise dans l'étouffement et le refus de se contempler intérieurement alors qu'accomplir un mouvement aisé le préoccupe. Venise s'enfonce régulièrement dans le remous de ses eaux instables, oppressée par l'afflux de touristes. On dirait que la ville a déteint son passé grandiose sur ces intrus occasionnels, la moisissure de ses monuments, les remugles de l'eau stagnante, les ayant pélerinés jusqu'au dernier souffle de Pierre.
C'est un récit admirable, loin des modes actuelles, que nous offre Éléonore Létourneau. Ses réflexions, dans tous les sens du terme, son incursion dans les silences, ou le déni d'un homme égaré, englobant les failles dont la ville et l'être humain sont victimes, expriment une réussite d'intelligence méditative, d'observation poétique. On a pensé, durant notre lecture, à Alexandrie, brossée par Lawrence Durrell dans son célèbre Quatuor, ce qui n'est pas vain. Étonnant voyage dans le temps, aussi dans le corps et l'esprit d'un homme qui a dessiné sa vie comme il dessinait les objets. « J'ai tracé une ligne, une droite vers l'infini [ ... ] et qui, tout ce temps, pointait vers le néant. » La mort de Pierre n'est qu'accessoire, se retrouvant seul comme il le fut dès ses quatre ans, lui et Venise s'acheminant vers leur propre destruction. La cité, majestueuse, ralliant de nombreuses villes enfouies sous les flots. Les touristes qui, par leur nombre, la dévastent se souviendront d'elle et de ses trésors, mais qui se souviendra de cet homme qui la parcourait de fond en comble ? De l'artefact qui lui avait apporté une gloire éphémère ? Conscience effilochée de Pierre quand, sur le point d'atteindre l'autre rive, il entrevoit, vue de haut, la lagune tel un joli marécage. Effervescence d'un dernier sursaut de vie qui, après que de flous paysages l'ont étourdi, le fera frissonner. Et mourir.
Il n'y a pas d'erreur : je suis ici, Éléonore Létourneau
XYZ éditeur, collection Quai No 5
Montréal, 2018, 155 pages
lundi 6 août 2018
Des cris, des jouissances, des exacerbations *** 1/2
Aphorisme. Quand nous aimons une personne, c'est soi que nous aimons avant tout. La preuve en est que nous voulons changer certains points qui nous déplaisent en cette personne, désirant faire d'elle une copie conforme de ce que nous sommes. Bien souvent, avec raison, ce souhait ridicule finit mal. On a lu le roman d'Anne Peyrouse, Tu ne tueras point.
Cinquième commandement transmis par Dieu à Moïse, sur le mont Sinaï, on a été intriguée par ce titre dénonçant les dérives de Clara, la narratrice, qui confie au lecteur les malheurs qu'elle et son jeune frère, Maxime, ont subi durant leur enfance et adolescence pitoyables. Une mère violente, un père inconnu, comme il se doit. Pour rendre plus pathétique encore ce volet sombre de la jeunesse des deux protagonistes, l'écrivaine emploie un registre d'écriture rarement atteint dans le flot de nos dernières lectures. À coups de cris, de hurlements, à coups de poing qu'il est facile d'imaginer, Clara déverse sa hargne contre cette mère abusive qui l'a humiliée, elle et son frère, considérant ses enfants comme les pires déchets de sa vie de femme frustrée. Lecture si redoutable que l'écho sinistre de la colère de Clara nous parvient à travers les phrases. Tout le livre s'achemine ainsi, le refus de n'être rien, et pour réduire à néant cette infortune, il faudra accomplir l'acte suprême, soit s'exterminer soi-même.
Le roman se divise en trois actes dramatiques. Le premier présente une jeune femme mariée, un mari aimant, deux enfants qu'elle protège comme une louve. Pourtant, en son intérieur dévoré par une souffrance innommable, Clara, car c'est bien elle, vit dans un monde rétréci, immergée de souffrances antérieures. Ne dit-elle pas que « la mémoire est comme un aiguisoir à entailles profondes » ? Et ce sont bien des souvenirs outrageants qui dirigent Clara vers des chemins fracassés d'instants assassins. On ne comprend pas tout de la démarche désespérée de Clara, le lecteur devant se laisser aller et compasser. Clara se sent « comme un cratère qui ne parvient pas à expulser sa révolte », douleur inaccessible au lecteur qui lit cette histoire, confortablement installé dans une existence pacifique. Dans ce décor coulissé partout de drames, peu à peu, nous faisons connaissance avec les amants et amantes de passage. Le sexe, faim inassouvie, ne rassasie pas les fringales de Clara, ces hommes et ces femmes qu'elle associe, inconsciemment ou non, à un acte qu'elle a commis le jour de ses dix-huit ans. Responsable de ses décisions, son âge signant une précoce majorité. Le jeune frère, Maxime, déficient mental, la suit dans ce démentiel parcours, autrefois la mère ayant voulu le faire enfermer dans un hôpital psychiatrique, Clara s'était farouchement opposée à son désir macabre. S'il doit cette précaire liberté à sa sœur, il s'enfonce dans la terre et la boue, refuges nourrissant ses délires tonitruants que seule Clara parvient à maîtriser. « Maxime cherche encore à travers son regard une galerie souterraine où il s'enfouirait heureux, calmé ». Ce deuxième acte se révèle horrifique, cependant moins éparpillé, les amours de Clara estompant par à-coups la souffrance qui la ravage, aiguisant sa peur viscérale d'avoir tué ses deux jeunes enfants. Il y a « l'amant feu » qu'elle préserve du malheur, celui-ci désirant mourir, incitant Clara à accomplir un geste fatal qu'elle réprouve et refuse. Ne lui offre-t-il pas une arme blanche qui faciliterait son horrible geste ? Une signature de sang qui la mine depuis la mort de la marâtre, sous le regard complice et réjoui du jeune frère. L'enfance et l'adolescence, deux cycles complémentaires où le jeu et la maturité s'intègrent l'un en l'autre. Si le cycle est inexistant ou interrompu par la violence, plus tard s'y inscrivent les blessures sur la chair déchirée, « souvenirs destructeurs avec lesquels Clara et Maxime devront vivre ». Le troisième acte met commencement et fin à la tragédie. Le passé de la mère surgit, incompréhensible, mais il fallait une explication plausible à tant de cruauté mentale. « Dans le cœur maternel il n'y a que des trous, des crevasses, des fissures vides ou vidées ». Jugement insoutenable qui déterminera la décision irrévocable de Clara. Les humains dégénérés, comme les bêtes, doivent subir la peine de mort. Séquence atteignant son paroxysme, préméditée par la jeune fille. Le crime parfait est commis, ouvert à tous les remords, s'il est possible de les faire taire, une fois réveillés.
Des détails symbolisent le comportement des deux adolescents, pendant que Clara se remémore. Le téléphone ne cesse de sonner, les messages aboutissent sur le répondeur, tel le refus de se confier à quiconque. Une hermine, sortie de son terrier, accompagne le périple insensé de Clara et Maxime jusqu'à l'aboutissement fatal. On ne sait trop si la bête existe ou si sa fourrure soyeuse est un rêve compensatoire à tant d'abjection. Le drame shakespearien, il ne peut y avoir pire issue représentée sur une scène, se termine sur le retour hypothétique de Maxime, fidèle à un « pacte de fidélité. D'éternité. » Comment pourrait-il en être autrement, les coups meurtriers et le sang de la marâtre les ayant unis à jamais ?
Récit où seuls les mots comptent, déversant des sentiments excessifs, perdus d'avance. On aimerait qu'ils se taisent mais, soutenus par une écriture saccadée, hachurée, phrases courtes et fluides, les cris demeurent les plus intenses dans ce trio dévoré par la haine, aussi par l'amour. Plus tard, une silencieuse entente s'opère entre Clara et Maxime, ce dernier étant parti de train en train. Entente désarticulée par le récit de l'écrivaine, Anne Peyrouse, renouant une alliance avec les hurlements retenus de l'époque où Clara a entrepris une vaine pacification avec la mère. L'échec filial de la petite fille n'a pu que nourrir son dessein, celui-ci prenant corps meurtri et âme pervertie dans les constants rabrouements de la marâtre, assujettie à sa propre folie.
Tu ne tueras point, Anne Peyrouse
Les éditions du Septentrion, collection Hamac
Québec, 2018, 170 pages
Cinquième commandement transmis par Dieu à Moïse, sur le mont Sinaï, on a été intriguée par ce titre dénonçant les dérives de Clara, la narratrice, qui confie au lecteur les malheurs qu'elle et son jeune frère, Maxime, ont subi durant leur enfance et adolescence pitoyables. Une mère violente, un père inconnu, comme il se doit. Pour rendre plus pathétique encore ce volet sombre de la jeunesse des deux protagonistes, l'écrivaine emploie un registre d'écriture rarement atteint dans le flot de nos dernières lectures. À coups de cris, de hurlements, à coups de poing qu'il est facile d'imaginer, Clara déverse sa hargne contre cette mère abusive qui l'a humiliée, elle et son frère, considérant ses enfants comme les pires déchets de sa vie de femme frustrée. Lecture si redoutable que l'écho sinistre de la colère de Clara nous parvient à travers les phrases. Tout le livre s'achemine ainsi, le refus de n'être rien, et pour réduire à néant cette infortune, il faudra accomplir l'acte suprême, soit s'exterminer soi-même.
Le roman se divise en trois actes dramatiques. Le premier présente une jeune femme mariée, un mari aimant, deux enfants qu'elle protège comme une louve. Pourtant, en son intérieur dévoré par une souffrance innommable, Clara, car c'est bien elle, vit dans un monde rétréci, immergée de souffrances antérieures. Ne dit-elle pas que « la mémoire est comme un aiguisoir à entailles profondes » ? Et ce sont bien des souvenirs outrageants qui dirigent Clara vers des chemins fracassés d'instants assassins. On ne comprend pas tout de la démarche désespérée de Clara, le lecteur devant se laisser aller et compasser. Clara se sent « comme un cratère qui ne parvient pas à expulser sa révolte », douleur inaccessible au lecteur qui lit cette histoire, confortablement installé dans une existence pacifique. Dans ce décor coulissé partout de drames, peu à peu, nous faisons connaissance avec les amants et amantes de passage. Le sexe, faim inassouvie, ne rassasie pas les fringales de Clara, ces hommes et ces femmes qu'elle associe, inconsciemment ou non, à un acte qu'elle a commis le jour de ses dix-huit ans. Responsable de ses décisions, son âge signant une précoce majorité. Le jeune frère, Maxime, déficient mental, la suit dans ce démentiel parcours, autrefois la mère ayant voulu le faire enfermer dans un hôpital psychiatrique, Clara s'était farouchement opposée à son désir macabre. S'il doit cette précaire liberté à sa sœur, il s'enfonce dans la terre et la boue, refuges nourrissant ses délires tonitruants que seule Clara parvient à maîtriser. « Maxime cherche encore à travers son regard une galerie souterraine où il s'enfouirait heureux, calmé ». Ce deuxième acte se révèle horrifique, cependant moins éparpillé, les amours de Clara estompant par à-coups la souffrance qui la ravage, aiguisant sa peur viscérale d'avoir tué ses deux jeunes enfants. Il y a « l'amant feu » qu'elle préserve du malheur, celui-ci désirant mourir, incitant Clara à accomplir un geste fatal qu'elle réprouve et refuse. Ne lui offre-t-il pas une arme blanche qui faciliterait son horrible geste ? Une signature de sang qui la mine depuis la mort de la marâtre, sous le regard complice et réjoui du jeune frère. L'enfance et l'adolescence, deux cycles complémentaires où le jeu et la maturité s'intègrent l'un en l'autre. Si le cycle est inexistant ou interrompu par la violence, plus tard s'y inscrivent les blessures sur la chair déchirée, « souvenirs destructeurs avec lesquels Clara et Maxime devront vivre ». Le troisième acte met commencement et fin à la tragédie. Le passé de la mère surgit, incompréhensible, mais il fallait une explication plausible à tant de cruauté mentale. « Dans le cœur maternel il n'y a que des trous, des crevasses, des fissures vides ou vidées ». Jugement insoutenable qui déterminera la décision irrévocable de Clara. Les humains dégénérés, comme les bêtes, doivent subir la peine de mort. Séquence atteignant son paroxysme, préméditée par la jeune fille. Le crime parfait est commis, ouvert à tous les remords, s'il est possible de les faire taire, une fois réveillés.
Des détails symbolisent le comportement des deux adolescents, pendant que Clara se remémore. Le téléphone ne cesse de sonner, les messages aboutissent sur le répondeur, tel le refus de se confier à quiconque. Une hermine, sortie de son terrier, accompagne le périple insensé de Clara et Maxime jusqu'à l'aboutissement fatal. On ne sait trop si la bête existe ou si sa fourrure soyeuse est un rêve compensatoire à tant d'abjection. Le drame shakespearien, il ne peut y avoir pire issue représentée sur une scène, se termine sur le retour hypothétique de Maxime, fidèle à un « pacte de fidélité. D'éternité. » Comment pourrait-il en être autrement, les coups meurtriers et le sang de la marâtre les ayant unis à jamais ?
Récit où seuls les mots comptent, déversant des sentiments excessifs, perdus d'avance. On aimerait qu'ils se taisent mais, soutenus par une écriture saccadée, hachurée, phrases courtes et fluides, les cris demeurent les plus intenses dans ce trio dévoré par la haine, aussi par l'amour. Plus tard, une silencieuse entente s'opère entre Clara et Maxime, ce dernier étant parti de train en train. Entente désarticulée par le récit de l'écrivaine, Anne Peyrouse, renouant une alliance avec les hurlements retenus de l'époque où Clara a entrepris une vaine pacification avec la mère. L'échec filial de la petite fille n'a pu que nourrir son dessein, celui-ci prenant corps meurtri et âme pervertie dans les constants rabrouements de la marâtre, assujettie à sa propre folie.
Tu ne tueras point, Anne Peyrouse
Les éditions du Septentrion, collection Hamac
Québec, 2018, 170 pages