Les mots, ces petits vocables remplis de pouvoir néfaste ou conciliateur. Chacun les utilise à sa manière, pour faire ou défaire son propre monde. Il nous est arrivé de poser la question, à savoir si les mots avaient quelque importance dans une conversation qu'on menait avec franchise. La réponse fut mensongère, on a su depuis, pour l'avoir éprouvé, que les mots n'étaient que matamores, à l'image de la personne qui les prononçait. On commente le recueil de nouvelles de Mireille Gagné, Le syndrome de takotsubo.
Ce sont d'étranges fictions aux titres quelque peu intrigants, abrégées d'un sous-titre qui semble éclairer une histoire brève, intimiste, comme doit l'imposer le genre. Dix-sept nouvelles qui mettent en vedette le cœur humain et ses aléas. Parfois, il est sur le point d'éclater, ou bien, moins fougueux, il se repose. Ses battements servent de baromètre à qui subit les avatars que concocte notre existence, nous rendent vulnérables, faillibles ou plus forts. Petite musique qui devrait nous faire sourire à mesure que nous grandissons. On généralise le rôle éprouvant du cœur, celui-ci se fatigant à énumérer les états d'âme des protagonistes qui peuplent le recueil. Un étrange syndrome l'afflige, bien heureusement explicité par la nouvellière. Un éclatement de l'organe qui permet de circuler dans et hors de sentiers battus.
Témoignant de l'état harassé des personnages, la première nouvelle nous apprend que le pire reste à venir quand un couple japonais émigre sur un continent totalement inconnu. C'était il y a longtemps, mais peu de changements sont survenus face à l'étranger qui essaie de se faire une place non au soleil mais dans l'ombre des natifs du pays d'accueil. Ces émigrants ont beau user de discrétion, de patience, taire la douleur, rien n'y fait, il faut toujours prouver. Ne reste qu'une honteuse blessure qui s'avère l'échec cuisant de l'aventure. Des forces antinomiques se manifestent, elles ordonnent de retourner au pays natal. Le cœur peut être aussi un miroir, celui des yeux d'un bourreau envers une femme qui, par jalousie, a tué son mari. Elle est condamnée à être pendue. Un texte qui reviendra ranimer les arcanes fragiles du cœur, à deux ou trois reprises, tel un refus à disparaitre. La narratrice, d'une lucidité implacable, dépeindra sa condition de criminelle, sans aucun remords. Une autre fiction relate au lecteur comment nous pouvons perdre nos acquis quand notre prénom se heurte à un organisme social ou politique, nous défaisant de notre pouvoir identitaire. Combattre les péripéties qui font et défont ce que nous sommes. Le pouvoir public fait partie du pire qui accable un individu quand il est victime d'une crise cardiaque dans une limousine. La jeune femme qui l'accompagne n'a plus qu'à se réfugier dans son « petit appartement délabré », donnant presque la parole à un enfant victime lui aussi de l'atrophie de son prénom. Boucle étonnante que ce texte conduisant le lecteur vers un cœur brisé. Une femme quitte son mari à l'aube pour aller travailler. Le soir, elle lui téléphone qu'elle sortira avec ses amies, ce qui le désespère, sachant très bien qu'elle ment. Elle a besoin d'un homme autre que lui. Seul le corps se donne et se prend. Pendant cette nuit hostile, le cœur de l'homme a cessé de battre. Conclusion surprenante qui révèle la qualité de ces récits, l'écriture servant d'exutoire à des êtres fictifs que la vie nous fait rencontrer, essaimés par de curieux hasards.
Tout le livre est ainsi. Bondé de cœurs épuisés. Bardé de cœurs défaillants. De corps qui se démènent comme ils peuvent. Il y a aussi des cris qui s'ajustent à des situations desquelles une femme ou un homme n'est pas toujours responsable. Dans le récit, Le cri n'est pas une parole hermétique, la narratrice se souvient de son angoisse mêlée à la fierté, quand son père, un an avant de mourir, l'a initiée à la chasse. Père de peu de mots mais de gestes conséquents. Elle devait tuer les oies au moment de leur migration. Son incapacité à les achever si elles n'étaient que blessées par son tir maladroit. Aujourd'hui, à l'agonie, le père refuse à s'en aller. Il faudra les paroles apaisantes de la mère pour que le cœur cesse de battre. Nouvelle émouvante, prépondérant l'amour filial, comme souvent cela se produit entre un père et sa fille. Tout est relatif, ramène le lecteur à une réalité qui mine une langue quand, dans un pays non affirmé, elle devient minoritaire. À sa manière, le narrateur, qui enseigne le français à des adolescents, le défend à travers un sentiment passionnel qu'il éprouve pour une de ses étudiantes. Il sera radié du corps enseignant, devra se convertir à une profession inadéquate, lui, qui a connu la mort de près. Mort symbolique, mort du cœur sous la peau. Il y a des alertes qui ne trompent pas, des blessures qui ne cicatrisent pas, des gémissements, des cris. Des murmures qui font de ces textes une panoplie d'identités flouées, nous rappelant que nos sentiments naissent à partir d'une appellation intimiste, personnifiée et non généralisée dans un monde qui se prête à toutes les manigances. Ceux et celles qui échappent à cette condition, s'égarent loin des conventions, ne sont plus que des errants, cédant aux cauchemars, à la mort, parce qu'il « existe des endroits pour mourir ». Un temple japonais, par exemple. Autre marginal, cet homme qui ne parvient plus à remplir la feuille blanche, frustré au point de suivre une femme rencontrée dans une librairie, rêvant d'écrire sur sa peau, qu'il juge parfaite. Ambigüité excessive des protagonistes même s'ils passent et repassent, se confondent aux ombres des arbres, n'ont l'air que de simples quidams innocents. L'acte de survivre l'emporte sur le fait de vivre, comme si l'existence s'avérait un constant naufrage qu'il faut atténuer de quelque originalité pour éviter de se noyer. De mourir.
C'est un recueil déstabilisant, intelligent jusque dans les titres. Favorablement hermétique. Combien attachant et subtil quand des circonstances non atténuantes transforment les individus en des cœurs qui ne demandent qu'à battre, orchestrant le temps — le moment — qui leur est alloué. Cela peut durer des décennies ces battements machinaux, jusqu'au délabrement du muscle coronarien qui ne peut rien contre les effets poétiques de récits écrits de main de maitre par une écrivaine qui a saisi l'art minimaliste de la nouvelle.
Le syndrome de takotsubo, Mireille Gagné
Les Éditions Sémaphore, Montréal, 2018, 120 pages
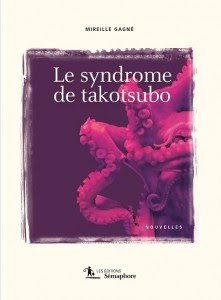
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Commentaires: